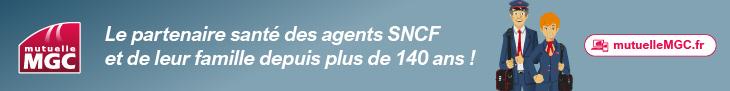Tout ce qui a été posté par PN407
-
le modèle économique du TGV en difficulté
Pour répondre à Nox sur l'émergence d'une 4ème roue du char ferroviaire : à mon avis, en bref, je ne vois que peu de chances Je crois qu'il faut désormais voir le groupe SNCF dans son ensemble. Au sein du groupe et sur le territoire français, SNCF appelle "activité TGV" son activité ferroviaire voyageurs "à ses risques et périls" (pour faire simple) Pour toutes les autres activités voyageurs, SNCF est "tireur de trains" décidés par d'autres. Le groupe SNCF peut activer une filiale ou "pseudo-filiale" (seul ou en partenariat) pour répondre à un marché ou un service que TGV ne peut assurer en dégageant une marge. Le groupe SNCF est un groupe puissant, il peut à mon avis faire en voyageur routier ce qu'il a fait en fret routier (surtout s'il y a libéralisation des règles du jeu): on ne fait en ferroviaire que ce qui dégage une marge, sans état d'âme. Le reste en routier, et ce qui ne dégage pas de marge au bon cœur des pouvoirs publics : convention, convention, convention. Et c'est au politique de prendre les claques des usagers déçus. Mon marketing a plein d'idées, j'en teste certaines, mais faut que çà rapporte. Il est à noter que l'Etat est conventionné avec la SNCF pour assurer l'exploitation des trains non TGV et non couverts par TER : ce sont avec les TGV les trains nationaux, et c'est l'Etat qui en dessine la contexture (de gré ou de force) Pour les transports régionaux de voyageurs, l'autorité organisatrice est la Région, pour Transilien le STIF. C'est l'AO qui dresse la liste des services qu''elle souhaite assurer : elle a tout pouvoir pour ne pas se laisser "fourguer" les trains (ou les parties de parcours) que L'Etat ou la SNCF ne voudraient plus assurer. Si l'AO choisit le mode ferroviaire sur le RFN, elle doit contracter avec SNCF Mobilité. Si elle choisit le routier ... La situation future dans les mois à venir et pour peut-être plus longtemps : à mon avis très incertaine, et peu propice politiquement à s'asseoir, réfléchir, puis décider 1) la situation économique du pays est ce qu'elle est, et beaucoup doutent du pouvoir économique des élus 2) Les budgets publics sont très difficiles, à tout niveau politique (nation, région, département, commune, regroupements divers) 3) tout le canevas du découpage territorial est en retouches avec plein d'acteurs politiques qui surveillent ce que devient leur coin et ce que devient leur "poids politique" (très lié à l'enveloppe financière qu'ils contrôlent à partir de leur poste politique) dans telle ou telle hypothèse, et luttent en conséquence. Le "Grand Paris" n'est pas un sujet négligeable, vu les sommes et les "ego" en jeu. 4) face à des thèmes comme l'éducation, la préparation de l'avenir, etc. le sujet ferroviaire n'est pas une priorité (la réforme a été faite) 5) si les élections régionales et départementales sont dans le sens des municipales, les nouveaux élus ne feront pas de cadeau médiatique au gouvernement national actuel, surtout à l'approche de présidentielles. Donc, règlement au coup par coup, par rustine, des urgences patentes, et mise sous le tapis de ce qui peut l'être
-
L'Ifrap plaide pour une libéralisation du transport par autocar...
petit rappel de la loi au 1er janvier 2015 (sous réserves des modifications à venir du fait des travaux législatifs et idées ministérielles) "La Région est responsable de l'établissement du Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), multimodal, dans le respect des compétences de chaque niveau de collectivité Elle organise les services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux les services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires Une convention passée avec SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale" Dès la législation actuelle, les SRIT ont inscrit des dessertes routières express "effectués en substitution de services ferroviaires". Par exemple : en Auvergne, car express St Flour Massiac, avec correspondance à Massiac (point d'accès à l'autoroute A75 gratuite bien situé par rapport à la gare) avec la desserte ferroviaire Aurillac-Clermont Ferrand en Languedoc Roussillon, car express Montpellier-Millau-St Affrique (A75 jusqu'à Millau Sud, avant le viaduc à péage) en coopération LR-Auvergne, car express Mende-Langogne-Le Puy (N88 modernisée) Des dessertes plus locales sont en partie effectuées sur route, notamment sur Marvejols-Mende-La Bastide Vu du groupe multimodal de transport SNCF : Les services ferroviaires sont de par la loi assurés par SNCF Mobilités Le groupe SNCF dispose de filiales routières pour se placer sur les services routiers de substitution
-
le modèle économique du TGV en difficulté
En réponse à fabrice (son message 340) Ce qui me dérange, ce n'est pas que l'argent des redevances payées par l'activité TGV (appellation SNCF) / les trains aptes à la grande vitesse (appellation RFF) soit versées dans un pot national appelé "redevances réseau RFF". C'est que le rapport de la Cour tire des conclusions sur "la grande vitesse ferroviaire" à la française à partir d'une image financière très faussée, avec les conséquences médiatiques qu'on est en train de vivre. La dégradation de la marge de l'activité GV de la SNCF de 2008 à 2013 est clairement due à une hausse importante des péages, liée non pas à d'intenses variations de trains-km parcourus (çà se saurait), mais aux hausses tarifaires des sections empruntées (en simplifiant : section classique côté Paris, section à GV, section de ligne classique en diffusion sur le territoire). A mon avis, analyser correctement les données financières liées à "la grande vitesse à la française", telle qu'elle est aujourd'hui, supposerait de ne retenir dans le montant des péages versée par l'activité GV de la SNCF, que la part correspondant aux travaux d'entretien des sections de ligne concernées (lissés sur une certaine durée en cas de gros travaux de renouvellement) : quote-part partagée avec Transilien , Intercités et TER sur les sections communes franciliennes, 100% affectés à GV sur les LGV, quote-part partagée avec TER (essentiellement) sur les lignes classiques de diffusion sur le territoire. Sauf erreur de ma part, à partir des données de la page 151 du rapport Cour des Comptes et des rapports financiers RFF des années 2008 et 2013 (page 8 de 2008, page 9 de 2013), on constate les évolutions suivantes (en milliards d'euros) : redevances réseau totales 3,0 en 2008, passe à 5,4 en 2013 (+80%) redevance activité GV SNCF 1,3 1,9 (+46%) donc par différence redevance autres utilisateurs 1,7 3,5 (+106%) A ce rythme, au-delà de l'impasse financière prévisible de l'activité GV de la SNCF, je répète qu'à mon avis, le sujet crucial sur lequel réfléchir, en s'inspirant du titre volontairement médiatique du rapport de la Cour sur la GV, est : "le financement de l'entretien et de l'exploitation des infrastructures ferroviaires françaises, un modèle porté au delà de sa pertinence". Cà correspond bien à la situation financière, et à tout ce que les praticiens de l'entretien de l'infrastructure nous disent sur le présent forum. Sur les autres points soulevés : Assèchement du réseau classique : il ne concerne que la partie "parallèle" à la LGV : par définition, une fois la LGV faite, le courant voyageurs de l'axe Sud-Est n'emprunte plus la ligne PLM, sauf pour certains trains GV la section Montbard Dijon, sortie de Paris, entrée dans Marseille et autres petits bouts çà et là. Côté tronc commun classique au départ de Paris, et sur les lignes classiques de diffusion, il me semble qu'il y a plus de directs Paris aujourd'hui qu'en situation antérieure à la LGV. A titre d'exemple, j'ai regardé Lyon Grenoble, il y a un jour de semaine 5 TGV directs, contre 4 trains directs en 1975. Puisqu'il n'y a plus les bolides sur la ligne PLM, on peut penser d'une part qu'une adaptation des installations au trafic après TGV a été faite (pour faire simple, suppression de tout ce qui était lié au dépassement des patachons par les batteries de "voraces"), et que d'autre part, les installations maintenues ont un niveau d'entretien inférieur (abaissement de classe UIC lié à la baisse du nombre de trains). Contributeurs des redevances liées au "prestations minimales" (appellations RFF), on peut tirer du document financier RFF 2013 le hit -parade suivant : TER+Transilien 51%, trains aptes GV 35%, trains grande lignes 12%, trains de fret (SNCF et entreprises alternatives) 2%.
-
le modèle économique du TGV en difficulté
à 5121 N°325 Je ne considère pas que ce que j'ai lu lié au rapport (communiqué et diaporama) soit tout entier une "mauvaise prose". Comme déjà dit, bien des choses sont connues des intéressés, ou conformes à des principes de gestion "en bon père de famille" (quelle expression sexiste !!!) Sur la forme, sauf preuves à apporter, la Cour n'est pas dans un complot, mais dans sa mission légale d'évaluation "du bon emploi des fonds publics" (pas dans celle de tribunal des comptables publics, elle ne signale aucune irrégularité répréhensible). Ses rapports sont faits par des êtres humains, donc pas parfaits, mais via des procédures collégiales. Ils sont contradictoires et intègrent les observations des "parties concernées" (voir fin du rapport complet). Je note à ce sujet qu'aucun ministère n'a formulé d'observations, RFF quelques lignes approbatrices. De plus, ses rapports sont publics : visiblement un certain nombre d'acteurs sociaux ont commenté ce rapport, il y a eu expression d'idées TRES variées et "chaudes" sur le sujet, c'est bien le rôle souhaité de ces rapports vis à vis des citoyens. Y en a moins eu sur le document relatif aux secrétaires généraux de ministères, sauf dans le milieu concerné :-) Je regrette la confusion entre la SNCF (entité qui a un sens juridique) et sa seule "activité TGV" (qui est une entité d'organisation interne). Les péages de l'activité TGV méritent analyse détaillée, et ce sont les péages versés par la SNCF (ou alors il faut créer une filiale) qui varient lors de l'ouverture d'une nouvelle section de ligne nouvelle sur le réseau national. Vu sous l'angle EF, les quelques arrêts de certains trains dans quelques gares intermédiaires et le poids du temps passé sur lignes classiques par les trains techniquement aptes à la grande vitesse résulte précisément de la volonté d'irrigation en train direct de larges bassins du territoire. La France est ce qu'elle est, l'Ile de France n'est pas la région de Tokyo, Lyon n'est pas Osaka + Kyoto, Mâcon n'est pas Nagoya, et l'ensemble de la Saône et Loire est moins peuplé que la ville d'Hamamatsu. Ce système de trains "mixtes" a assuré en 2007 2008 une marge autour de 28% à l'activité TGV de la SNCF, et donné environ 1,2 milliards de recettes à RFF. Sur le sujet péages, je n'ai rien lu (dans le peu que j'ai lu du rapport et documents liés) sur le poids des péages récoltés sur lignes nouvelles par rapport aux dépenses infra (y compris amortissements et charges financières) des seules sections à GV. En d'autres termes, deux questions sans réponse : la forte augmentation des péages de l'activité GV depuis 4ans vient-elle des seules majorations sur LGV ? Ces majorations ont-elles servi à répondre à des charges nouvelles sur les seules sections à GV, ou bien à couvrir des charges que seraient incapables de se financer elles-mêmes d'autres sections du réseau ferré national? Dans ce dernier cas, le titre "médiatique" du rapport aurait pu être : le financement des dépenses courantes liées aux infrastructures ferroviaires nationales françaises, un modèle porté au de-delà de sa pertinence.
-
le modèle économique du TGV en difficulté
Quelques premières remarques sur le rapport cour des comptes (communiqué, diaporama et P151 du rapport, ni le temps ni l'envie d'en faire plus): Désolé pour ceux qui n'aiment pas mastiquer les chiffres :-) Juste pour dire : je respecte les magistrats rapporteurs, mais il y a des imprécisions qui biaisent certaines conclusions ou recommandations 1) A mon avis, confusion entre l'activité TGV de la SNCF (qui utilise des tronçons de ligne nouvelle et des tronçons de ligne classique) et l'activité LGV au sens strict de RFF (de l'origine à l'extrémité de chaque LGV) 2) variation de la marge de l'activité TGV SNCF Page 7 du diaporama la marge opérationnelle du TGV passe de 24% à 12% de 2009 à 2013 Page 8 parmi les deux causes citées coûts hors péages augmentant de 6,2% par an entre 2002 et 2009 : super explication pour la période 2009-2013 !!! 3) Le rapport dit que les TGV passent 40% de leur temps sur ligne classique, et c'est l'un des thèmes mis en avant dans le communiqué. Aucune analyse de la décomposition des coûts de l'activité TGV SNCF (et de la variation de ces coûts de 2009 à 2013 par exemple) : dépenses d'exploitation sur ligne classique, dépenses d'exploitation sur LGV, dépenses commerciales au sol (dont coût de réservation électronique par passager), amortissements et charges financières du matériel GV imputés au parcours ligne classique, au parcours GV, quote part de dépenses communes de l'entreprise imputées à l'activité TGV. 4) en croisant les données p7 et 8 du diaporama et la page 151 du rapport, j'obtiens pour la série 2009-2013 (effet TGV Rhin-Rhone pour 2012 2013 non isolé) Chiffre d'affaires 4,4 4,6 4,8 4,9 4,7 Charges * 3,4 3,7 4,0 4,2 4,1 * chiffre d'affaires multiplié par (1-taux de marge) Péages activité 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 (rien n'est dit sur les péages économisés sur les intercités supprimés par le TGV RR) autres charges 2,0 2,2 2,3 2,4 2,2 variation de 10% sur 4ans, effet TGVRR compris, soit 2,4% par an, pas 6,2% On voit même que les autres charges sont les mêmes en 2013 avec Rhin Rhone qu'en 2010 sans Rhin Rhone. 5) Sur la recommandation de restreindre les dessertes TGV sur voies classiques : si c'est pas par TGV, comment le groupe SNCF amène-t-il ses voyageurs de Lyon à Grenoble, et dans quel cadre juridico-financier ? Région politique est souveraine pour les transports réguliers de voyageurs internes à la région, et elle n'a pas vocation à résoudre les problèmes financiers de la SNCF, surtout compte tenu de ses problèmes financiers à elle. 6) Le discours sur la grande vitesse japonaise ne tient pas compte des volumes de population le long des corridors (le Japon ne peut être un modèle, c'est pas tout à fait la même urbanisation qu'en France), et il est inexact : il y a 15 gares intermédiaires sur les 515km du Tokaido Shinkansen entre Tokyo et Shin Osaka, çà rend le graphique opérationnel très beau :-)
-
le modèle économique du TGV en difficulté
Je pense qu'il faut distinguer : - le rapport lui-même : une des missions de la Cour des Comptes est de s'assurer du bon emploi de l'argent public et donc des fondements des décisions des décideurs publics, dont RFF et SNCF (la très vieille, la vieille et la nouvelle) ne font juridiquement pas partie. - ce que vont en dire ou en ont déjà dit journalistes, personnel politique et groupes de pression divers. Le débat est libre, il y a des tribunaux si des limites sont franchies. Mais des avis variés et contraires, parfois exprimés avec violences verbales dans le feu de la passion et de l'inquiétude, le fait est qu'il y en a : chacun voit midi à sa porte, et défend son bifteck, dans tous les domaines. Sur le rapport lui-même, et sans aller plus loin que le communiqué, la liste des biais citée est à mon avis bien connue des acteurs et observateurs intéressés. Par exemple, symbole des pressions politiques, le discours "Une capitale régionale sans aéroport, TGV, orchestre / opéra et "université de haut niveau" est rayée de la carte par les grands cabinets conseilleurs d'implantations internationales" est commun en France, et relayé dans les collectivités locales de niveau plus "modeste", qui "mettent au pot" contre engagements de desserte. En jeu, l'emploi, l'emploi, l'emploi (les élus relaient toujours cette préoccupation de leurs électeurs, sinon...), et la venue de CSP+ (catégories socio-professionnelles "supérieures" et "leaders d'opinion") pour "redorer l'image" de la ville concernée. Toulouse va très probablement utiliser le Nobel de Monsieur Tirole, comme Grenoble à son époque avec Monsieur Néel. Dire que le financement des lignes décidées n'est pas aujourd'hui pas assuré est malheureusement exact (la pirouette, sur ce sujet comme sur d'autres, étant de retarder la mise en service) Et dire que les choix doivent être entourés de plus de pertinence et de rentabilité est à mon avis du gros bon sens (dans la limite des pressions exercées sur les politiques par les électeurs et les multiples représentants d'intérêts divers : on ne va pas jeter à la poubelle la démocratie à cause de ce défaut bien connu, mieux vaut pour réélection ne pas caresser le peuple local dans le sens contraire de son poil)
-
le modèle économique du TGV en difficulté
5 documents, de taille croissante, du communiqué de presse de 2 pages au rapport de 173pages, disponibles ce jour sur le site de la Cour des Comptes https://www.ccomptes.fr titre du rapport "La grande vitesse ferroviaire : un modèle porté au delà de sa pertinence" En super-synthèse (résumé n'engageant que ma lecture rapide du communiqué) Le processus de décision... comporte de nombreux biais... favorisant le choix de la grande vitesse. La rentabilité socio-économique des LGV est systématiquement surestimée. Le choix de nouvelles lignes doit être entouré de plus de garanties de pertinence et de rentabilité.
-
MOOC Massive Open Online Cours: génial !
Même typologie d'étudiant ou non : le débat existe. Tu peux être étudiant "normal", provisoirement éloigné du campus pour tel ou tel motif familial ou médical, mais capable de bosser chez toi (peut-être au ralenti). Plus la formation tout au long de la vie. Pour l'instant, je n'ai rien lu qui envisage la fermeture de l'établissement physique constructeur de MOOC. Dans certaines matières, où il n'y a pas de travaux pratiques, tu peux trouver en ligne le cours du prof, ce qu'il faut lire pour chaque chapitre, les indications sur les travaux à rendre, et un forum où poser les questions sur ce que tu n'es pas sûr d'avoir compris, avec assurance d'être lu par un "instructeur" proche du prof ou un étudiant meilleur que toi. Tu peux alors te présenter au contrôle continu à distance quand tu te sens prêt (éventuellement dans le même calendrier que les élèves de l'établissement). Si c'est un questionnaire à choix multiples 20 questions, réponse à rendre en temps informatiquement limité, résultat immédiatement inscrit dans ton dossier. Problème non résolu : corriger les travaux plus complexes (devoirs scientifiques, dissertations, etc.) rendus par 10 000 étudiants à distance (pistes de solution en cours de test) La différence avec les cours réels, c'est que ce n'est pas la peine de venir de loin dans l'établissement du monde réel (temps, coût), c'est que tu peux prendre ton temps pour passer les 10 à 15 matières constituant le programme du semestre de l'établissement réel, et que tu peux faire certifier la seule matière qui t'intéresse (complément de formation pour adulte, par exemple). Tu as une moindre charge de travail si tu découpes, mais tu n'as pas l'émulation du groupe créée par la pression d'un programme très chargé et de haut niveau et par la vie en commun étudiants, professeurs, instructeurs et tuteurs menée sur les campus de type USA les plus renommés, avec naissances de réseaux professionnels, d'amitiés pour la vie, et plus si affinités. Il y a des réflexions sur l'ouverture, en Afrique ou Asie, de centres accrédités pour les travaux pratiques avec présence d'un tuteur. Parenthèse, tu évoques l'argent dans les plus grandes universités américaines, toutes ont des programmes de soutien financier (plus ou moins fort selon les ressources familiales) des étudiants repérés comme "de profil intéressant" par le jury d'admission (et y a pas que les notes qui sont prises en compte, loin de là). L'argent amassé et placé depuis 300ans par certaines vieilles universités (pas d'équivalent en France alors par exemple que l'école des Ponts a été créée en 1747), les contributions des "anciens" ayant plutôt bien réussi dans la vie au sens financier et les profits des activités lucratives de l'université servent en particulier à çà. Plus les emprunts que peuvent faire les étudiants de niveaux plus avancés, quand le banquier a des résultats universitaires passés disponibles pour juger de l'individu et de ses capacités à finir son diplôme et d'avoir un très haut salaire à sa sortie. Je suis avec intérêt le sujet des MOOC ailleurs et en France (y compris comme cobaye) : l'histoire n'est pas écrite, qui vivra verra :-)
-
MOOC Massive Open Online Cours: génial !
Je suppose que par anglo-saxonnes tu entends essentiellement USA et Grande Bretagne, et pas Dresde en Saxe, qui a depuis longtemps, avec l'Institut Friedrich List, une université de Transports renommée, déjà à l'époque de "l'Etat Socialiste des Ouvriers et des Paysans de langue allemande" (RDA pour faire court). Je ne vois pas en quoi les MOOC feraient dégringoler de leur piédestal les meilleures (je préfère meilleures à prestigieuses) de ces universités : "meilleures" au sens de la qualité des enseignants et des étudiants (les deux groupes choisis dans le monde entier par des processus extrêmement compétitifs), et au sens des moyens qui sont mis à leur disposition. Cà se voit ensuite à la sortie des diplômés. Les organismes de recherche et les entreprises ne subventionneraient pas ces universités et ne recruteraient pas leurs étudiants s'il n'y avait pas du "résultat" en fin de formation et dans les labos de recherche. Situation actuelle (balayage rapide des deux sites) : environ 70 MOOC sur FUN en France, plus de 2200 cours du seul Massachussetts Institute of Technology disponibles gratuitement en ligne. Dans MOOC, il y a M pour "massive" !
-
MOOC Massive Open Online Cours: génial !
Bien d'accord sur le fait que le MOOC apporte les qualités indiquées ci-dessus. Plus l'existence de forums vivaces enseignants / étudiants et entre étudiants (naissance spontanée d'un réseau de "grands frères dévoués") Plus dans une certaine mesure la déconnexion entre le calendrier du MOOC et celui de la vie universitaire ( en formation dans un lieu physique, si urgence professionnelle ou familiale le jour de l'exam de ta formation externe, tu repiques l'année d'après) Cela dit, çà fait un certain temps que les entreprises internationales ont des simili-MOOC en interne (par exemple pour former "en temps réel" aux nouveaux produits et procédures des collaborateurs dispersés dans le monde entier, plus piqûres de rappel) Quelques sujets en cours de débat (ce qui est normal pour un produit récent, plus récent en France qu'aux USA d'ailleurs) - La "gratuité" pour l'utilisateur final (selon la célèbre formule "quand c'est gratuit pour toi, c'est que c'est toi le produit", Coursera n'est pas un philanthrope) - La concurrence entre établissements (grands et petits), entre enseignants (vedette mondiale du sujet ou enseignant solide mais n'ayant jamais travaillé sa notoriété), entre pays (par exemple couverture de l'Afrique francophone par des cours français ou par des cours canadiens francophones). Derrière, il y a bien sûr le problème de l'argent que l'établissement créateur du MOOC peut y mettre (bon, c'est déjà vrai dans le monde réel pour les effectifs d'encadrement, les labos, les bibliothèques physiques et numériques, les installations du campus autres que scolaires, etc.). Sur ce qui existe en France, il y a déjà des exemples où l'on voit bien la différence entre établissements "pauvres" et "riches" : dans le monde occidental tel qu'il est, à qualité égale sur le fond, le public libre de ses choix fuit si la "mise en scène" est minable - La certification (suivre un cours par intérêt personnel est une chose, avoir besoin d'une validation pour acquérir un certificat à mettre au CV en est une autre). Comment noter 5 à 15000 étudiants ? Noter le fond ou bien noter la facilité d'expression / compréhension dans la langue du MOOC quand celui-ci a des suiveurs dans le monde entier ? Au-delà du questionnaire à choix multiples corrigé automatiquement, il y a des matières où la vérification de compréhension se fait par des travaux pratiques, ou par la présentation par l'étudiant de travaux personnels élaborés - Le traitement des étudiants physiques, qui ont parfois payé cher leurs droits d'inscription pour assister au cours dont la vidéo est "offerte" sur le Net
-
Profil des voies
Comme indiqué sur sa couverture, le carnet que tu proposes est un scan de la dernière édition (1962) du "carnet de profils et schémas", à usage militaire, de l'ancienne région de l'Est (organisation SNCF avant 1972). Le carnet Est était le plus facile à trouver, car il en existait un stock important dans tous les dépôts de France : la convergence des mobilisés, des troupes, des matériels de guerre, des vivres, puis les mouvements des trains de permissionnaires et des trains sanitaires pour évacuation des blessés était organisée vers et de la région Est, dont le carnet devait être disponible pour les mécaniciens de la France entière. On voit bien sur la carte page 3 les arcs de cercle successifs de défense (Sedan-Nancy-Epinal, Sedan-Verdun-Chalindrey, Amagne-Revigny-Chaumont, Reims-Chalons-Troyes, plus disparu en 1962 Compiègne-Esternay-Flamboin). L'Est avait les installations utiles à 'organisation des arrivages / expéditions, par exemple : faisceau de Connantré (planche 159), immense gare de triage ; quais militaires dans plein de gares, multiples raccordements par exemple à Troyes (Pl38) , Dun Coulcon (pl 113, installations disparues en 1962, très grosses lors de l'alimentation de Verdun), etc En plus des installations, règlement de voie unique particulier en "zone civile" (la "zone des armées" étant exploitée par les militaires et faisant l'objet d'une organisation particulière, la limite entre zones bougeant en fonction des combats). Bon, manque de chance, c'est le Nord qui a le plus "dégusté" en 1914-1918, et qui a tenu à bout de bras, avec peu de lignes et bien moins de moyens préparés à l'avance que l'Est, l'alimentation militaire franco-anglaise aux moments les plus critiques. Bien entendu, ce carnet a été scanné par un certain nombre de passionnés, pour usage personnel, cadeau aux amis, ou vente. Je n'ai pas d'adresse à proposer sur le net. Encore une fois, pour usage aujourd'hui, çà commence à dater, même si la partie "profils" ne bouge pas tant que çà.
-
Profil des voies
depuis 2009, est paru l'ouvrage suivant (sur papier, sans édition électronique alors que le sujet s'y prête) Reinhard Douté, Les 400 profils de lignes voyageurs du réseau ferré français, Paris, La Vie du Rail, 2011, 2 volumes (238 + 239 pages) L'auteur a un site de mise à jour (qui permet le signalement d'erreurs). Un ajout concernant les autres lignes est en préparation. Par rapport aux anciens carnets de profils à usage militaire (guide des conducteurs leur permettant de conduire sur toutes les lignes en cas de besoin), il n'y a pas de schéma des grandes gares. indications données : vitesse maximale tronçon par tronçon (y compris réductions ponctuelles pour courbes), schéma de ligne avec dessin très simplifié des gares de bifurcation, rayon des courbes (pas d'indication de direction vers gauche ou droite dans le sens des PK croissants), PK au mètre près des points remarquables, altitudes, repérage des PN, tunnels et viaducs, profil en long
-
Ecopaturage : des chèvres et des moutons pour l'entretien des lignes
Pour en revenir à nos chèvres ou plutôt à nos moutons, accompagnant il y a fort longtemps en "touriste autorisé" la desserte de la noble ligne de Pontaubault à Saint Hilaire du Harcouët dans la Manche (trafic restreint 3 jours par semaine si mes souvenirs sont exacts), j'ai assisté à la procédure suivante, qui apparemment ne figurait pas dans la Consigne de Ligne officielle : Arrêt devant une clôture en double fil de fer barbelé barrant la ligne, deux poteaux de bois de part et d'autre du gabarit (on sentait le professionnel du gabarit : ce qu'il faut pour passer, rien de plus) Ouverture de la partie de clôture utile (dispositif là aussi très professionnel pour ne pas se prendre les doigts dans les barbelés en les repliant et pour les accrocher en position clôture ouverte), pénétration dans l'enclos (désert en ce moment précis), nouvel arrêt pour ouverture de la clôture de sortie 300m à 400m plus loin, sortie de l'enclos. Au retour, fermeture des deux bouts de clôture. Explication donnée par l'équipe de conduite et desserte, d'un ton montrant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le jeune touriste ne trouvait pas la situation parfaitement normale : "ben, c'est pour les moutons désherbeurs du chef de district" (ligne proche des Prés salés de la baie du Mont Saint Michel). Destination des produits de l'abattage non tirée au clair (pas mes oignons) : méchoui de l'équipe Voie ou vente aux profits des "bonnes œuvres" locales ?
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
réponse à Pimouss36013 du 20 07 02:22 [Promis aux modos : fin ici du HS sur Block PD pour moi. j'essaierai de faire pendant l'"année scolaire 2014 2015" un fil le plus clair possible sur le block PD en rubrique Infra si....les conditions le permettent :-)] S'agissant du block PD, tu as presque tout bien compris, mais surtout ne mélange pas les appellations, formes et significations des signaux PD avec celles d'autres signaux. Cà n'a plus d'importance maintenant puisque le block PD n'existe plus, çà a eu beaucoup d'importance lors de la fin du block PD et le passage progressif en BAL, qui s'est fait de façon compliquée (traitement des "grandes gares" à la faveur de la création de postes d'aiguillage modernes) et parfois aléatoire. En ligne en effet, le remplacement s'est parfois fait canton PD par canton PD, suite aux effets des manifestations viticoles. J'ai déjà dit ailleurs que j'ai toujours été très surpris :-) de constater que seuls les signaux PD étaient sciés, pas les panneaux de BAL nouveaux. Boîtes vitrées de 1,10m de haut, vite récupérées par collectionneurs avec fourgonnette, mais...attention aux nids de guêpe !!! Les signaux de block PD étaient au nombre de deux, SPD et DPD, à forme très particulière en signalisation mécanique, à plaque d'identification SPD ou DPD en version lumineuse (les dernières années dans certains endroits) Le DPD n'était pas remplaçable par un signal circulaire à plaque d'indentification D. J'ai écrit que le DPD fermé commandait la marche à vue, ce qui réciproquement indique que le DPD ouvert libérait de l'obligation de MaV (et de celle-là seulement), mais çà va mieux en le disant explicitement. Je n'ai pas dit jusqu'où s'appliquait la MaV après franchissement d'un SPD fermé (premier signal de block PD rencontré ouvert, d'où l'importance de l'appellation "signal de block PD") . DPD fermé n'impliquait pas nécessairement MaV jusqu'au SPD suivant, en cas de DPD successifs (notamment en arrivant dans les "grandes gares"). Le sémaphore d'entrée de gare (SPD "G") n'était pas un signal de block PD, même si la forme de sa boîte était identique à celle du SPD (+lettre G noire sur fond blanc sur le mât). Comme tu le dis, il ne donnait pas d'indication sur le cantonnement aval, mais je précise qu'il était fermé si la zone de gare (entre SPD "G" et SPD) était occupée. En block PD, pour les gens des gares et de l'entretien des signaux, il y avait lieu de bien distinguer les notions de "signal fermé" et de "signal bloqué" (par le fonctionnement automatique du block ou par action sur la clé de gare). Un signal fermé (position normale des signaux) et non bloqué pouvait être ouvert automatiquement à tout moment par un train approchant.
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
A rzm 17:25 Merci pour ta précision. L'appréciation ne concerne que le système technique "nominal" résultant des études d'accréditation du système et de ses composants (que la justice peut demander pour savoir ce qui a été pris en compte comme situations dégradées) Restent toujours à mon avis : l'examen de la conformité entre système nominal et système implanté sur le lieu de l'accident l'examen du système global (appareillages, agent d'entretien, environnement), et la compréhension de son évolution pendant la période critique de X secondes pendant laquelle le conducteur a vu du rouge, puis du vert stable, ce qui l'a conduit à franchir. Encore une fois, enquête difficile, tant pour les experts internes RFF /SNCF que pour les experts judiciaires
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
rzm 15:17 a dit "on part d'un principe que le système est fiable". Je ne sais pas qui est le "on". Un autre "on" pourrait partir du fait qu'une situation donnée en un lieu donné en un jour donné a conduit à un accident qui aurait pu coûter des vies. Quelques réflexions : Une chose est le système "nominal" de principe et les études et vérifications (y compris inventaire des situations dégradées étudiées) qui ont conduit à l'autoriser sur RFF (et /ou déjà sur la SNCF d'avant 1997), comme système incluant des composants individuels eux-mêmes autorisés (objets élémentaires situés dans l'armoire de signalisation, balises, câbles, etc) Une seconde chose est le système tel qu'en place sur les lieux à la date de l'accident (depuis 2008 si j'ai bien noté, plus modifications apportées depuis) : recherche de différences éventuelles avec le système nominal "national" Une troisième chose est la situation au moment de l'accident : signal signalé en dérangement (rien ne dit sur ce forum qu'il venait d'être redonné "bon"), intervention humaine en cours, causes du dérangement pas forcément uniques (certaines déjà traitées par l'agent d'entretien, d'autres peut-être non car non-diagnostiquées au moment du franchissement), effet de la météo (forte chaleur signalée, quelle température dans l'armoire de signalisation, les balises au sol, etc. ?) Enquête difficile quand la situation à comprendre n'était pas statique
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
Le mot "disculper" revient un certain nombre de fois. Je comprends l'émotion, mais la justice ne fonctionne pas comme çà. C'est le contraire : on peut être mis en examen ou placé sous statut de témoin assisté, et c'est une décision de juge d'instruction, pas de procureur. Le procureur peut "présenter" une personne au juge d'instruction à partir des éléments de son enquête préliminaire. Le conducteur de la Z2 n'a pas été présenté à un juge d'instruction à l'issue de son audition. Au stade actuel, ce qu'on sait par la presse est que le parquet de Pau mène une "enquête préliminaire" et qu'il a annoncé l'ouverture d'une "information judiciaire", confiée à des juges d'instruction (rien vu encore dans la presse sur leurs noms). Dans cette nouvelle phase, les points média resteront confiés au parquet. L'enquête interne à RFF et à la SNCF a lieu dans le cadre de leurs procédures internes. Elle a selon moi pour objectifs (liste non exhaustive): 1) comprendre, pour permettre de prendre les mesures de prudence à court terme et celles devant permettre d'éviter le retour 2) préparer les dossiers d'audition par la justice 3) préparer la communication "grand public" externe dans un contexte où la crédibilité technique médiatique de RFF et SNCF est évidemment écornée (discours tenu suite aux fuites de Brétigny malheureusement démenti dans un très bref délai par le fait de Denguin). Personne ne nie que RFF et la SNCF ont en interne des experts pointus à différents niveaux, chacun dans son propre domaine. Ils peuvent être directement auditionnés, en tenant compte du fait qu'ils sont dans une certaine situation de rapports hiérarchiques internes. Des experts externes seront probablement nommés par les juges d'instruction, la procédure sera contradictoire...et longue. Il n'y a qu'à la fin qu'on saura s'il y a non-lieu (pas de faute pénale) ou renvoi de certains devant une chambre de jugement. Tous les autres ne sauront qu'alors qu'ils sont "disculpés". BEA-TT poursuit un but pédagogique, mais le rapport peut être versé au dossier d'instruction, comme ceux d'autres organismes (ex: CHSCT).
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
Côté communication au public du point de l'enquête judiciaire ouverte pour "blessures involontaires", voir compte-rendu de la conférence de presse donnée samedi par M Sébastien Ellul, vice-procureur au parquet de Pau sur le site de La République des Pyrénées (édition de ce matin). Mon copier coller ne fonctionnant pas, je recopie le point qui me paraît le plus important : "les premiers éléments de l'enquête établissent que le train s'est arrêté au feu rouge, puis qu'il est reparti suite à un changement de signalisation, ces éléments ne dépendant pas uniquement des déclarations du conducteur." Pour répondre à Nipou, ce n'est pas à la Direction SNCF de "disculper" le conducteur, mais à la justice. L'enquête judiciaire cherchera évidemment à établir les responsabilités des personnes morales RFF et SNCF, et de leurs divers agents. Les "déclarations médiatiques" SNCF et RFF sont une chose, les déclarations signées par leurs représentants lors des auditions liées à l'enquête judiciaire sont une autre chose. Etant par ailleurs précisé que les déclarations médiatiques peuvent être versées à l'enquête, ce qui peut expliquer la prudence actuelle des deux institutions en matière de communication "officielle".
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
Merci pour cette réponse rapide à mon (a) :-)
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
Dans ce que nous a dit Korben, qui est Tarbais et a des renseignements précis sur les dires du conducteur de la Z2 que je n'ai pas de raison de mettre en doute : 1) le conducteur s'est arrêté devant un feu rouge 2) il a vu le feu passer au vert avant tout contact avec le correspondant situé au bout du téléphone du signal (il semble que le signal en dérangement soit en pleine ligne, les locaux pourraien nous confirmer que le correspondant est le régulateur, et non un agent-circulation de gare). Aucun post n'a dit le temps passé entre instant d'arrêt et instant de passage au vert, mais si le conducteur n' a eu aucun contact, çà n'a pas dû durer longtemps. Le feu vert semble être resté stable entre le moment où le conducteur a vu du vert et celui où il est passé au delà du signal. Donc, il y a eu X secondes de vert constaté par le conducteur, X pas très grand 3) il est reparti à VL puisque feu vert 4) le conducteur a été interrogé pendant 2 heures On peut supposer que les 3 premiers points sont ce que le conducteur a dit dans le cadre d'une enquête à vocation judiciaire, le point 4 permet de penser que le conducteur a pu maîtriser son état de choc, sinon les gendarmes ne l'auraient pas gardé. Ses déclarations rapportées par Korben ont donc du poids. Donc , mon soutien en tant que membre du forum à ce conducteur et à tous ses collègues appelés à rouler prochainement sur cette section de ligne On a moins parlé de l'agent d'entretien, sauf dans le communiqué mis en ligne par Pepe. Sait-on si lui aussi a été interrogé par les gendarmes et dans quel état il est actuellement ? Soutien aussi à un moment où il en a probablement bien besoin. On reste avec l'interrogation sur le pourquoi des X secondes de feu vert. Il n'y a aucun post sur le forum disant que l'opération de relève d'incident était terminée du point de vue de l'agent d'entretien. Questions aux gens connaissant le coin et la règlementation actuelle concernant la relève d'un incident sur signal "en ligne" (par rapport à un signal dépendant d'une gare ouverte) a) qui aurait été le correspondant au bout du téléphone du signal en dérangement si le conducteur s'en était servi : régulateur ou agent-circulation d'une gare voisine ? b) l'agent d'entretien passe-t-il par le téléphone du signal pour communiquer avec celui qui autorise son intervention sur un tel signal, et pour rendre la voie comme "bonne" après cette intervention ?
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
A Inujust R. 23:29 La question de Mikado43 portait sur les BM (Block Manuels) Le BAPD (Block Automatique système Paul et Ducousso) d'origine ancien réseau du MIDI était un block automatique. En bloc (appellation Midi) pur, deux signaux :Sémaphore PD (SPD), signal de cantonnement, Disque PD (DPD), signal d'annonce qui, fermé, commandait la marche à vue de l'époque (sans Vmax 30km/h) En cas de canton aval libre et hors dérangement, les signaux étaient ouverts par le train lui-même approchant du poste de cantonnement (très impressionnant de nuit dans la grande ligne droite des Landes) Franchissement du SPD fermé à l'initiative du mécanicien, puis marche à vue La panoplie PD était complétée par le Sémaphore PD d'entrée de gare (SPD "G"). Ce signal n'était pas un signal de cantonnement : ouvert (automatiquement par le train), il permettait au train de poursuivre dans les mêmes conditions qu'en amont du signal. L'agent-circulation de la gare disposait d'une "clé de gare" à 4 positions permettant de bloquer en position de fermeture le SPD et/ou le DPD le précédant (qui outre sa fonction d'annonce du SPD, était aussi annonciateur du SPD "G"), les 4 positions de la clé étant : (1) disque bloqué (2) disque et sémaphore (SPD"G") bloqué (3) disque bloqué, sémaphore (SPD "G") bloqué jusqu'à la petite section (4) Voie libre La petite section était une courte section avant le SPD "G" dont l'occupation par le train réouvrait le SPD "G" si la clé de gare était en position 3.
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
à Ae8/14 15:51 Je ne suis pas sûr que bafouillages et approximations soient totalement volontaires. Un certain nombre de gens d'origine technique sont peu habitués à prendre la parole, en particulier parce que le "grand communicant" de leur entreprise ou organisme, et "bon client" systématiquement invité par les médias (audience oblige, n'est pas nanard tapie qui veut), s'en charge d'habitude. Quand il doivent le faire, leur malaise crève les yeux des spectateurs (habitués à voir des "bons"), surtout s'ils ont eu peu de temps pour préparer un discours "grand public" alors qu'ils ont le nez depuis des heures dans le côté technique de l'incident, avec des informations parcellaires, certaines contradictoires, et variant dans le temps (avec parfois effondrement des hypothèses précédentes), parfois très vite. Sur la question de "connaître son affaire sur le bout du doigt" en interne, chacun a eu la vie qu'il a eu. Je me suis déjà servi de l'image du chef d'orchestre : il n'est évidemment pas capable de remplacer n'importe quel instrument, et même s'il a été violoniste avant chef d'orchestre, il ne l'est généralement plus aujourd'hui au même niveau. Et, une fois devant le public, "moteur", "çà tourne", il ne peut pas arrêter pour demander un complément à un collègue plus pointu que lui sur le sujet. Ya qu'à l'assemblée nationale ou au sénat que le ministre a dans son dos un paquet de collaborateurs twittant sans arrêt avec les sachants du ministère, et griffonnant des notes au ministre pour le sortir d'un mauvais pas.
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
En relisant ce que nous a dit cremadelles hier à 20:33, on peut penser que la chronologie à quelques secondes près, si elle peut être établie, sera riche d'enseignements. Nous avons 3 intervenants humains simultanés (agent d'entretien, régulateur, conducteur de la Z2), plus l'appareillage technique de signalisation lié au signal S'agissant du conducteur Z2, les derniers posts orientent vers "a vu l'avertissement fermé et a agi en conséquence, notamment en s'arrêtant devant le Sémaphore de BAPR au rouge ; a vu le signal passer au vert avant de prendre contact avec le régulateur, est donc reparti avec dans sa tête "voie libre", ce qui est une situation banale quand le train de devant n'est pas très loin Le régulateur, d'après tout ce qui précède, sait qu'une intervention d'entretien est en cours sur le signal, mais n'aurait eu aucun contact avec le conducteur Z2 venant de s'arrêter au pied du signal défaillant. Il n'a donc pu l'aviser que le signal était réputé en dérangement ni lui donner un ordre quelconque pour le retenir ou pour l'autoriser à franchir dans les conditions de canton de BAPR occupé. L'agent d'entretien "travaille dans son armoire" (on n'en sait pas plus sur ce qu'il était précisément en train de faire quand la Z2 était arrêtée au pied du signal). On ne sait rien de l'état de l'appareillage (hors tout effet de l'intervention d'entretien) dans le moment critique où la Z2 a été au pied du signal (cf fin du post de cremadelles)
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
A Fabr 11:38 (toujours pas de bouton "citer" actif) Rétablissement de situation intéressant la sécurité par un homme unique : c'est le lot habituel du conducteur seul qui prend des mesures de règlementation et/ou d'intervention technique sur des organes influant sur la sécurité comme le frein. Avec la pression de savoir qu'il y a des trains qui attendent derrière, avec prévision de bazar ponctualité majeur sur certaines lignes à certaines heures Plus, sur un train de voyageurs, pression psychologique (parfois coléreuse) des voyageurs (à quai, à la portière ouverte ou descendus sur le bas-côté) si "çà s'éternise"
-
Collision TGV-TER entre Pau et Bayonne (Denguin)
Complément à Mikado43 sur Flaujac Les dépêches passées à Flaujac étaient d'une forme supprimée après l'accident : "Bien qu'attendant train 1, j'annonce train 2" vers gare suivante dans le sens pair "Bien qu'attendant train 2, j'annonce train 1" vers gare suivante dans le sens impair Ces annonces étaient dans certains coins banales sur Voie Unique avant Flaujac, car elles libéraient le temps d'arrêt de toute contrainte liée au retour de l'agent-circulation au bureau pour passer des dépêches. Avec des autorails, les croisements pouvaient alors se faire selon le temps alloué : 1minute pour l'un des trains, 2minutes pour l'autre. Déroulé théorique : Minute 00 arrivée des deux trains, agent circulation présent en queue du deuxième à partir, vérifie signalisation d'arrière, remonte le train, efface signal d'arrêt à main retenant le premier à partir Minute 01 AC donne départ du premier à partir, vérifie signalisation d'arrière au défilé, efface SAM retenant deuxième à partir Minute 02 AC donne départ deuxième à partir Minutage théorique quand l'AC n'avait pas que çà à faire pendant les arrêts : annonce "aboyée" du nom de la gare, contribution fermeture porte autorail ou remorque, colis et bagages au fourgon, émargement carnet de valeurs du chef de train, info aux voyageurs sur quai, etc. Tout çà pour dire, bien d'accord avec Mikado sur le jeu des priorités multiples sur le cerveau humain. L'annonce conditionnelle n'a pas été la seule cause de Flaujac, situation plus complexe et inhabituelle (pas le lieu ici)