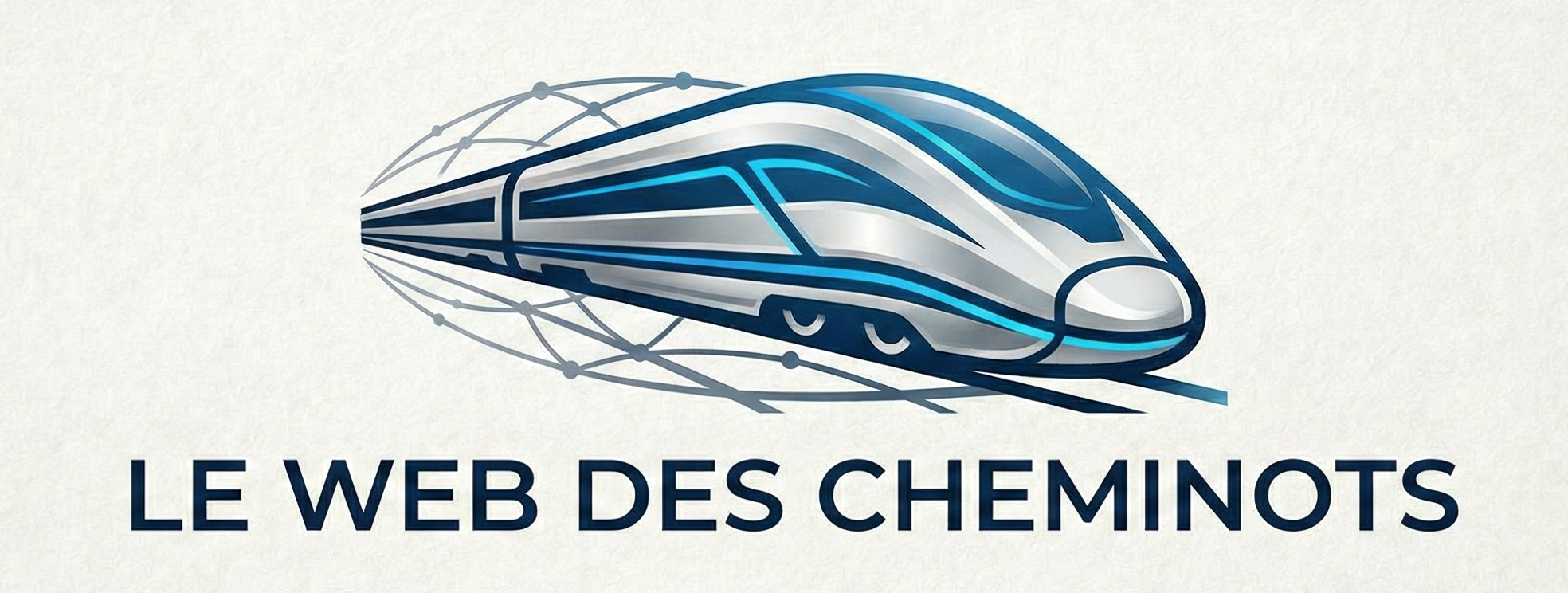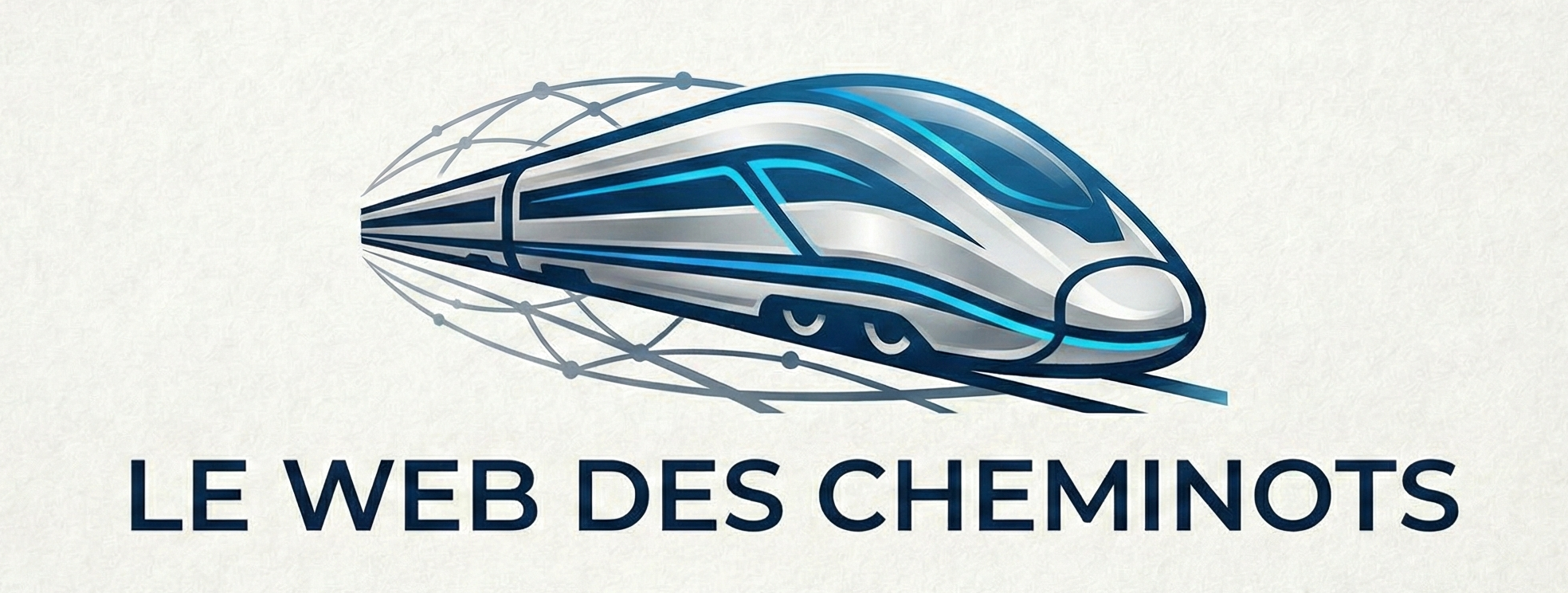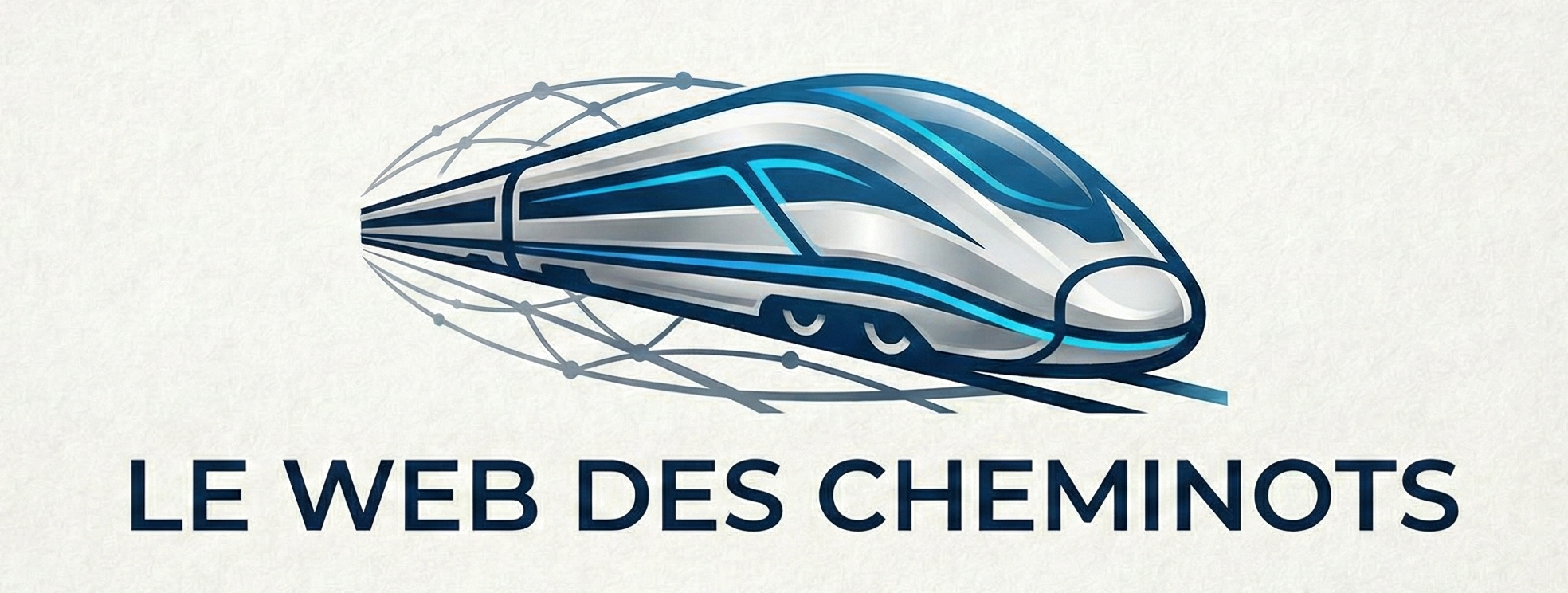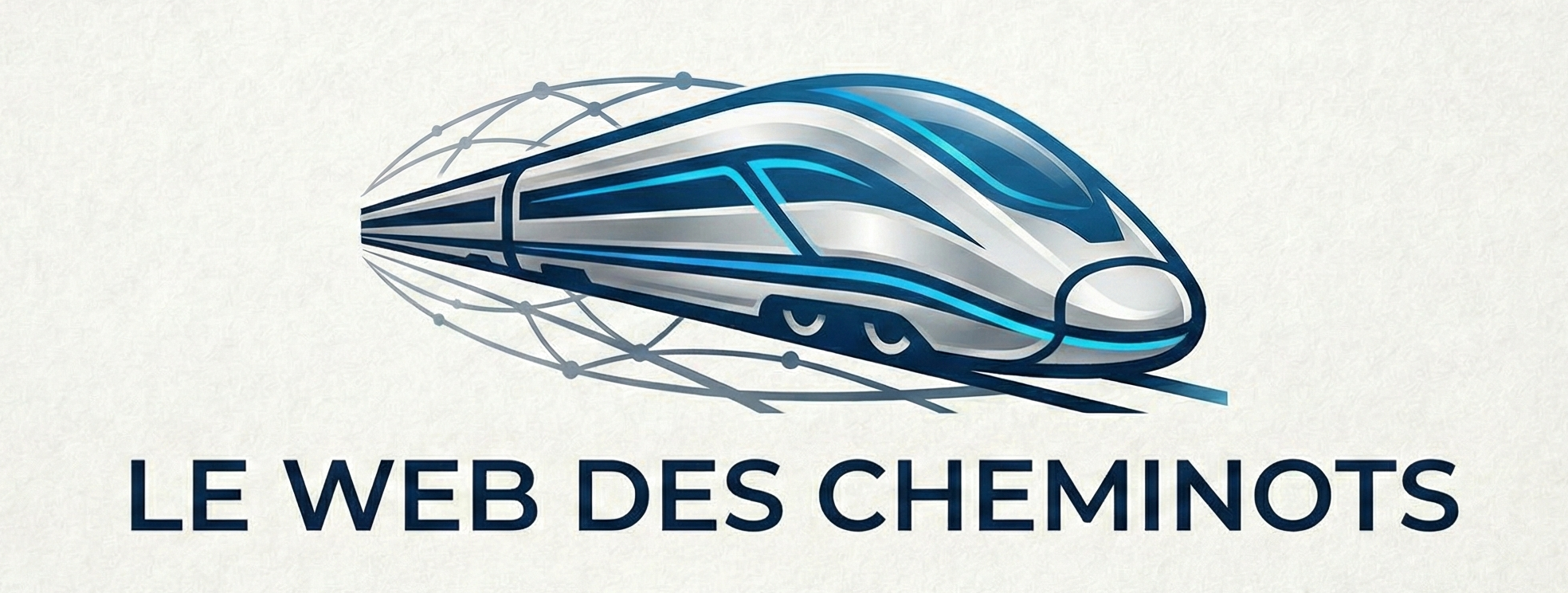Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
ligne la plus chargée de France ?
Salut, Pour répondre à ta question (que tu as également posée sur lineoz), il faut préciser le critère à prendre en compte car suivant que l'on regarde le nombre de trains par voie ou le nombre de trains global par exemple, les lignes ne seront pas les mêmes. D'une manière générale, hors IdF c'est à l'approche des noeuds ferroviaires importants qu'on trouve les infras les plus "circulées" (par exemple entre Coutras et Cenon en Aquitaine, la bif des Tuillerie et Marseille, Chagny et Dijon etc.). La consommation de capacité dépendant (entre autres facteurs) de la vitesse et du différentiel de vitesse des convois, on saturera le graphique avec un plus faible nombre de circulations sur des tronçons où l'hétérogénéité des vitesses est forte (exemple Tours-Bordeaux) que sur des zones parcourues à vitesse réduite donc plus homogènes sur ce plan (typiquement, à l'approche des noeuds ferroviaires). Christian
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Bonjour, Il me semble que tu as la réponse à ces questions sur Lineoz, auquel tu participes. La desserte RR n'induira qu'une augmentation marginale du nombre de circulations entre Paris et Pasilly car à cette échéance, tous les Paris-Dijon seront remplacés par des missions RR et la quasi-totalité des Paris-Besançon basculés sur la LGV. Le trafic sur l'axe va par contre croître de manière significative par rapport à aujourd'hui (remplissage amélioré et recours à du matériel Duplex). Il y a un vrai sujet sur la stabilité du graphique sur la LGV SE, la nouvelle trame de sillons mise en place par RFF au service 2012 se traduisant par un nouveau resserrement des circulations (on aura potentiellement jusqu'à 14 sillons par heure glissante en période de fort trafic) sans que la LGV ait bénéficié d'améliorations au niveau de sa signalisation, par rapport aux aménagements réalisés pour la mise en service du TGV Méd (qui avaient permis de passer de 10 à 12 sillons par heure en pointe). La diminution du nombre de circulations à V270 (entre Paris et Aisy) explique ce nouveau resserrement (par rapport à la grille RFF mise en place en décembre 2007) mais la reprise des travaux de régénération sur la LGV (concomitante avec la densification du graphique...) a montré depuis la fragilité accrue de l'exploitation dans ces conditions de fonctionnement (la régularité étant en baisse depuis 2 ans). Sur l'axe nord-sud de la desserte RR, il n'est prévu d'utiliser qu'à la marge la LGV SE entre Mâcon et Lyon (un A/R Strasbourg-Lyon mis en place en 2013 devrait l'utiliser, aucun en 2012, en situation nominale s'entend). Cela correspond à la demande de SNCF-Voyages (motif invoqué niveau des péages sur la LGV) mais aussi à la difficulté d'insérer des circulations entre Lyon et Mâcon dans la future grille de sillons de la LGV SE. L'utilisation du racc de Mâcon, du fait de ses caractéristiques et de celles de la signalisation (TVM 300), est fort consommateur de capacité donc nécessite des montages horaires très optimisés (devant ou derrière un arrêt Mâcon TGV par exemple, suivant le sens), dans une logique horaire systématique du moins. Christian
-
Eurostar veut renouveler ses rames.
Thor Navigator a répondu à FCNS situé dans SNCF Voyages : TGV inOui, Ouigo, Elipsos, Eurostar, Lyria, ThalysSalut, l'article et de ceux du même auteur (ou du moins repris sous le même thème) sur le site lepost.fr s'inscrivent dans la logique de dénonciation du TGV "train des riches", "avion sur rail", "hérésie environnementale et énergétique", dont un des héraut est Vincent Doumayrou (cité dans cet article), que plusieurs d'entre vous doivent connaître, par forums interposés (Sette Bello, Eurostar Italia, Wisconsin et autres pseudos). La référence au brûlot de P. Perri (truffé de contre-vérités, soit dit en passant) dans un autre article n'a fait que conforter mon impression quant à cette approche très orientée et franchement "à charge". Pour le reste, qu'on débatte du bien fondé économique et socio-économique du V360 sur LGV, c'est plutôt sain. Mais en ne perdant pas de vue que la seule réponse que semble avoir trouvé RFF pour limiter la dérive du coût des LN (sujet qui mériterait aussi débat) est d'en réduire les fonctionnalités, dont la vitesse maximale permise par le tracé (et bien d'autres choses)... Il est des approches plus constructives et ambitieuses. Mais bon, le constat est valable sur quasiment tous les projets touchant l'infra, comme sa maintenance (cf. la joute récente entre les deux EPIC sur le traitement du chantier de remplacement de rails sur la LGV SE au premier semestre 2011, avec la suppression décidée de 3 TGV pour limiter les impacts des (longues) LTV 160 sur la régularité). Christian
-
La TVM 300 : comment çà marche?
En TVM 300, l'affichage d'une VL éxécutoire (220 E par exemple mais ce pourrait être un autre taux) n'apporte aucune info sur la séquence suivante, restrictive ou non, rencontrée en aval, contrairement à la TVM 430 où avec une indication de même nature, on aura un clignotement au CAB si la suivante est susceptible d'être plus restrictive. L'absence de clignotement ne pose pas de problème, surtout avec des cantons de grande longueur. Une indication d'annonce restrictive ne peut être présentée qu'à l'entrée dans un canton, qui plus est (contrairement au prémonitoire ou à une indication moins restrictive) et est accompagnée d'un bip d'attention. Il n'y a donc pas vraiment d'effet de surprise. C'était le sens de ma remarque. On peut faire le même constat pour les indications d'annonce successives, sans clignotement en TVM 300. Il n'est pas demandé d'arriver freins serrés à la sortie du canton... bien que l'indication suivante puisse être dans certains cas restrictive : la longueur du canton et les performances de freinage du train permettent en effet au conducteur de réengager si nécessaire son freinage, la signalisation ayant été conçue sur cette base (beaucoup plus frustre que la TVM 430 numérique). Quand sur ligne classique, un train rencontre un signal au jaune non visible à distance (courbe, brouillard...), il se met en disposition de s'arrêter avant le prochain signal rencontré, sans avoir reçu d'indication prémonitoire. Le block est conçu sur cette base et le conducteur sait qu'il est en mesure d'arrêter son convoi dans des conditions normales. Il en va de même sous SACEM, autre forme de signalisation en cabine qui s'apparente à de la conduite sur ordre (avec comme avantage que l'indication de ralentissement est calculée en fonction des performances de freinage du matériel donc optimisée) : le conducteur voit s'afficher une vitesse but restrictive et est tenu de réagir sans tarder en engageant un freinage de service... Rien de traumatisant dans ce mode de conduite. Il n'est simplement pas optimal quand la présentation de la séquence de freinage n'est pas ajustée sur les perfomances du couple infra/matériel, avec le risque d'une conduite en accordéon inconfortable et pénalisante sur le débit aux vitesses élevées (car on ne remonte pas en vitesse rapidement, contrairement à un RER circulant à vitesse modérée). Le prémonitoire, bien utilisé, apporte de la souplesse.
-
La TVM 300 : comment çà marche?
C'est pourtant ce qui se produit dans certaines configurations sans poser de problème (séquence à 220 sur trois cantons avant une LTV 160 par exemple). Et historiquement, l'indication d'annonce commandait au conducteur de ne pas dépasser la VL prescrite à l'entrée dans le prochain canton, pas nécessairement de freiner "au plus tôt" comme on le demande aujourd'hui (ce est peu pertinent quand on rencontre une séquence type 160/80/000 soit un arrêt sur 4000 à 5000 m). La TVM 300 a été conçue pour un matériel ayant des capacités de freinage moins élevées qu'aujourd'hui. Sur la LGV SE, les cantons ont une longueur importante (à part dans les fortes rampes mais la gravité facilite alors la décélération) et en conditions nominales de circulation, un TGV équipé du frein HP pas besoin de 2100 m pour passer de 220 à 160 ou même de 160 à 0 (bon, je triche un peu car l'indication n'apparaît pas en cabine au franchissement du repère mais un peu après, réalité évidemment prise en compte dans le dimensionnement d'ensemble du système). La suppression de l'indication prémonitoire sous TVM 300 ne serait donc pas problématique sous l'angle sécuritaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit souhaitable sous l'angle de la conduite et du débit (c'est un non-sujet en fait puisque jamais envisagé, à ma connaissance).
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Bonsoir, la montée de l'indication prémonitoire en cours de canton (et non au début) traduit simplement la présence de retardateurs au niveau du poste ou du CAI, mis en place pour lisser les points durs du block. De mémoire, le critère impératif à respecter est d'avoir a minima 15 s de présentation de l'indication clignotante à VL, avant la présentation de la première indication d'annonce, moyennant quoi l'ajout d'un retardateur est autorisé. L'implantation de retardateurs n'est à mon sens pas assimilable à une évolution fonctionnelle de la TVM 300 (les principes de fonctionnement de la signalisation demeurent inchangés). Cette disposition a été bien utile pour améliorer le block et relever (partiellement) la VL de la LN1 à 300 (opérations connexes à la mise en service de la LGV Méd). Au passage, on peut rappeler que 'indication prémonitoire n'a pas de visée sécuritaire contrairement aux indications d'annonce ou exécutoires (elle permet d'améliorer l'ergonomie de la conduite et par suite le débit), d'où la relative souplesse existant quant à la présentation de cette indication au l'intérieur du canton (tempo mini à respecter, c'est tout). Christian
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Pas nécessairement sjmsb (mais ça date pour ce qui me concerne, donc j'ai conscience d'être en terrain glissant...). Il faudrait connaître la configuration précise des installations en voie dans ce secteur. D'autre part, le train qui reçoit l'information de TVM shunte le CdV sur lequel il circule, cela n'entraîne pas (pour lui) la présentation du RRR (derrière lui oui, sur le même CdV de par le shuntage réalisé vu du récepteur amont, sur les CdV suivants du même canton via la TVM). Pour mémoire, le canton tampon au niveau du block sur séquence d'arrêt normale (repère F) existe sur toutes les TVM. En TVM 300, on a bien un contrôle continu de la vitesse, mais en marches d'escalier (que le signal soit analogique au lieu de numérique, ça n'a ici qu'un rapport indirect [fonctionnalités plus limitées, mais le principe de base reste le même]). En l'absence de canton tampon (ou de séquence réduite ou minimale sur repère Nf), un train pourrait arriver à 169 km/h sur le canton occupé (sortie du canton présentant l'indication 000), ce n'était évidemment pas envisageable. Si l'émetteur est totalement HS... il va être difficile au récepteur du même CdV de confirmer l'absence de convoi... donc si il serait surprenant qu'un émetteur HS ne conduise pas à considérer le CdV comme occupé. + 1 ! Christian
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Pour la TVM 300, le bouquin "La signalisation ferroviaire" de R. Rétiveau (non réédité mais largement diffusé dans l'entreprise à l'époque de sa parution) décrit dans les grandes lignes ses principes constructifs au niveau infra. Pour la TVM 430, l'IN 1844 (si toujours disponible en chargement direct sur SYSPRE (*)) présente de manière très détaillée les principes fonctionnels et constructifs, notamment le découpage des CdV dans un canton et le lien entre l'occupation de la zone et la présentation du RRR derrière le train (grâce à un sous-découpage des CdV) pour une séquence de block de base (pp. 20 à 22). Je pense que la TVM 300 adopte les mêmes principes fonctionnels dans ce domaine. Au passage, on peut rappeler que l'absence de signal TVM capté par le train entraîne la présentation du RRR au CAB (logique sécuritaire). Christian (*) dans le cas contraire, contacte moi en mp
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Bonjour, la TVM a ceci de particulier qu'elle utilise -pour la transmission des informations continues du block- le même support (les rails) que les circuits de voie détectant eux la présence du convoi (c'est possible en positionnant les émetteurs en aval par rapport au sens de la circulation du train, le dispositif étant par ailleurs réversible du fait de la banalisation généralisée de l'infra). Ainsi, le fait d'avoir une détection d'occupation sur un canton n'implique en rien la présentation concomitante de l'indication RRR (pour autant que l'itinéraire soit dégagé en aval) sur le canton en aval du convoi... heureusement car sinon les trains ne pourraient pas circuler (ils auraient en permanence RRR au cab). Cela explique certainement le fait qu'un "faux positif" au niveau de la détection de présence du convoi n'est pas pénalisant une fois dans le canton... mais uniquement pour l'approche de ce dernier. A confirmer là encore car je ne connais pas le fonctionnement de la TVM dans le détail, au sens SES. Pour un spécialiste de l'Ingénierie spécialisé LGV ou au sein d'un établissement Infra LGV, c'est très certainement le B-A BA car ce type de défaut n'est certainement pas un cas isolé (d'autres cas similaires ont dû se produire depuis 1981). Christian
-
Problème d'alimentation électrique au pied du Salève
Salut, je serais plus prudent avant d'incrimer le seul TGV. Le sujet des installations de traction électrique insuffisantes (par rapport aux engins modernes et au trafic actuel des superpointes d'hiver) sont connus sur l'étoile d'Annmasse (il y a déjà eu des soucis -tensions basses- l'année dernière -ce n'étaient d'ailleurs pas les premiers- avec des UM de Duplex). Les TGV sont fortement bridés en puissance sur cette ligne (cran 1 en UM pour les Duplex et assimilés soit de l'ordre de 5 MW absorbés à la caténaire pour l'ensemble du convoi, bien moins qu'avec une Sybic non bridée par exemple). Une sous-sta ne tombe pas HS de longues heures durant uniquement parce qu'un train l'a un peu trop fortement sollicitée (les transfos sont conçus pour débiter sur une période limitée des intensités bien plus importantes que celles définies en régime permanent). Attendons les premières conclusions techniques puis le REX... Christian
-
Catalan Talgo
Il n'y a pas de point de vue "parisien" dans le cas présent, mais un constat bien réel, d'un projet que je connais bien pour avoir vécu plus de 20 ans en Rh-A. Le désenclavement autoroutier est bien souvent un mythe (les infras rapides qu'elles soient ferroviaires ou routières profitent principalement aux pôles majeurs existants qu'elles renforcent, pas aux petites villes et aux zones rurales). Il y a d'ailleurs moins de chomage dans les Hautes-Alpes que dans bien des départements irrigués d'autoroutes. Dans le cas de l'A 51, les solutions alternatives d'aménagement/amélioration des routes existantes sont possibles et connues. Je maintiens que réaliser une percée autouroutière à travers le Trièves est très contestable sur les plans économique, socio-économique et environnemental, tout comme le principe de mettre tous les points du territoire à moins de 30 min d'une autouroute (la France n'est pas un pays dense). On ne peut pas d'un côté vouloir promouvoir un développement plus durable et continuer à bitumer à tire l'arigot. Et il faut être cohérent dans un contexte de finances publiques très dégradées : investir à la fois dans les routes de manière massives et en faveur des modes moins énergétivores (au premier rang duquel le rail) est un non sens qu'on ne peut de toute manière plus se permettre (d'autant qu'on a réalisé ou mis à 2x2 voies plus de 10000 km de routes en l'espace de 40 ans !), La politique, ça consiste à faire des choix, pas à brosser l'électeur titulaire du permis du conduire dans le sens du poil. Les politiques français le comprendront t-ils un jour ? Christian
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Si je comprends bien ton explication, le canton C est considéré comme occupé par le poste, qu'il y ait ou non un convoi (d'où la séquence d'arrêt avec le 000 présenté dans le canton A puis le tampon normal [en l'absence de repère Nf]). Mais comme il n'y a aucun shuntage effectif du/des CdV en aval du convoi entrant sur C et que l'itinéraire est tracé et dégagé (en aval du C), le bord TVM capte l'indication "VL ligne" (ici 300 V) logiquement fournie par le block. A première vue, ce n'est pas une situation dangereuse mais elle pénalise l'écoulement du trafic et la tenue de l'horaire (puisque tous les trains doivent ralentir et entrer en marche à vue dans le canton B, y circuler en MàV et ne pourront reprendre leur marche normale qu'une fois arrivés dans le canton C... soit une grosse perte de temps [vu la VL basse imposée par la MàV... sur une distance qui peut atteindre 3 à 4 km en pente, sur la LGV SE]). Je dirais que le dérangement est manifestement dans le canton C (le B est en RRR ce qui est normal si l'information reçue conduit à considérer C comme occupé), au niveau de la détection du shuntage du CdV ou de son traitement. J'utilise le conditionnel car seul un spécialiste SES bien au fait du fonctionnement de la TVM 300 au sens "V" du terme (pas vu de la conduite ou de l'exploitation) pourrait te fournir l'explication précise (au besoin après vérification sur le terrain). Pourquoi n'avez-vous pas sollicité l'EVEN compétent sur le secteur ? Un forum, aussi spécialisé soit-il, n'est pas le media le plus approprié pour traiter (de manière fiable s'entend) de ce type de sujet. Christian
-
Frein RE
Salut, La langue française est compliquée, en particulier sur ce sujet (l'hydraulique), et il nous arrive tous de faire des fautes mais en général, on connaît l'orthographe de son (ex)métier... Pour ce qui est du coup de bélier, c'est plus la pente du front d'onde qui joue un rôle que sa valeur absolue et ses effets sont variables suivant la longueur de la conduite et ses caractéristiques, en particulier ses singularités (nombreuses sur un convoi ferroviaire). Christian
-
Catalan Talgo
Il y a quelques projets routiers qui ont eu une genèse difficile, voire se sont enlisés, mais ils ne sont pas majoritaires et durant les trente dernières années, le réseau routier (au sens large du terme) s'est étendu et modernisé de manière très importante, ce qui n'est pas le cas du ferroviaire. S'agissant de l'A 51, c'est un projet plus que contestable sur le plan économique et socio-économique, vu la densité démographique des secteurs concernés et la sensibilité des espaces naturels traversés. Ce qui pouvait le justifier au vu de la direction des routes, était une logique de transit, encore plus contestable vu qu'il existe d'autres itinéraires performants pour rejoindre le Midi, aux caractéristiques autrement plus favorable qu'une autoroute de montagne... La connexion à GV avec l'Espagne ne peut être classée dans la même catégorie que l'A 51. Christian
-
Catalan Talgo
Non bien évidemment. Mais on peut aussi rappeler que les projets ferroviaires réalisés dans les années 80-90 n'ont pas connu pareil sort durant leur phase d'étude. L'impression de gâchis est bien réelle pour Manduel-Perpignan et la LGV PACA, quand on voit les coûts actuels annoncés et les calendriers qui n'arrêtent pas de dériver. Même remarque pour les LN de la façade atlantique...
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Fonctionnellement, si l'on met à part l'aspect "double signalisation" mis au point pour le contournement de Tours, il n'y a pas de différence notable entre la TVM 300 équipant aujourd'hui la LGV SE et celle équipant la LGV A (la longueur moyenne des cantons en palier est inférieure sur la LGV A mais ça n'a pas d'incidence sur ce plan) Par contre, il y peut-être des différences sur le plan technique au niveau des schémas de montage des postes et en voie (sur ce point, seul un spécialiste signalisation pourra te répondre). Au niveau de la TVM 430, si les grands principes fonctionnels sont communs entre les différentes versions mises en services sur les LN européennes, la déclinaison d'un réseau à l'autre comporte des différences, par exemple au niveau de l'activation de certains taux de vitesse, des longueurs de base des cantons (l'écart est sans commune mesure avec celui ci-dessus), la séquence de freinage (qui peut être interprétée différent d'un matériel à un autre) etc. Un champ spécifique permet d'identifier le réseau, en TVM430. Au niveau du RFN, il y a eu quelques développements au fil des années mais fonctionnellement, rien de très significatif, à ma connaissance. Pour répondre à ta question, les seules indications fournies ne sont pas suffisantes, comme l'a précisé On Sight. Christian
-
Explications sur le KVBP
Relis le fil, tu trouveras la réponse.
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Il y a des BJ à Lyon Saint-Exupéry, sous TVM 300 mais la construction de la ligne remonte au début des années 90.
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Merci pour cette précision. L'évolution est donc relativement récente (les BJ sur les repères TVM, on n'en trouvait pas en TVM300 à l'origine). Certains (courts) ntronçons présentent un taux de VL inférieur à 270 km/h en vitesse de fond (chiffres sur fond vert).
-
La grande vitesse en Chine
La campagne d'essais V150 a pu aboutir grâce à l'implication d'Alain Cuccaroni à RFF (ex directeur adjoint de la LGV Est et actuel directeur d'opération de la seconde phase)... qui est un cheminot SNCF détaché et à qui l'on doit une grande part du pilotage des études du TGV Est, depuis l'origine (d'abord au sein de la SNCF). Il a su convaincre en interne de l'intérêt des essais et de la perspective d'un nouveau record pour le pays et le ferroviaire, face à des interlocuteurs peu motivés à quelques exceptions près. Lors de la campagne d'essais, vu que la mise en service avait déjà été décalée d'un an (ce qui avait suscité pas mal de critiques de la part des collectivités appelées à mettre la main au pot), la priorité absolue fixée par le maître d'ouvrage de l'infra et l'Etat était d'éviter tout souci au niveau des installations donc de conserver une marge de sécurité importante (en cas de dégradation des installations, la mise en service risquait d'être impactée). Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les derniers km/h sont les plus difficiles à gagner à un tel niveau de vitesse... La puissance à mobiliser croît comme le cube de la vitesse (P=FxV avec F>R(V) résistance à la l'avancement, qui est une grandeur en V² : a+bV+cV²). Il n'est pas certain du tout que les Chinois atteindront rapidement le chiffre symbolique de 600 km/h. Le plus dur reste à faire. Pour ce qui me concerne, c'est plus l'avenir de la GV en France qui m'inquiéte (cf. l'annonce récente de RFF sur la réduction possible des fonctionnalités du contournement de Nîmes et de Montpellier) et au-delà celui du chemin de fer, dans un contexte où les compétences "système" tendent à se faire plus rares, les coûts de construction et d'étude des projets touchant l'infra explosent (depuis une douzaine d'années) et l'exploitation perd globalement en efficacité. Un record du monde de vitesse a surtout une portée symbolique, même s'il permet aussi (c'est le plus important) de progresser sur le plan scientifique et technique. Christian
-
L’avenir du TER : des transferts sur route ? Avis de la FNAUT
Salut Jean-Marc, je pense qu'il n'y a pas de solution évidente à proposer mais une piste pourrait être de mettre en place une petite structure au niveau national qui intreviendrait en tant qu'autorité organisatrice et aurait la possibilité de déléguer cette mission, au cas par cas, aux Conseils régionaux (pour les relations entre régions voisines ou pas trop éloignées [par pour des OD de 500 km !]... ces dernières ayant déjà la main pour l'intrarégional). Un schéma directeur des relations interrégionales par autocar pourrait être élaboré en parallèle. Les dessertes seraient attribuées par appel d'offres, sur la base d'un cahier des charges fixé par l'AO, au sein de laquelle les associations de voyageurs seraient représentées. Dans les critères à prendre en compte pour la création d'une desserte routière interrégionale, figurerait le niveau et la performance de l'offre ferroviaire existante, l'idée étant favoriser une complémentarité avec le rail et non une concurrence frontale. Si je reprends un exemple qui m'est cher, je pense que le train a un avenir sur Nantes-Bordeaux, malgré le handicap du tracé peu direct entre La Roche/Yon et La Rochelle. Une infra modernisée mais non électrifiée conjuguée à un matériel automoteur performant permettrait de relier les deux métropoles entre environ 3h30, ce qui est compétitif par rapport à la route, même si ce n'est pas une performance digne du TGV. Je transférerais également la compétence des relations routières régulières intradépartementales autres que scolaires aux régions, afin d'éviter les doublons avec les TER et de mieux coordonner l'ensemble.
-
L’avenir du TER : des transferts sur route ? Avis de la FNAUT
Salut, contrairement à ce qu'on entend souvent, les dessertes régulières intérieures à moyenne/longue distance ne sont pas interdites mais soumises à autorisation préalable. L'objectif à l'origine était d'éviter d'assècher les comptes de la SNCF, via une concurrence frontale avec le rail. Le lobbying exercé par la FNTV en faveur de la levée de cette autorisation préalable a reçu quelques échos favorables de la part de certains élus, je pense notamment à Hervé Mariton (tout de même rapporteur du budget des TT à l'Assemblée donc acteur clé du système de transport en France), un temps annoncé futur secrétaire d'état aux transports. L'iFrap est un laboratoire d'idées (assimilable aux fameux think tank anglo-saxons) d'essence libérale (sur le plan économique du moins), donc sa position sur ce sujet était assez prévisible : la libéralisation est bonne par principe car elle fait baisser les prix et profite donc au consommateur... (ce qui me gêne chez eux ce n'est pas leur positionnement, chacun est libre de mettre en avant ses idées, mais le fait qu'ils aient réussi à obtenir le statut d'organisme reconnu d'utilité publique, ce qui est inadmissible quelle que soit l'orientation politique développée, pour un think tank). Vu les investissements collossaux engagés en faveur de la modernisation et du développement du réseau routier en F<rance depuis les années 60 et l'écart creusé avec le ferroviaire hors TGV et quelques grands axes, il est clair aujourd'hui que nombre de relations interrégionales pourraient être plus attractives par la route que par le rail, en particulier lorsque le réseau ferroviaire est pénalisé par des itinéraires peu directs (exemples : les lignes régionales construites à l'économie ou des transversales dont l'objectif était plus de mailler des radiales que de relier de manière performante les régions entre elles). Reste que même si le confort des cars s'est tres nettement amélioré avec les années, l'espace disponible à l'intérieur reste très limité (les versions pullman ou luxe ne sont pas destinées à des services réguliers, sauf cas particuliers rarissimes) et la sécurité des passagers à bord ne permet pas de bouger aussi librement qu'on le fait dans un véhicule ferroviaire. Vu sous ces deux angles, et quoiqu'on fasse, le car correspondra toujours pour moi à un équivalent de 3e classe ferroviaire (une "bonne" 3e classe, ok). Un développement encadré de relations routières, dans le cadre de missions d'intérêt général réalisées pour le compte d'autorités organisatrices de transport pourrait avoir du sens de mon point de vue, sur des relations où l'apport du car est vraiment manifeste et la perspective d'une amélioration rapide du service voyageurs (quand celui-ci existe) apparaît hors de portée à court terme (c'est en gros la position défendue par la FNAUT). Je suis par contre extrêmement réservé sur le principe d'une ouverture non encadrée de tels services, dans une logique de concurrence frontale avec le rail car c'est à terme la mort de bien des relations ferroviaires interrégionales sur le RFN. Ce n'est pas en affaiblissant encore une offre déjà en situation difficile et en contraction depuis des décennies qu'on rendra le système ferroviaire plus compétitif. Les relations interrégionales sont les grandes perdantes de la concentration du transporteur ferroviaire SNCF sur le TGV en matière de relations GL (Voyages est arrivé à ses fins avec la création des TET et la sortie des dernières relations non-TGV de son porte-feuille... cela aura pris une quizaine d'années) et de l'insuffisance de moyens consacré au réseau classique depuis la fin des années 70, alors que la configuration même du réseau français constituait un handicap structurel qui n'a été traité qu'à la marge, contrairement au réseau routier structurant (qui est aujourd'hui bien maillé, à quelques exceptions près). La solution visée par les partisans d'un assouplissement important du système, ce n'est pas la baisse des prix du ferroviaire (grace à la concurrence du car libéralisé) mais purement et simplement le transfert sur la route de nombre de dessertes ferroviaire interrégionales, afin de réduire la facture globale du système ferroviaire (position de H. Mariton). C'est donc un choix de nature politique et économique. Les pays dans lesquels le transport par car est libéralisé et important ont le plus souvent une offre ferroviaire GL limitée (cas de l'Espagne d'après-guerre avant l'arrivée de la GV... qui reste pour le moment un marché de niche, vu la politique commerciale de la RENFE), voire marginale (USA, Canada, pays d'Amérique centrale ou latine etc.). Le cas de la Suisse est totalement hors sujet puisque l'offre routière s'inscrit, comme celle ferroviaire de voyageurs à l'échelle du pays, dans un cadre fortement régulé et sans concurrence frontale (c'est la logique de complémentarité qui prévaut, la concurrence c'est avec la VP). La démarche évoquée ici ne tend pas du tout à évoluer vers le système suisse... Christian
-
Explications sur le KVBP
Sur la plupart des lignes, les normes de tracé n'ont été revues qu'à la marge, depuis l'introduction du KVB et la généralisation de la VISA. D'où une régularité médiocre et des effets boule de neige récurrents dans les zones denses (le graphique se couche comme disent les régulateurs). Si on resserre l'espacement avec l'introduction du KVBP, on améliorera certes les recettes de RFF mais la qualité de service ne s'améliorera pas car ce qu'on aura gagné en robustesse sera perdu (le risque est même qu'on perdre plus que ce qu'aurait apporté le KVBP à volume de trains constant). Gagner sur les deux tableaux du seul fait de l'introduction du KVBP n'est pas réaliste, Les contraintes ergonomiques imposées par le KVB n'auront pas toutes disparu et si vraiment on veut tirer le meilleur parti du débit potentiel des infra, il faudrait mettre en place une conduite automatique (cf. le projet Next porté par Transilien) ou a minima un système de freinage automatique (à l'image de ce qu'ont fait les JNR sur leurs shinkansen), tout en reprenant en parallèle la signalisation au sol là où elle n'est pas optimale. Tant que RFF ne sera pas responsabilisé quant à la qualité (robustesse + performance) de l'exploitation et que côté EF nous ne retrouverons pas l'efficacité passée, il sera difficile de progresser dans ce domaine. Le fait que le KVBP apporte une amélioration au niveau de l'exploitation (surtout en zone dense) est évidemment irréfutable... à condition de ne pas vouloir en même temps "bourrer le graphique"...
-
Explications sur le KVBP
Salut, le "P" de KVBP signifie "pour les prolongements" car le projet initial avait vocation à équiper les prolongements de lignes en IdF en complètant au sol le KVB par un système de réouverture continue à l'approche des signaux (visibles du conducteur) et en adaptant le bord en conséquence. Sur les zones couvertes par le KVB, le contrôle est déjà permanent (c'est une des raisons de sa non-transparence au niveau de la conduite, même s'il y en a d'autres liées à son paramétrage interne). Avec le KVBP, on passe du contrôle permanent à rafraîchissement ponctuel au contrôle permanent à rafraîchissement quasi-continu (pas tout à fait en fait car le système n'étant pas considéré de sécurité, les indications présentées ne sont pas assimilables à une signalisation de cabine, donc le conducteur doit toujours tenir compte d'abord de la signalisation au sol). Les boucles du rafraîchissement continu sont assurées via une transmission codée circulant par les rails (un peu comme la TVM ou le SACEM, sur ce plan). L'introduction du KVB (puis de la VISA qui a durci ses effets en lissant le comportement de conduite sur la base des trains mauvais freineurs) a eu pour effet de diminuer la capacité des lignes (et dans une certaine mesure les performances des convois), du fait de l'absence de réouverture continue : dès qu'un avertissement est franchi, le convoi doit réaliser la totalité de sa séquence de ralentissement, même si le signal aval est revenu à un état moins restrictif entre temps, situation qu'on ne rencontrait pas avant l'introduction du KVB (le conducteur pouvant reprendre sa marche dès que la signalisation au sol le permettait). Une solution intermédiaire a été envisagée au départ avec l'introduction de balises de réouverture mais celle-ci a été abandonnée. La mise en place du KVBP permet de se rapprocher de la situation prévalant avant l'introduction du KVB, avec la boucle de sécurité en plus. Mais cet équipement est coûteux car il faut non seulement équiper le bord des engins (ce n'est pas le point le plus délicat car les version 6.x sont déjà partiellement pré-équipées et compatibles) mais surtout l'infrastructure. D'où un développement très lent, d'autant que rien ne pousse vraiment le gestionnaire de l'infra à investir dans ce domaine, le gain important dégagé touchant essentiellement la robustesse et la qualité de l'exploitation, domaines pour lesquels il n'est en rien responsabilisé aujourd'hui (la qualité du service offert n'engage hélas que les entreprises ferroviaires, vis à vis des AO et de leurs clients). L'équipement de l'infra doit également être réalisé de manière homogène et viser un linéaire de voie significatif car on ne peut envisager un fonctionnement tronçonné KVB/KVBP avec succession de zones équipées et non équipées de faible longueur, ce qui serait improductif sous l'angle de l'ergonomie de la conduite (les conducteurs continueraient à appliquer le fonctionnement le plus restrictif, dans les faits, i;e. celui sous KVB). Le tronçon central du RER C (et les Z2N qui de la ligne) est équipé du KVBP. Christian
-
La TVM 300 : comment çà marche?
Merci pour la vidéo, très didactique même si on sent évidemment la "communication d'entreprise" (qui ne portait pas encore ce nom à l'époque) dans le discours. Pour les praticiens ou ceux qui fréquentent de temps en temps les cabines de TGV sur LGV (dans les règles évidemment !), on pourra remarquer la présentation de l'indication "VL" en noir sur fond vert (N/V ou V dans la présentation uselle des documents de signalisation), remplacée depuis (ça date !) par l'indication chiffrée de la VL (exemple 270 N/V ou 270V). Dans les séquences présentées, on peut également constater que la VL est tenue "au trait" (tant à 260 qu'à 160 en amont du changement de voie). Le mécano évoque l'arrêt en amont du repère sur l'indication 000. Etait-ce le cas à l'époque sur un repère F (en TVM ce n'est pas (ou plus) nécessaire en fait... le respect de la marche à vue suffit) ? Christian