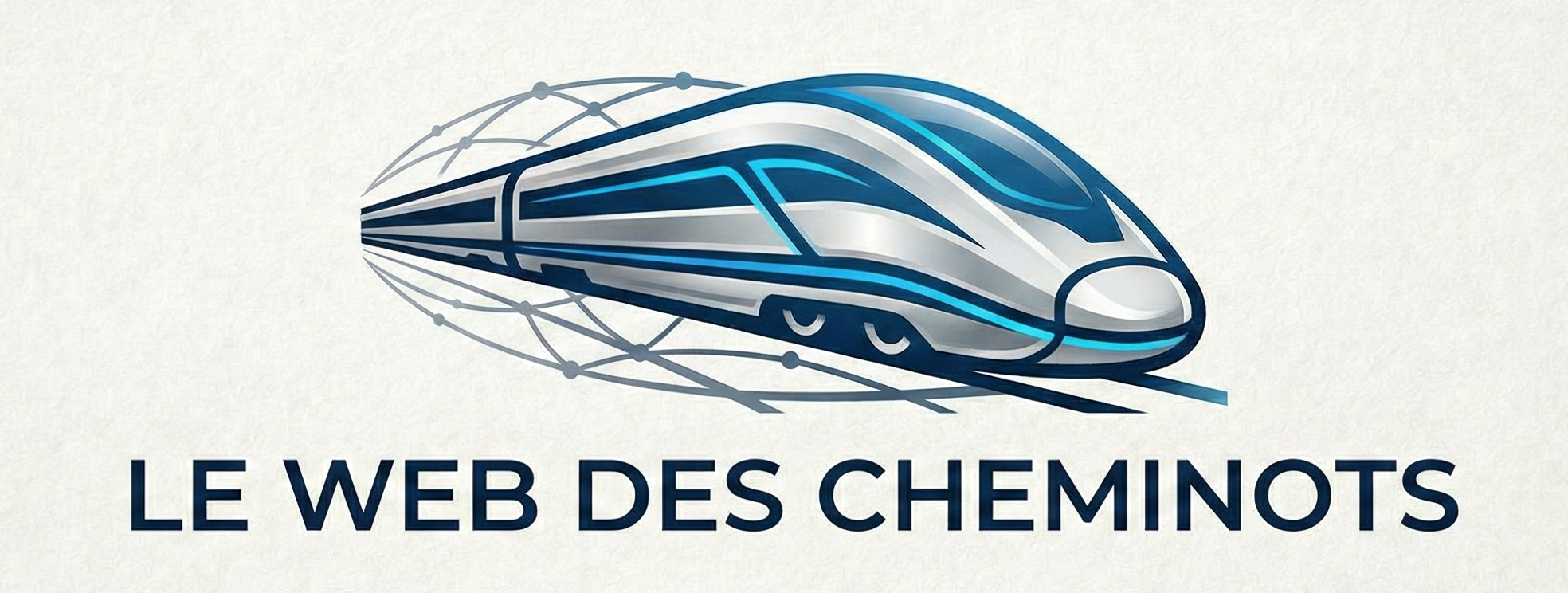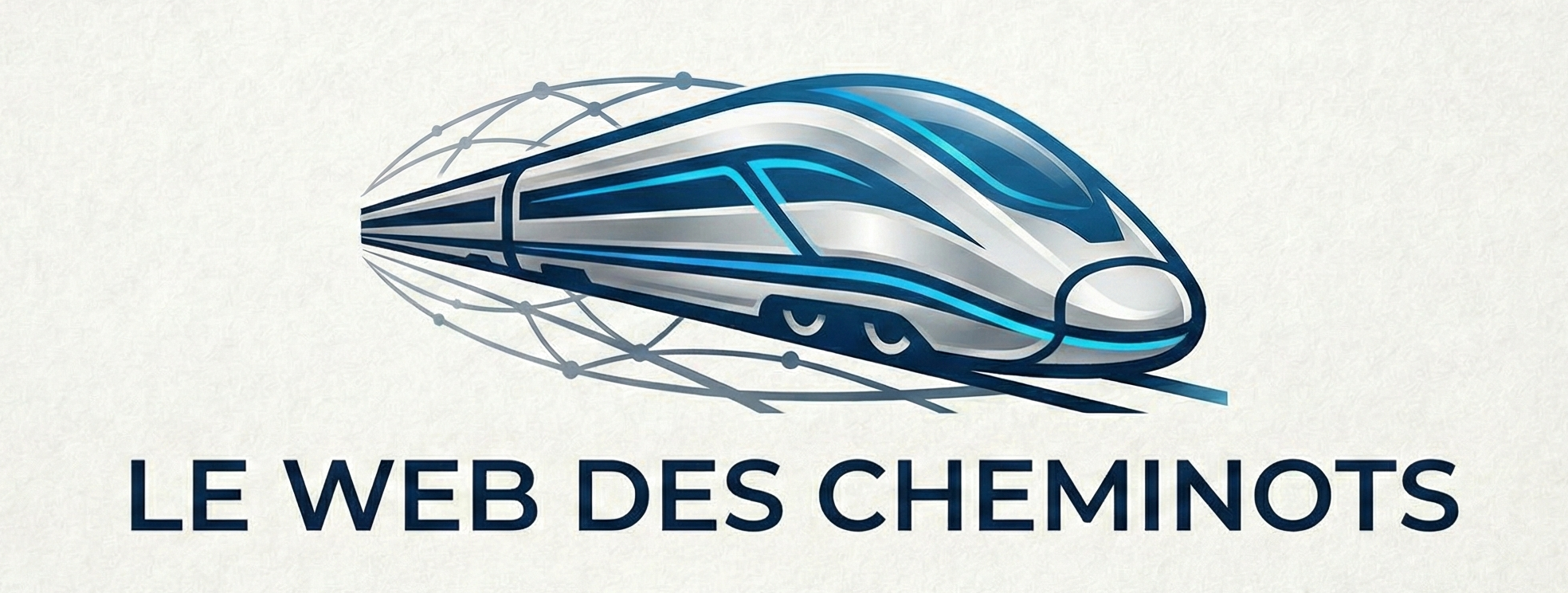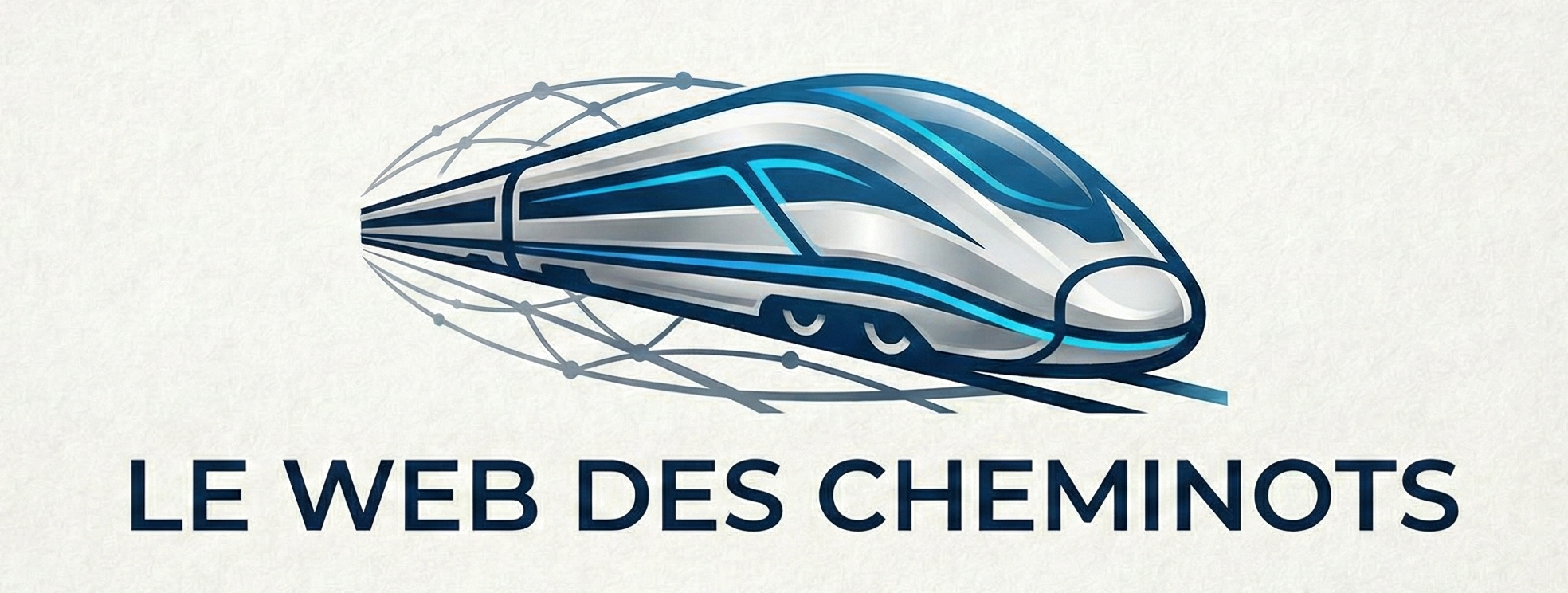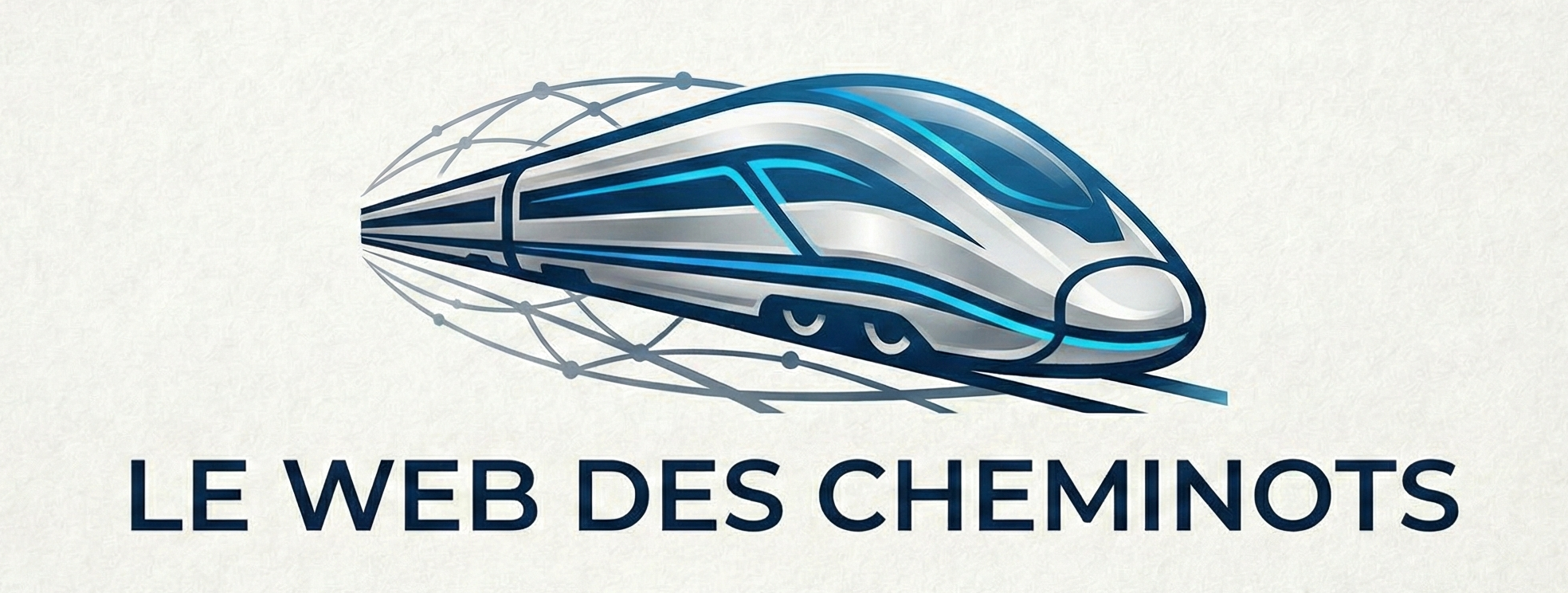Les « privilèges » des cheminots
par Mathieu Magnaudeix
Rémunérations, avantages en nature, durée du temps de travail, retraite… Quand ils font grève, le mythe prend le pas sur la réalité : la voici.
Challenges.fr
C’est le genre de sujet qui peut gâcher un repas de famille. Juste parce qu’un convive disserte sur les « privilèges » des fonctionnaires, des cheminots en particulier. Ce vieux débat, qui rebondit les jours de grève, hante aussi Internet. En décembre, durant la grève des RER B et D, un courriel prétendant dévoiler ces avantages a circulé, suscitant réactions indignées, défenses offusquées, et des tombereaux d’insultes. Les cheminots vivent-ils vraiment aux crochets du contribuable ?
Surprise : à la SNCF, on ne fait pas mystère de son salaire, qui dépend de la qualification (une lettre, de A à H), d’un échelon (on progresse à l’ancienneté), et d’une position (25 à 50 % dépend du mérite). Primes comprises, un cheminot gagnait en moyenne 2 242 euros brut par mois en 2002, contre 2 404 euros pour un fonctionnaire et 2 321 euros pour un salarié dans le privé, selon le bilan social de la SNCF et les données de l’Insee. Une fois payées les cotisations sociales, il reste à un cheminot de l’« exploitation » (vente, accueil en gare, aiguillage…) 1 300 euros par mois pour un débutant, 1 900 pour un agent de maîtrise en fin de carrière. Un contrôleur peut toucher 2 000 euros, et 200 de plus sur un TGV. Un conducteur commence à 1 500 euros. Philippe, conducteur sur le TGV Méditerranée, seize ans d’ancienneté, touche 2 709 euros par mois et pourra espérer jusqu’à 3 400 euros en fin de carrière. Fort loin de 5 770 euros, chiffre farfelu qui a circulé sur le web. Un salaire de cheminot, c’est « 15 % de primes », selon Nicolas Lecaussin, de l’Ifrap, un think tank qui pourfend les privilèges des statuts protégés. Mais, à y regarder de près, les 15 % ne sont pas si éloignés des 13,4 % du privé. Comme dans beaucoup d’entreprises, chaque cheminot touche une indemnité de résidence, un treizième mois et une prime de vacances. A noter qu’à la SNCF certaines des primes, qualifiées de « primes de travail », sont prises en compte pour le calcul de la retraite. Les autres dépendent des métiers : les contrôleurs sont payés au pourcentage sur ce qu’ils récupèrent à bord sur les amendes et ventes de billets (entre 2 et 10 %). Une certitude : la « prime de charbon », qui incitait les mécanos à économiser du combustible, a bien disparu avec la fin de la vapeur !
Des avantages en nature
En plus du salaire – et de la sécurité de l’emploi : seuls 64 agents ont été licenciés en 2003 –, les cheminots ont de vrais avantages en nature. Sans doute plus que dans le privé, où ces « à-côtés » représentent en moyenne 0,5 % de la rémunération brute. Les cheminots moins qualifiés voyagent pour rien en deuxième classe, les cadres en première. La réservation est parfois payante (1,50 euro sur un Corail Teoz, 10 euros pour un TGV en période de pointe). Leur épouse et leurs enfants ont droit à seize voyages chacun par an, « résa » non incluse. Pour les parents et les beaux-parents, c’est quatre. Souvenir du temps où le cheminot, fils des champs, revenait au bercail le week-end.
Dans les centres SNCF, les soins ne coûtent rien. Des cheminots habitent des logements à loyer modéré. Le comité d’entreprise (90 millions d’euros de budget) gère 500 000 mètres carrés de centres de loisirs et colonies de vacances. Selon Georges Ribeill, auteur d’une Histoire du régime des retraites des cheminots, « la valeur en nature de ces avantages, octroyés par les compagnies privées au début du xxe siècle, est devenue plus faible. Le cheminot est sorti de son univers clos. Quand il part en vacances, comme les autres Français, il prend sa voiture. Et n’envoie pas forcément son gamin en colo SNCF. »
Un temps de travail annualisé
Alors, fainéants les cheminots ? En décembre, le directeur de l’Ile-de-France a mis les pieds dans le plat, affirmant que les conducteurs de RER travaillaient « 182 jours par an […] pour une durée de service de six heures en moyenne » . A la SNCF, le temps de travail – 35 heures, calculé à la minute près – est annualisé. Certaines semaines ont six jours, d’autres deux. Mais on travaille le week-end, les jours fériés, à Noël (ou le jour de l’An), et l’on « découche » plusieurs fois par semaine. Précision : un conducteur ne conduit pas 35 heures. « Sur une journée de 7-8 heures, je fais 4 heures, calcule un conducteur TGV. Le reste du temps il faut préparer la machine. Un train, ça ne se démarre pas comme une voiture ! »
La rancœur vient d’ailleurs. De ces grèves qui hérissent le client, persuadé que le cheminot, quand il débraie, est payé. « Faux, répond la SNCF. Les retenues sont échelonnées, parfois sur plusieurs mois, en fonction des négociations de fin de conflit. » Mais « elles correspondent bien à 1/30 du salaire par jour de grève » , confirme le député UMP Hervé Mariton, qui a effectué un contrôle sur pièces en 2003.
Autre objet de rancœur et de jalousie : la retraite précoce (55 ans, et 50 ans pour les conducteurs) et confortable. Dans le privé, la retraite (après quarante, et bientôt quarante-deux années d’activité) est calculée sur les vingt-cinq meilleures années. Un cheminot, lui, touche entre 75 et 80 %… de son dernier salaire (traitement et prime de travail). « Déficit démographique oblige, les retraites de la SNCF sont largement payées par l’Etat, juge-t-on à l’Ifrap. D’autant que les cheminots cotisent moins que le privé. » La faute à qui ? A l’Etat, dont chaque réforme des retraites a soigneusement épargné ce « régime spécial » pour lequel les cheminots s’étaient mobilisés lors des grèves de 1995. La pénibilité du travail justifie-t-elle une telle spécificité ? Non, répond Georges Ribeill : « Avant, le mécano bouffait du charbon à longueur de journée. Aujourd’hui, c’est un presse-bouton dans une cabine climatisée ! » En fait, le régime spécial reste le pilier de la conscience cheminote et la raison d’exister des syndicats. « Les 50 ans, ce n’est pas négociable, assène Philippe Francin, numéro deux de la Fgaac, le syndicat autonome des conducteurs. En service, les gars n’ont pas droit à une seconde d’inattention. A 50 ans, ils sont usés. » Et les autres ? « Dans les bureaux, dans les dépôts, bien des cheminots qui font du 9 heures-17 heures aimeraient travailler un peu plus, s’amuse Georges Ribeill. Auprès de leur voisin de palier, ils ont plutôt du mal à justifier leur retraite à 55 ans. »
Un régime spécial
1911 - Loi sur les retraites des cheminots.
1920 - Création du statut.
1938 - Le réseau ferré est nationalisé, la SNCF, créée.
1983 - La SNCF devient un établissement public. Création d’un comité d’entreprise.
1995 - Grèves anti-Juppé. Les cheminots sauvent leur régime de retraite.
Feuille de paie d’Etienne, 32 ans, contrôleur sur TER
Célibataire, entré à la SNCF en 1999
Traitement : 1 316,55 €
+ Prime de travail (incluse dans le calcul de la retraite) : 285,03 €
+ Indemnité de connaissance de langues étrangères (il maîtrise l’anglais et l’italien) : 121,39 €
+ Allocation de déplacement (repos hors résidence) : 113,74 €
+ Autres primes, indemnités et allocations : 156,57 €
Total brut mensuel : 1993.28 €
Retenue absence non rémunérée deux jour de grève : 106,74 €
Cotisation sociale : 265,74 €
Mutuelle 30,90 €
Total net : 1 589,90
Loyer pour un 47 m² dans une résidence SNCF des Yvelines : 284,27 €
Abonnement à la Vie du rail : 6€
Virement fin de mois effectué par la SNCF : 1 299,63 €
http://challengestempsreel.nouvelobs.com/f...hall_19942.html