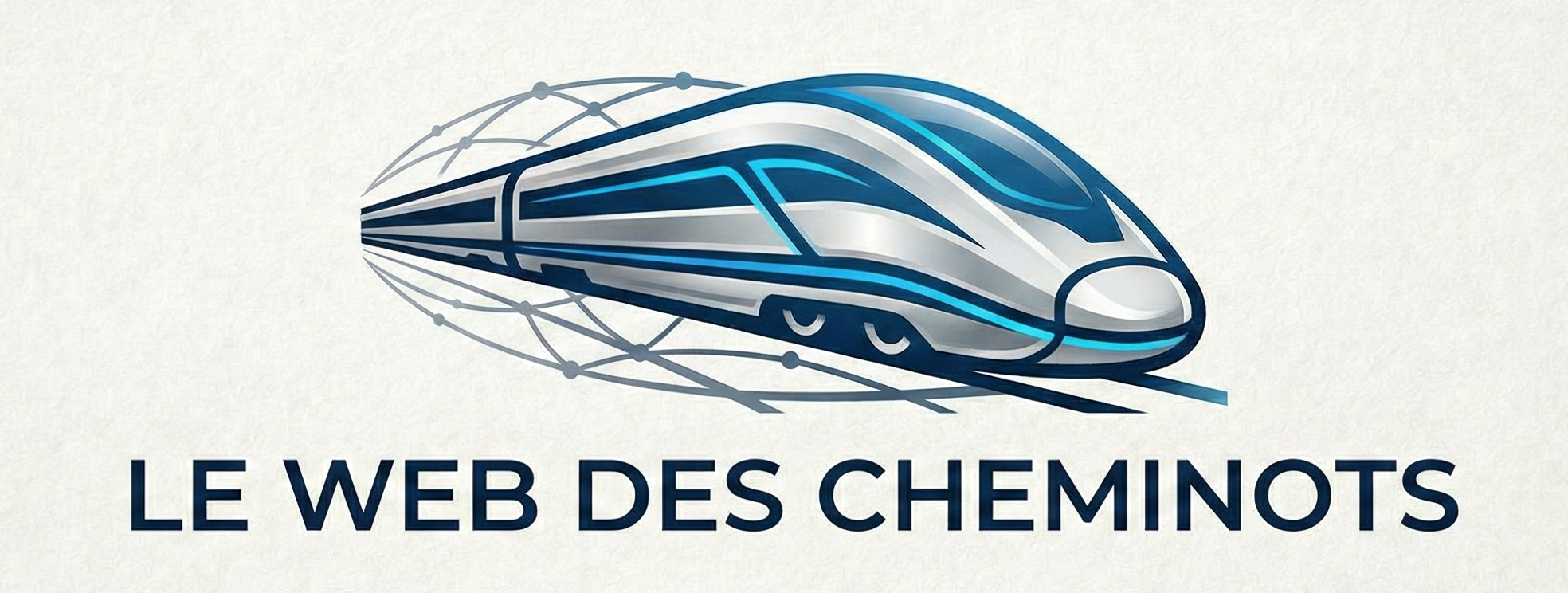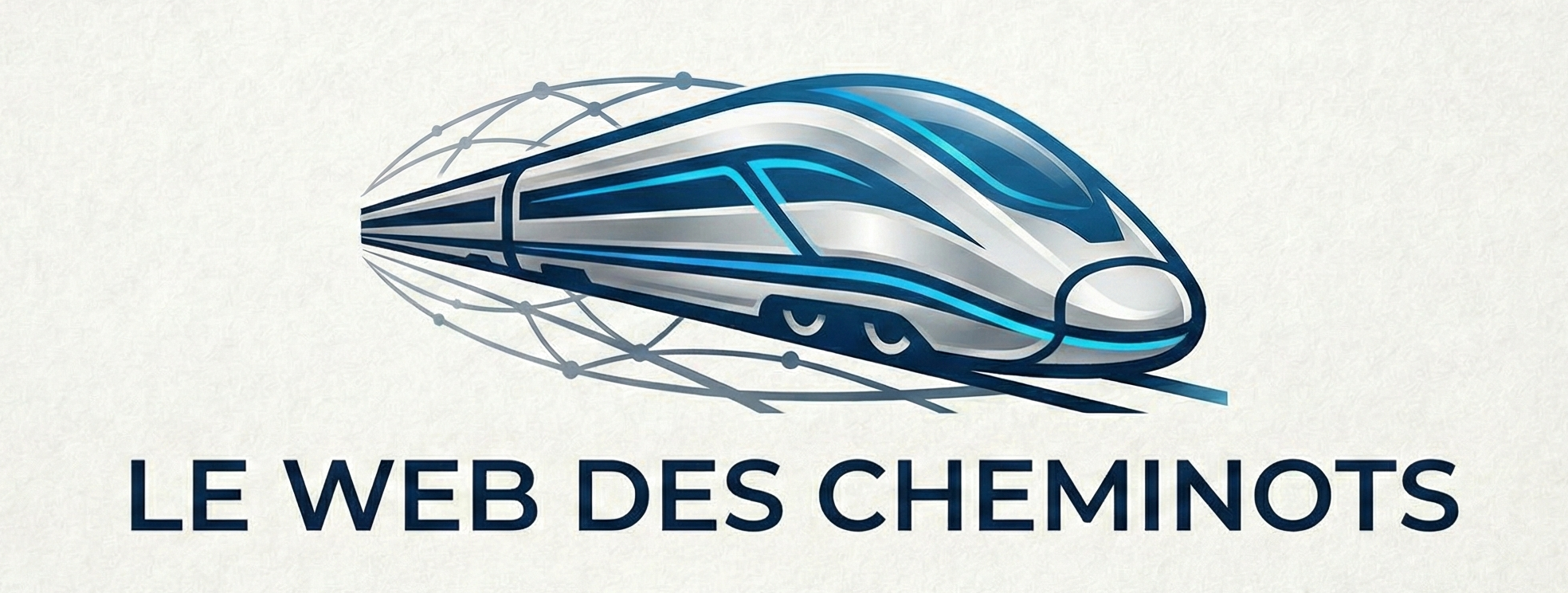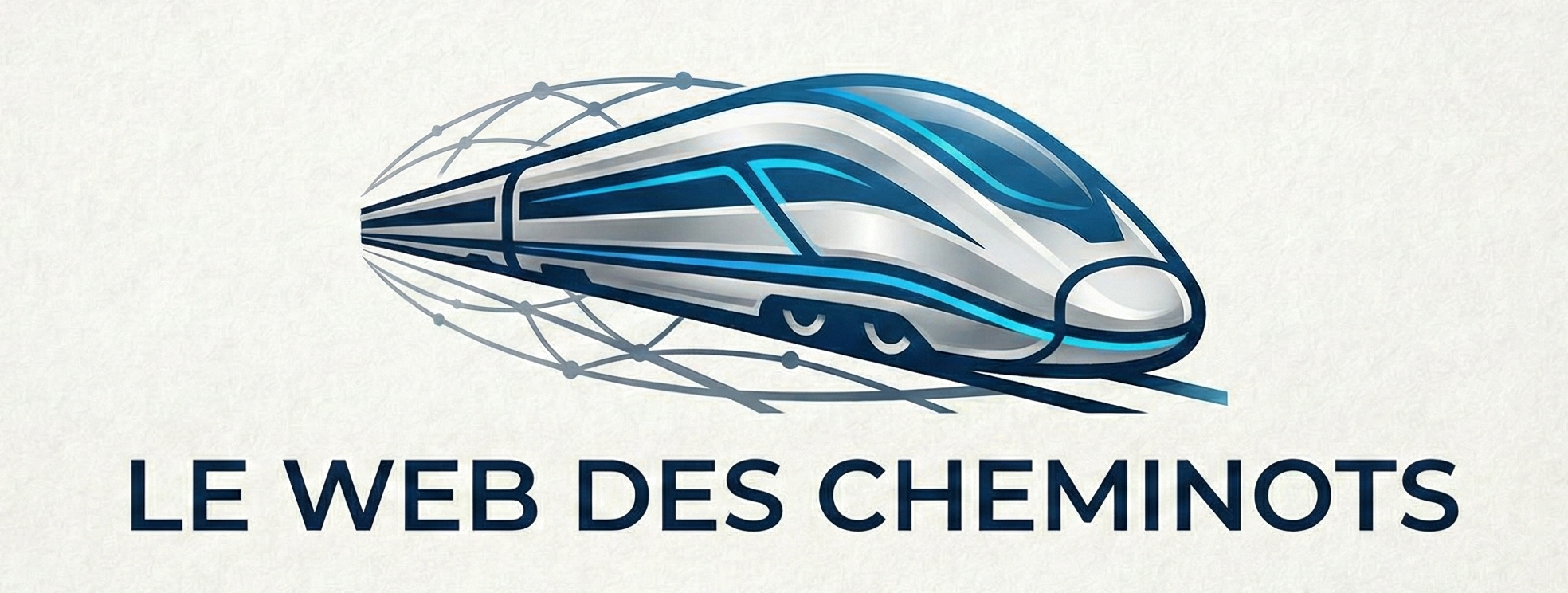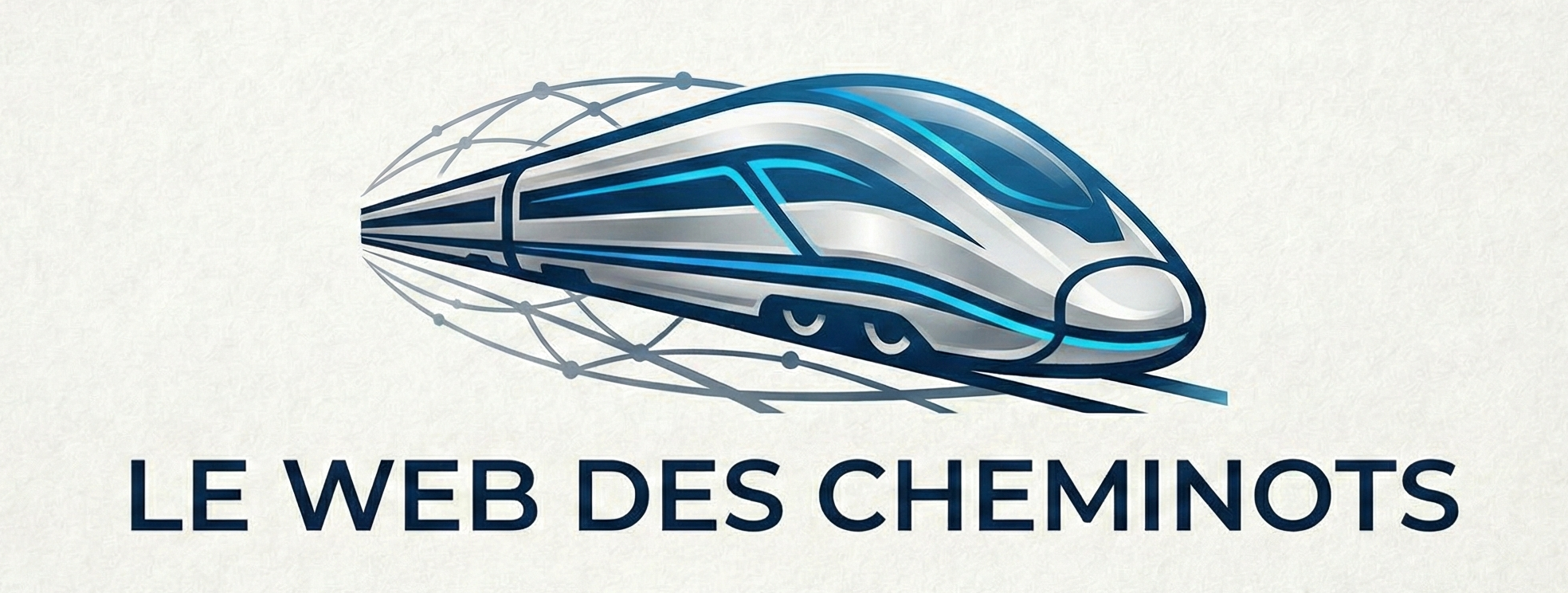Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
Pépy : La séparation du rail en France en deux entités "n'a pas d'avenir"
Pas nécessairement mais P. Cardo est un politique, issu de la majorité gouvernementale. Il est depuis le début clairement favorable à une séparation complète EF/GI telle que pronée par la Commission européenne et une partie des parlementaires de l'UE (pas tous, en Allemagne par exemple, A. Merkel [CDU] défend plutôt la position de la holding DB... favorable au maintien d'un certain niveau d'intégration). La Commission vise quant à elle depuis longtemps la disparition de tous les ex-monopoles publics des industries de réseau (électrificité, cdf...). C'est un combat idéologique, qui s'appuie sur les orientations du Traité de Rome (d'essence assez libérale sur le plan économique). Sur ce sujet de l'organisation du cdf, je fais un copié-collé de ce j'ai écrit (aujourd'hui) sur un autre forum (Ici), suite à aux recommandations récentes de l'Inspection générale des Finances, qui s'est vue confiée une mission sur ce sujet par le gouvernement.
-
Pépy : La séparation du rail en France en deux entités "n'a pas d'avenir"
C'est de moins en moins vrai. RFF s'est doté au fil des années (l'effectif de l'EPIC doit être proche de 1000 personnes avec les DR crées, pour l'essentiel des cadres, cadres sup et cadres dirigeants) de spécialistes de l'infra. Evidemment sur des sujets très pointu, il sera toujours nécessaire d'avoir recours à des spécialistes externes à RFF (notamment ceux de l'Ingénierie de l'Infra SNCF) mais on ne peut plus dire aujourd'hui que le GI n'est qu'une chambre d'enregistrement et un organisme de financement et de gestion de la dette. Pour ce qui est de la dégradation de l'état du réseau, si l'on ne prend en considération que le km de voies renouvelées de manière complète (c'est donc un indicateur quelque peu réducteur même s'il est parlant), la baisse à débuté dans les années 82/83 (on traitait alors environ 900 km de voie par an en RVB), pour atteindre un palier à entre 500 et 550 à partir de 1987. La baisse a repris en 1992, tombant à 410 km en 1994 puis se stabilisant autour de 450/500 km jusqu'en 1999. Il y eut une nouvelle chute à partir de 2000 (cela coincide avec la montée en charge de RFF), les basses eaux étant atteintes en 2003 avec seulement 206 km renouvelés en RVB. Il faut néanmoins préciser que la baisse constatée à partir des années 2000 s'est accompagnée d'une forte hausse des remplacements de rails et de traverses (au sens "régénération", le traitement des voies à trafic modeste avec des remplacements limités de traverses étant compté à part jusqu'en 2009) : de 100 à 120 km par an en moyenne, on est passé à plusieurs centaines de km à partir de 2000. Mais globalement, la première partie de la décennie passée a quand même été très négative pour l'infrastructure, qui avait déjà subi une cure d'austérité les 25 précédentes années. La différence est que cette réduction des investissements avait plus touché le réseau régional que les lignes principales... contrairement à ce qu'on a pu observer durant la seconde période, aux conséquences plus visibles (cf. la dégradation de l'infra sur Tours-Bordeaux, axe majeur du RFN, situation inimaginable dans les années 80 ou au début des années 90). On peut rappeler que les premières années qui ont suivi la création de RFF, les niveaux de péages étaient faibles ce qui a permis à la SNCF de se refaire une santé (sortant d'une situation financière très dégradée, du fait de l'explosion de sa dette, de la récession de 1993 conjuguée aux ratés de Socrate et de la politique commerciale du TGV Nord, ainsi que des effets du mouvement social de 1995) mais au prix d'une nouvelle contraction des investissements sur le réseau. Ceux-ci n'ont repris de manière importante que ces dernières années (dépassant ceux de la période 90), du fait essentiellement de l'augmentation très forte des péages (*) versées par l'EF SNCF (le Fret paie peu vu sa faible capacité contributive actuelle dans un secteur dominé par la route aux coûts directs très bas) et d'un niveau d'endettement accru de RFF (ce qui n'augure rien de bon pour la suite). Christian (*) une partie de l'augmentation a été couverte par l'Etat (pour les AOT du TER et du Transilien, à km-trains constants, ainsi que pour les EF Fret [les péages ayant pratiquement été doublés, en partant de bas il est vrai]) : les recettes de péage couvrent désormais nettement plus que les seuls coûts d'exploitation du réseau et de maintenance courante (+ les frais de structure des deux entités RFF+Infra SNCF) mais l'Etat a réduit en parallèle sa contribution aux charges d'infrastructure (il contribue indirectement via les aides apportées aux charges de péage des AOT et EF Fret mais c'est loin de suffire à équilibrer l'ensemble du système).
-
Quel aveni pour l'infra circulation?
Dans le cas que tu cites, ça confine plutôt à l'incompétence, car cela paraît absurde en termes de régulation (à moins qu'il y ait d'autres considérants...). Au niveau de la conception des horaires (adaptation comprise), les trains des nouveaux entrants sont souvent mieux traités que leurs homologues (fret) de l'EF historique, voire montés aux forceps i.e. de manière pas très robuste dans des graphiques denses (tant pis pour les autres circulations de l'environnement... qui pourront être retardées dans la vraie vie par ce type de montage peu réaliste). Il n'y a évidemment pas de règles écrites qui prescrivent ce type de traitement discriminatoire (1er cas évoqué) mais l'explication "off" la plus fréquemment avancée est la pression du gestionnaire du graphique (sur le maître d'oeuvre), qui souhaite se montrer "bon" élève dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et veut éviter autant que possible les récriminations des nouveaux entrants, beaucoup plus enclins que l'EF SNCF (bridée par sa tutelle) à croiser le fer avec lui (par tribunaux ou ARAF interposés)... Les cas que décrit Tram21 sont à ma connaissance isolés aujourd'hui car il y a bien longtemps que le personnel de l'actuelle DCF a pour mission de traiter tous les trains de même nature sur un pied d'égalité, quelle que soit l'EF qui en a la charge. Leur encadrement a des comptes à rendre sur ce point, cela remonte jusqu'à RFF. Et ce type de comportement peut difficilement être "caché". Qu'il y ait des interventions de postes (qu'elles soient de leur propre chef ou découlent des décisions de régulation voire du CNOF) qui n'apparaissent pas toujours pertinentes vu des conducteurs, c'est autre chose. Cela ne vise pas spécifiquement les nouvelles EFs. Nombres de conducteurs SNCF pourraient témoigner de ce ressenti... Christian
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Il y a des coupez-courant sur les réseaux suisse et allemand, mais du fait de la fréquence "spéciale" du courant de traction et de la création d'un réseau d'alimentation dédié (au réseau ferroviaire), ceux-ci sont beaucoup moins nombreux qu'en France. Ma question portait non sur l'existence des sectionnements mais sur la manière dont ils sont appréhendés avec des compos multiples, de locs ou d'automoteurs (sur les artères à forte rampe tel le Gothard, les UM3 ou 4 de locs ne sont pas rares, sur certains trains lourds). Une panne généralisée du réseau électrique est chose possible en France, il existe des procédures spécifques que met en oeuvre RTE pour éviter d'arriver à un telle extrémité, en cas de dysfonctionnement majeur sur le réseau national.
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Merci pour ton explication, c'est plus clair pour moi désormais. Par contre, sjmsb il existe des sectionnements "simples" et "doubles", le seconds étant constitués de deux sections neutres. Pour ponter l'ensemble, il faut dans cette configuration 3 pantos, l'occurence doit donc être beaucoup plus faible. Question annexe : comment gère t-on les configs à 3 ou 4 pantos rapprochés, chez nos voisins équipés en caténaire monophasée ?
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Salut, l'utilisation de rames tractées sur les TER IC Lyon-Marseille restera de mise en 2012 (et 2013), pour la majorité des circulations s'entend. Il est possible que quelques trains soient couverts en TER2Nng (c'est plus performant qu'une rame tractée sur cet axe, donc qui peut le plus peut le moins pour la tenue de l'horaire), si ça facilite le montage des roulements du matériel. Pour revenir au sujet du franchissement des coupez-courant, une section neutre mesure plusieurs dizaines de mètres dans le cas le plus courant (il en existe de différentes longueurs). Elle comporte plusieurs parties dont des isolateurs de section, de chaque côté de la zone neutre proprement dite. Le point qui reste obscur pour moi, ce n'est pas la possibilité (évidente) de ponter les deux sections électriques (l'explication fournie par gomen) mais le fait que ce pontage puisse intervenir disjoncteur ouvert sur les engins, qui plus est entre éléments d'une UM, pourtant non reliés en HT. Cela sous-entend qu'une continuité entre pantos subsiste dans ces configurations (UM). S'agissant du FU à l'arrivée à Paris MP, à 50 m du heurtoir on n'est plus vraiment au milieu du quai ! Vu ce que Akwa décrit et la faible distance au heurtoir, ça ressemble vraiment beaucoup à une prise en charge par le KVB (le système de contrôle de vitesse utilisé sur les lignes classiques du RFN). Les courbes de freinage du KVB pointent en principe le point protégé, i.e. le heurtoir dans le cas présent mais à PMP, de mémoire l'indication 000 (VL10 à appliquer à l'approche du point protégé, donc ici du heurtoir) monte dès le franchissement de l'avertissement (qui précède toujours une arrivée sur voie en impasse, sur le RFN). Cette configuration minimaliste (au niveau de l'implantation du sol KVB) est souvent pénalisante pour les circulations car d'une part la distance entre le signal et le heurtoir est assez importante (ce qui peut induire une dérive dans le fonctionnement de l'odométrie embarquée du KVB, dégradant ainsi l'ergonomie de la conduite), d'autre part il est rare que le codeur du signal code la distance exacte de chaque itinéraire dans une gare de cette importance, donc de faibles écarts sont là aussi possible. Sur une voie en impasse, les courbes de freinage du KVB sont levée à 12,5 (l'alerte fournie au conducteur [bip bip en cabine...]) et 15 km/h (le FU, déclenché et établi, jusqu'à l'arrêt), donc quand tout fonctionne normalement, il faut être à 15 km/h ou au-dessus dans la zone d'approche (40 à 70 m du heurtoir pour V=20 km/h par exemple, pour un train de voyageur, en fonction du matériel utilisé) pour déclencher un FU... ou à proximité immédiate du heurtoir où des balises déclenchent un FU dès 12 km/h, sans alerte cette fois (dans le cas que tu décris, ces balises n'avaient pas été franchies par l'antenne du KVB manifestement). Sous réserve que le paramétrage du sol soit correct et que le bord fonctionne aussi normalement, le KVB devrait laisser une latitude assez grande au conducteur, à l'approche d'un heurtoir dans le cas d'un matériel bon freineur tel que le TER2Nng, vu le taux de décélération paramétré et le fait que le fonctionnement du frein soit assimilé à du FEP vu du KVB (bien que ces engins n'en soient pas doté). Donc sauf à approcher vraiment vite du heurtoir, ça ne devrait pas déclencher de FU... en théorie du moins (en pratique, c'est probablement un peu différent et c'est peut-être ce qui s'est passé ici). Christian
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
A cette vitesse, effectivement, les "testeurs" ont dû en prendre plein les oreilles, c'est une certitude. A Technicentre : j'ai bien conscience que les essais d'installations comportent un volet "survitesse" mais tu évoquais dans ton message le fait que la VL300 avait été abaissée à 270 suite aux essais... c'est du moins ce que j'avais compris en te lisant (*). D'où mon étonnement et mes remarques, la VL270 étant prévue de construction, à ma connaissance. (*) "Ce n'est pas juste avant la mise en service commercial que la vitesse d'entrèe dans le "coup de fusil" a été prise mais dès les premiers essais... On rentrait là dedans à presque 300 et on s'en prenait plein la gueule... La vitesse a été limitée à 270, si je me rappelle bien puis encore baissée ensuite."
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
Salut, je faisais référence à l'abaissement de 270 à 220 km/h de la vitesse à la traversée des monotubes de Villejust. J'ai le souvenir (j'espère que ce n'est pas mon cerveau qui divague !...) des premiers franchissements (en exploitation commerciale) à vitesse plus élevée qu'aujourd'hui dans le sens pair (en sens impair, vu le profil et le niveau d'accélération modeste des TGV A de série, la montée en vitesse était très progressive, on ne sortait pas du tunnel à 270), qui étaient franchement désagréables. Par contre, j'ai toujours lu dans la "littérature" de référence (RGCF au premier chef) que la section libre des monotubes (46 m²) avait été dimensionnée pour la VL de 270, pas pour une VL supérieure. La configuration du tracé en plan et de la signalisation avec transition TVM/BAL avec préannonce à proximité du portail nord des tunnels de Villejust limitait fortement l'intérêt d'un dimensionnement pour 300 km/h de la section des deux tubes, la VL220 puis 200 s'appliquant jusqu'au sud de Massy (côté Paris). Donc peut-être qu'il y a eu des essais à VL supérieure mais il serait vraiment surprenant que la ligne ait été livrée pour V300... alors que l'ensemble des docs produits avant 1989 indiquaient 270. Pour l'anecdote, la VL n'a jamais été modifiée dans les RT... étant manifestement assimilée à une réduction ponctuelle de vitesse, à l'image des Z/R sur ligne classique. Cela sera t-il encore le cas avec l'allongement de la section limitée à 270 cotée province, cette fois pour préserver le débit à moindre coût (!), RFF ayant décidé de réduire l'espacement en conception (à 4') entre les sillons sur la LGV A (d'où le traitement réalisé ou à venir des points durs, essentiellement par implantation de retardateurs [de l'indication prémonitoire] sur certains cantons de TVM). S'agissant de la compatibilité des UM A avec la longueurs des quais (comme celle des évitements sur les VU alpines), Lyon Perrache accepte ces compositions sur au moins une voie (celle côté BV) et Part-Dieu sur plusieurs d'entre elles il me semble (sur voie A c'est une certitude, il y a une pancarte 2TGVA en tête de quai côté Paris). Un A/R Nantes-Lyon est régulièrement assuré en UM A. A Marseille St Charles, je ne saurais dire si des UM A sont venues en commercial (je n'en ai pas le souvenir) mais la gare a reçu des compos longues avant l'ère du TGV SE (il y a eu des modifications du plan de voie depuis, mais pas fondamentales en fond de gare). Par contre, les missions sans arrêt de Lyon à Marseille (ou de Paris à Marseille après l'achèvement de la LGV Rh-A) étaient très minoritaires, voire inexistantes jusqu'en 1994, donc l'utilisation d'UM sur Paris-Marseille aurait/aura été pour le moins délicate en service commercial. J'ignorais que la rame A modifiée avait été conservée en l'état, ou presque...
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
Bonsoir, L'explication de 5121 est la bonne... à compléter par l'interdiction de franchissement des ouvrages souterrains de Marseille, pour la même raison. Sur la zone du Tricastin, du fait des installations nucléaires situées à proximité, l'Etat à imposé des dispositions particulières au niveau de l'exploitation de la LGV (la ligne classique n'est pas concernée...). Des balises déclenchent ainsi à la traversée de cette zone la fermeture des volets de climatisation, ce qui conduit cette dernière à fonctionner -temporairement- en circuit fermé. Les rames PSE équipées de la TVM 430 ont bénéficié de cette modification dite "mini-étanchéité", que n'ont pas reçu les rames Atlantique. Vis à vis des croisements dans les tunnels, le niveau d'étanchéité à obtenir est plus exigeant (il nécessite notamment des joints de porte gonflables) et onéreux à mettre en oeuvre sur un matériel non équipé de construction (cas des TGV Réseau et suivants). La question s'est posée pour les TGV A, en particulier pour le franchissement des monotubes de Villejust (où la VL a été abaissée peu de temps après la mise en exploitation commerciale, pour limiter la gêne ressentie à sa traversée au niveau des tympans) mais elle est restée sans suite pour les raisons évoquées précédemment. L'équipement en SAFI du parc amené à circuler sur ce tronçon de la LGV Méd est la seconde disposition retenue, complétée par des mesures d'exploitation (règles spécifiques à respecter en cas d'arrêt inopiné... qu'il convient d'éviter autant que possible etc.) Pour le franchissement des ouvrages souterrains de Marseille, l'Etat a imposé des les mêmes dispositions (SAFI + étanchéité partielle ou complète) + des équipements au sol (dont un véhicule rail-route mis à disposition des marins-pompiers de Marseille) . L'équipement en SAFI a depuis été généralisé à la quasi-totalité du parc TGV, de mémoire. Christian
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
La LGV Méd est pour partie interdite aux TGV A en charge (traversée de la zone du Tricastin et des ouvrages souterrains de Marseille). Il y a également les LGV hors RFN (Eurotunnel, HS1 en Grande Bretagne, LGV 1 belge), à vide et en charge pour celles-ci..
-
Les assises du ferroviaire
La maintenance de la NBS Hanovre-Wurzbourg est jusqu'à présent effectuée uniquement les nuits des SA/DI et DI/LU, périodes où le trafic fret est réduit. Les nuits de semaine, il y a du fret sur les deux lignes (historique et ABS), ce qui n'a rien de surprenant vu le niveau demeuré important des flux fret outre-Rhin. Il est évident que le choix de construire des LN mixtes a considérablement accru le coût de l'infrastructure mais il y a aussi d'autres facteurs (pas de logique de DUP avec expropriation possible dans l'ex-Allemagne de l'ouest, densité de population plus élevée et oppositions à la construction d'infras nouvelles plus fortes que chez nous à cette époque). Et le relief de la partie centrale de Hanovre-Wurzbourg est plus rude que celui du Morvan, même si les altitudes maxis demeurent modestes. Donc des tunnels auraient été nécessaires dans tous les cas, probablement de longueur cumulée plus faible avec des déclivités plus élevées. Le choix de la mixité est à mon sens plus discutable sur Mannheim-Stuttgart que sur Hanovre-Wurzbourg. Vu l'importance du trafic fret sur cet axe nord-sud, et celui du trafic régional (plus important qu'en France à quelques exceptions près), il y avait un réel besoin de capacité complémentaire pour le fret, ce qui n'était pas le cas sur l'axe PLM (une fois déchargé du trafic GL de jour). Les IC à VL200 empruntent également les NBS. Le volume de circulations voyageurs est moins élevé que sur les troncs communs de nos LGV, ce qui s'explique facilement de par la géographie différente des deux pays (pas de méga métropole comme en France).
-
[Voiture Corail] Sujet Officiel
Oui, l'indication 200+ sur les cartouches de ces voitures a permis de les distinguer de celles équipées d'anti-enrayeurs de génération plus ancienne et agissant bogie par bogie. Cette amélioration des anti-enrayeurs a permis de faire évoluer le S7A en autorisant pour ce sous-parc des compos courtes à VL200, disposition souhaitée par les TER Alsace puis Pays de la Loire et Centre pour lancer leurs dessertes TER200. Christian
-
Les assises du ferroviaire
La LN Hanovre-Wurzbourg est exploitée de nuit en semaine avec essentiellement du trafic de Fret rapide et quelques trains de nuit. Je ne saurais dire s'il existe des Fret à VL200 outre Rhin mais à VL140-160 c'est une certitude. Le trafic Fret de l'opérateur historique allemand doit approcher les 75 Gt-km sjmsb, soit 3 fois celui actuel de son homologue français (hélas !). Pour ce qui concerne les voyageurs, ce n'est un secret pour personne que la maison mère lorgne vers la France depuis un bon moment (pour y venir en solo s'entend). Qu'elle le fasse par l'intermédiaire d'une filiale ne changera pas fondamentalement la donne... Là où je te rejoins, c'est au niveau des contraintes de circulation de nuit sur LGV... du moins sur les deux premières LN où des travaux lourds de régénération sont engagés sur plusieurs années encore. Mais ce ne serait pas la première fois que les plages travaux sont adaptées pour satisfaire un nouvel entrant...
-
Service Annuel 2012 [Sujet Officiel]
La "règle" des 3 mois est applicable en cours de service, pas pour le démarrage du service. Il en va ainsi depuis plusieurs années et l'évolution calamiteuse de la production horaire avec des variantes travaux traitées jusqu'à J-15 devraient conduire à revenir à des ventes à M-2, de mon point de vue. Ce n'est pas satisfaisant pour les EF bien évidemment, et cela revient à mettre en dur une dégradation du service vendu aux voyageurs mais ça serait à mon sens préférable que de vendre des billets avec horaires "à confirmer", au même prix que ceux avec horaire -en théorie du moins- garanti.
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Effectivement, on peut difficilement critiquer la tendance de fond de l'évolution du métier vers toujours plus de logique "presse-bouton" et pousser dans ce sens en unifiant -toujours par le bas- les gestes de conduite. Quand vous dégagez une zone à vitesse réduite, vous considérez votre compo en UM pour ne pas avoir à vous poser la question ? Idem pour les rames tractées ? Il est vrai que la généralisation des pancartes REV (calées sur les compos réver les plus longues circulant sur la ligne) et la règle de conduite associée avaient déjà poussé dans ce sens (comment faisait-on avant ?...). Je doute qu'un passage DJ ouvert mais pantos non abaissés entraîne ce type de dégâts (ou alors ce doit être extrêmement rare). Il provoque probablement une disjonction au niveau des sous-sta par détection de courant dans la section neutre (les sous-sta non équipées de la sorte sont rares à ma connaissance). Evidemment, c'est très pénalisant pour le trafic et donc à éviter mais si ça met tout parterre jusqu'à la caténaire elle-même ou certains constituants des sous-sta, alors il y a vraiment un problème. Sur le fond, je n'arrive toujours pas à comprendre comment un engin circulant DJ ouvert peut ponter une zone neutre... et pourquoi le constructeur n'a pas trouvé une solution technique pour remédier à cette situation. Sur les lignes où les coupez-courant sont rapprochés (je pense à Marseille-Nice en particulier mais il y en a d'autres), la multiplication des baissez-pantos n'est pas neutre sur les performances de la marche. Toujours ce même constat d'une régression par rapport à la situation ante...
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Ici, il s'agit de cuisine interne au couple GI/GID (RFF et SNCF Infra). Que l'organisation de la maintenance ait pour pilote unique l'Infrapôle de Pagny (créé avec la LGV EE) ne fait pas en soi de la LGV RR une LGV Est bis. La LGV mise en service en décembre sera de longueur réduite (du fait du tronçonnage imposé par l'Etat et RFF), cela explique sans doute l'organisation retenue (sur le terrain, des installations sont bien prévues pour accueillir les engins et les personnels en charge de la maintenance de la branche Est , c'est là l'essentiel).
-
Service Annuel 2012 [Sujet Officiel]
Le transfert à Austerlitz de missions origine/terminus Bercy n'est pas à l'ordre du jour, compte tenu des difficultés d'insertion entre Melun et Juvisy (surtout depuis Corbeil) et du surcroît de temps de parcours occasionné. C'est donc bien une rumeur, sans fondement réel. Le report de PLY à PBY des Téoz Paris-Clermont au SA 2012 est bien à l'origine un souhait de l'EF SNCF (qui allait dans le sens de celui de RFF)... pour soulager la gare de Lyon dans un contexte de travaux à PLY, de trafic TGV en hausse et d'une régularité en dégradation marquée sur la LGV SE (conséquence du resserrement des sillons mis en oeuvre depuis 2008 et de la reprise des travaux de régénération, qui diminuent le débit sur la LGV). Christian
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
Je n'ai pas écrit qu'elles étaient sous-motorisées, mais que cette disposition a été invoquée pour améliorer la tenue dans le temps des moteurs, c'est du moins l'argument qui a été invoqué quand j'ai posé la question. Ce point reste obscur pour moi comme déjà précisé. Il s'agissait d'aller sur le nord et donc d'utiliser un parc équipé non seulement équipé de la TVM430 mais également apte à 300, VL des deux LGV (avec du matériel V270 on perdait en capacité et en performances). Les PSE ne l'étaient pas à l'époque (le V300 est arrivé progressivement) et seul un sous parc avait été modifié TVM430 (avec transcription spéciale car non encore dotées du frein HP). Le parc Réseau n'était pas encore complet et surtout celui des Atlantique appraissait généreusement dimensionné (ne pas oublier la commande complémentaire de 10 éléments [396-405], souhaité par l'Etat pour soutenir l'industrie ferroviaire). La transformation de rames A apparaissait donc pour le moins logique. Pour mémoire, les PSE étaient également limitées à 200 (au lieu de 220) sur ligne classique. Christian
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Les PSE tricourant des TGV Lyria vont être remplacées par des POS, dégagées par l'arrivée des 2N2. Mais la mise au point et la livraison de ces dernières a pris un peu de retard et la priorité d'affectation va aux relations Lyria 3 Paris-Zurich par Rhin-Rhône (puis sur l'unique A/R Francfort-Marseille qui ne sera lancé qu'en mars 2012), donc il faudra être un peu patient pour le remplacement des PSE sur Paris-Lausanne/Berne. Le processus débutera courant 2012, à moins que le calendrier ait dérivé de quelques mois. Le remplacement complet était prévu d'être effectif au plus tard fin 2013.
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
Quel rapport avec la marge de régularité ? Il y en a dans les deux cas... et qui plus est sur LGV celle-ci est un (faible) prorata du temps de base, pas de la distance, donc elle diminue quand la vitesse moyenne augmente (à la marge évidemment, quand on passe de 300 à 320, d'accord sur ce point). L'écart est de l'ordre de 3', sur la partie SEA.
-
[TGV Atlantique] Sujet Officiel
C'est une solution plus basique qui a (hélas de mon point de vue) été retenue pour la LGV SEA et il me semble également BPL, à savoir l'équipement en... TVM 300 (avec ERTMS 2 [en superposition] puisque les dispositions européennes l'imposent). Mais comme l'industrie ne "sait" plus fabriquer ce type de TVM, au niveau des composants électroniques s'entend et de leur interfaçage avec les installations de sécurité (qui ont évolué [ce sont des systèmes désormais informatisés et non plus à relais], c'est une sorte de TVM430 qui va être installée... avec des fonctionnalités réduites correspondant à celles de la TVM300 et le signal analogique qui va avec. Le remplacement du bord TVM300 par un bord TVM430 n'est pas très complexe et long à réaliser, de ce que j'en ai compris (je ne suis pas un spécialiste du sujet, tu l'auras compris), vu qu'on change la quasi-totalité des tiroirs embarqués et une bonne partie des équipements sous caisse. Lorsque les 20 dernières rames Atl ont été fabriquées, on avait initalement prévu de les équiper de la TVM300 (version LGV A) . Il a finalement été décidé de les équiper de la TVM430 pour leur permettre de circuler sur le barreau d'interconnexion au nord du triangle de Coubert et ainsi de desservir le nord de la France, puis Marseille par la LGV Rh-Alpes. Les 7 rames PSE V270 en cours de modif V300 recoivent également la TVM430, en ce moment. La contrainte est d'abord économique. S'agissant de la VL, les rames Atlantique demeureront à VL300. La puissance des moteurs a -selon M mais je n'ai jamais vu de note officielle sur ce sujet pour ce qui me concerne- été abaissée peu de temps après la mise en service des premières rames, pour limiter leur sollicitation et allonger leur durée de vie (les versions adoptées sur les rames Réseau et Duplex ont bénéficié de certaines amélioration, notamment au niveau de la tenue en charge et du refroidissement). Côté LN, si la vitesse potentielle de tracé a préservé le 350 (ce sont encore des infras étudiées à l'origine par l'infra SNCF), BPL devrait être exploitée à VL320 pour le matériel le permettant. Pour SEA, le dossier d'enquête publique prévoit la perspective du 320 en exploitation mais évoque une phase transitoire à VL300. RFF a tenu un discours ambigu sur ce sujet d'ailleurs. Car s'il est logique que les rames A demeurent à VL300, d'autres matériels circuleront sur ces deux lignes, aptes pour la majorité d'entre eux à 320. Christian
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Sur le dernier point, la modernisation d'une partie du parc PSE ne concerne en rien la chaîne de traction ni la partie mécanique d'une manière générale. La modification V300 de 7 des 9 éléments Bougogne/Franche Comté demeurés à V270 et équipés de la TVM300 est une opération indépendante, qui aura été réalisée avant la Rénov. Cette modification a été couplée avec l'opération de prolongement de parcours (OPPR), qui constitue la remise à niveau technique d'ensemble des rames (mais sans amélioration des performances nominales) accompagnant la Rénov (cette dernière visant les aménagements intérieurs et la livrée). La majorité des OPPR devaient être réalisées en même temps que la Rénov mais cette dernière ayant pris du retard, nombre de rames sont/seront probablement traitées en OPPR puis réinjectées en roulement, avant de bénéficier de la Rénov. Pour revenir au sujet du financement des LN, les prolongements de LGV déjà existantes nécessitent généralement des besoins de financement inférieurs aux LN "isolées" du réseau GV ou se substituant à une exploitation assurée en trains classique (cas des LGV RR et Est, respectivement). Cela explique que la LGV Bretagne-Pays de la Loire puisse être financée à 40% par les péages i.e. par les voyageurs, les investissements de l'entreprise ferroviaire étant peu importants (ils ont déjà été réalisés... et on améliore leur productivité), donc sa capacité contributive plus élevée. Néanmoins, la dérive importante des coûts constatée sur les projets moins avancés en termes de procédures tend à rendre marginal cet écart entre lignes nouvelles, les besoins en concours externes (aux acteurs ferroviaires) devenant dans les deux cas prépondérants, parfois jusqu'à la caricature. C'est une vérité de La Palice que de rappeler que les LGV les plus rentables sur le plan économique et socio-économiques ont aujourd'hui été réalisées (on a commencé par la plus intéressante évidemment [sur ce plan], à savoir Paris-Lyon). Mais cette réalité/écart est fortement amplifié(e) par le fait que le système ferroviaire français évolue à l'image de celui d'outre Manche pour ce qui concerne les coûts de son infrastructure, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la collectivité. Or si le constat des difficultés de financement est devenu récurrent, peu de nos élus et dirigeants semblent s'interroger sur les raisons de cette situation et les solutions pour tenter de corriger le tir, au moins partiellement. Christian
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Salut, sur un matériel équipé (ou pré-équipé) EAS, ce mode de fonctionnement permet de raccourcir la séquence de départ à chaque arrêt, donc est un plus pour la tenue de l'horaire et la performance de la marche. Cela n'implique nullement la suppression des ASCT à bord du train, comme tu le confirmes ici. Ils peuvent se consacrer pleinement à leurs tâches commerciales.
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Dans le prolongement de message de PN407, on peut rappeler que le caractère très politique de la référence au double itinéraire Paris-Francfort par la Sarre et via Strasbourg, le second étant potentiellement plus rapide une fois réalisée la seconde phase de la LGV Est (le projet initial de LN entre Kaiserslautern et Neustadt étant passé aux oubliettes lors de la signature de l'accord). Toutefois, pour obtenir le temps de parcours cités, il restera à boucler la modernisation du tronçon Kehl-Appenweier, renvoyé à un horizon lointain (pour le V200 du moins et la reprise du racc d'Appenweier). Côté français, la mise à niveau de Strasbourg-frontière s'est faite a minima, la VL160 prévue au franchissement de la frontière (pas encore effective côté Kehl) n'étant pas atteignable dans la pratique (la zone non alimentée du changement de tension étant positionnée juste en aval du point de transition de vitesse...). Au delà de Francfort, la réduction du temps de parcours vers Berlin suppose l'amélioration des tronçons (peu performants) encore en ligne classique, pas prévu à brève échéance. Je n'ai pas bien compris la raison de la mention de la NBS (Nuremberg) Erfurt-Leipzig dans le contexte qui nous intéresse ici, ce projet (faisant partie du grand programme d'infrastructures devant accompagner la réunification de l'Allemagne) intéressant le courant Munich-Berlin, pas Francort (ou Mannheim)-Berlin. Pour répondre à 5121 (à qui je décerne un bon point pour l'utilisation de la gare de Massy TGV ! ;-) ), je ne nie pas le rôle joué par les relations TGV Province-Province existantes, mais il ne faut pas perdre de vue que nombre d'entre elles (à la différence des "TGV de jonction", i.e. ceux transitant par l'IdF) se sont substitués à des relations Corail, cas des Metz-Lyon-Midi (mise en place pour plusieurs d'entre elles dans les années 80, après la contraction forte [et logique] de l'offre classique sur l'artère Paris-Dijon-Lyon). La refonte récemment réalisée sur Metz-Midi aura même conduit à réduire l'offre à certaines périodes et à un immense trou horaire de 8 à 16 h entre la deuxième et troisième (maigre) fréquence quotidienne au départ de Metz vers Lyon... Je suis d'accord avec ton constat sur l'économie plus favorable des offres contournant Paris (par rapport aux Prov-Prov sans lien avec l'IdF), notamment du fait qu'elles agrègent des trafic IdF-Province et Province-Province et utilisent de manière plus forte le réseau GV. Pour autant, il y a quand même du trafic à reprendre à l'autoroute et (dans une moindre mesure) à l'avion sur certaines OD Province-Province, à condition de concevoir intelligemment les dessertes i.e. en jouant au maximum la synergie entre différents segments de trafics. Pour ce qui concerne le développement des dessertes TGV intersecteurs (au sens large du terme), les acteurs de leur mise en place pourraient mieux que moi expliquer les difficultés vécues pour imposer ce type de relations "hors normes" auxquels peu de monde croyait (sur le plan de la viabilité économique). Dans les années 90, une "unité d'affaires" intersecteurs fut créée au sein de la maison GL. Ce fut une avancée par rapport à la situation antérieure (et au retour en arrière d'aujourd'hui avec la création des axes répondant à la seule logique radiale dominante dans leur organisation interne) mais cette UA ne jouait pas dans la même cour que les trois autres (SE, ATL et NE). Pour espérer faire aboutir un projet de nouvelle desserte, il a fallu bien souvent ruser et présenter des perspectives économiques un peu optimistes voire gonflées, pour éviter de voir la proposition retoquée ou dans le meilleur des cas renvoyée au service suivant... Illustration plus récente : la mise en service de la relation TGV Strasbourg-Marseille, en remplacement d'une desserte Corail existante Strasbourg-Lyon (donc peu génératrice de km-trains) et qui constituait un juste retour des choses après la suppression du Rouget de Lisle (au sud de Lyon) avec le TGV Méd, qui fut laborieuse et difficile. Le projet n'aboutit que grâce à l'opiniatreté de quelques personnes (dont ma pomme) et des pressions politiques (qui conduisirent l'actuel pdt, alors DGD Clientèles, à trancher dans le sens positif, contre une direction GL majoritairement opposée, malgré l'augmentation des prix retenue sur la relation). L'histoire se répète... S'agissant du matériel, vu la contraction de l'offre décidée sur l'axe nord-sud, une utilisation plus importante d'US Duplex (plutôt que d'US PSE rarement forcées en UM) aurait eu du sens. Ce devrait d'ailleurs être le cas sur au moins 2 A/R (mais le catalogue de sillons RFF a été bâti sur la base du matériel le moins performant prévu sur cet axe). Et l'utilisation de matériel Réseau (remplacé par du Duplex) aurait été plus adaptée que celle d'engins trentenaires dont la chaîne de traction ne sera pas modifiée (la rénov concerne les aménagements intérieurs, il n'y a aucune amélioration majeure sur le plan technique). D'où tires-tu cette conclusion ? Sur la LGV Est, la "propagande" officielle a conclu effectivement dans ce sens mais il est facile de faire dire aux chiffres ce qu'on veut, vu que l'offre mise en place fut plus élevée que celle prise en compte dans les prévisions de trafic initiales et la situation de référence (celle sans mise en service de la LGV) au démarrage de l'exploitation du TGV Est plus basse que prévue (donc le delta fut plus élevé que celui annoncé [volontairement minoré, par prudence et parce que ce projet n'enthousiasmait pas outre mesure l'entreprise sur le plan économique, à juste titre à vrai dire] mais les chiffres en valeur absolue sont relativement proche des prévisions... si l'on fait les calculs avec la desserte réellement mise en place, plus riche que celle du dossier d'approbation ministérielle, sur les relations avec Paris [l'épisode observé sur le RR se répète donc une nouvelle fois]). Aujourd'hui, RFF fait ses propres prévisions de trafic et bilans économiques (dans un système désintégré et à terme ouvert à la concurrence c'est difficilement évitable)... il est donc plus que compréhensible que les perspectives de recettes annoncées par ce dernier soient plutôt "a minima" car c'est autant de gagné sur la part qu'il lui sera demandée de financer, via les péages versées par les EFs... Hélas, au vu des performances annoncées pour ce projet (sur Paris-Lyon) et surtout du coût de l'infra, devenu vraiment déraisonnable (RFF avance le chiffre de 12 à 15 G€ suivant le fuseau retenu), je vois difficilement comment l'Etat, les collectivités et les EFs (i.e. les voyageurs au final) pourraient le financer, qui plus est dans un contexte où la régénération du réseau classique (au moins les axes principaux) doit absolument se poursuivre (et là aussi, les coûts ont plus que dérapé). Avec l'itinéraire envisagé pour cette LGV 1 bis, sa pertinence pour relier Paris à Lyon et au SE ne pourra être qu'à la marge, à moins qu'un abaissement de la VL soit mis en oeuvre sur la LGV 1 (on peut s'attendre c'est vrai... les détentes pour travaux sur le réseau classique ayant explosé depuis 4 ans). L'équation économique du POCL ou de la LGV PACA, dans l'état actuel de ces projet, n'a pas de solution (ou alors hors de l'espace réel... pour emprunter [en la déformant un peu] un raisonnement cher aux mathématiciens).
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Salut, Tu reprends ici le discours "anti-intersecteurs" en vigueur chez nombre de dirigeants de la grande maison, lorsque de rares visionnaires poussèrent à la création d'un réseau TGV i.e. de dessertes qui ne seraient plus uniquement orientées de/vers Paris (on a commencé par construire le barreau d'interconnexion... contesté par ces mêmes dirigeants de l'époque et encore certains aujourd'hui, cf. infra). Quand Michel Walrave (ancien DGD Développement de la SNCF, grand technicien et économiste, qui est pour beaucoup dans le dvpt du TGV) évoquait la perspective de 10 à 12 A/R Lille-Lyon (Midi) au début des années 90, beaucoup de ses interlocuteurs considérèrent cette perspective comme utopiste et déraisonnable sur le plan économique... Le principal réservoir de croissance du trafic TGV se situe sur les relations Province-Province, où l'offre ferroviaire demeure médiocre à quelques exceptions près, sur le RFN. Le train a une part modale de l'ordre de 30% sur les OD IdF-Province et de moins de 10% sur le Province-Province (à plus de 100 km). Or le premier représente 25% des déplacements en France, le second 75%. C'est une vérité que refuse de voir la maison Voyages et nombre de dirigeants de la technostructure ferroviaire française. Le récent propos tenu par D. Azéma (le DG Finance de la SNCF) dans Rail, Villes & Transports en est une illustration parmi d'autres (la DG de Voyages, qui connaît peu le ferroviaire -forcément vu son parcours professionnel- mais reprend le discours tenu par ses proches collaborateurs, a peu ou prou la même position). La SNCF a soutenu depuis le début le projet TGV Aquitaine, devenu SEA, exprimant dans ses positions internes comme vis à vis de l'Etat sa nette préférence pour le second projet (je l'ai vu au quotidien, m'étant occupé des deux projets). Si celui-ci a pris tant de retard, ce n'est pas la "faute" du Rhin-Rhône mais compte tenu de son coût global et parce qu'à la différence des collectivités concernées par le premier, celles desservies par SEA ont mis beaucoup de temps à comprendre que sans une démarche collégiale appuyée auprès de l'Etat, leur projet n'avancerait pas (nombre de régions ou de maires de grandes villes étaient au départ engagés dans le soutien du projet). L'évolution du fonctionnement du système ferroviaire français et la volonté de retenir le contestable montage en PPP (de SEA) ont fait le reste. La réalisation de la branche Est doit très peu à l'opérateur historique (si l'on excepte les quelques personnes motivées et convaincues de l'utilité socio-économique de ce projet, qui ne figuraient pas parmi les décideurs de l'entreprise) mais pratiquement tout aux élus (J-P Chevènement au premier chef, et certains élus alsciens), à certains politiques nationaux, et à une association regroupant les collectivités et les élus (Trans Europe TGV RR Méditerranée). Pour prolonger la remarque de Roukmoute, la "banane bleue" (dans laquelle s'inscrit la LGV RR) est le premier corridor de transport de voyageurs à longue distance en Europe. L'essentiel du trafic est sur la route. L'avion ne représente que 5% des déplacements à plus de 100 km en France et pour les relations avec les pays proches de l'UE. On l'oublie souvent, obnubilés par la seule concurrence aérienne alors que le premier mode "concurrent" du cdf, c'est la route (au sens large du terme). Bien évidemment, les parts captables par le cdf sont faible en longue distance et modestes en moyenne distance, mais un potentiel non négligeable existe, donc peu de beaucoup, ça représente quand même de quoi à remplir plusieurs trains. La LGV RR oblige à sortir du mono-concept dans lequel la France s'est inscrite en matière de dessertes GL depuis le développement du TGV (à l'exception des dessertes IS), à savoir le "point à point" centré sur Paris. On peut très bien remplir des TGV en agrégeant des OD à moyenne et longue distance. La production est plus complexe à mettre en oeuvre mais ça a longtemps été le B-A BA du cdf (aujourd'hui, on considère qu'on ne sait plus "produire" un train à tranches multiples, car c'est trop complexe et effectivement, la qualité n'est plus au rendez-vous). Bien évidemment, cet axe ne sera jamais un second Paris-Lyon... la géographie humaine et l'effet frontière étant ce qu'ils sont... Mais le constat auquel arrivent nombre d'observateurs sur le niveau de trafic modeste attendu sur cette LGV est pour partie la conséquence de choix minimalistes en matière de dessertes, qui ont conduit à réduire l'offre prévue sur les relations nord-sud, au fur et à mesure de l'avancement du projet. L'argument invoqué à chaque fois (car l'offre prévue fut réduite à 2 reprises depuis les engagements de l'enquête publique) fut l'augmentation des péages RFF... argument bien réel (qui renvoie à la responsabilité de l'Etat dans cette évolution) mais tout de même pour partie contestable dans le sens où l'on renforça dans le même temps la desserte avec Paris, tout autant impactée par les péages (ceux de la LGV SE étant les plus élevés au km). C'est la première LGV où l'on sera quasiment à offre constante (sur l'axe nord-sud) alors que les gains de temps annoncés dépasseront 1 h et le nombre de ruptures de charges sera réduit.... Ce choix de "développement" a minima reflète avant tout un manque de volonté évidente de développer les relations Province-Province (pour lesquelles une contraction de l'offre est envisagée dans les années à venir). Alors au vu des "efforts déployés", il est facile d'expliquer qu'il n'y a pas d'enjeux sur ce projet, en dehors des relations Paris-Province/Suisse alémanique. Le choix d'affecter le matériel le moins performant et le plus ancien (PSE) sur une majorité des dessertes nord-sud est aussi révélateur des priorités données en matière de développement du trafic sur cette LN... S'agissant de l'ICE 3 de la DB attendu sur le RR, la série 407 a pris du retard dans se mise au point (vu les difficultés rencontrées sur Paris-Francfort, il n'est pas souhaitable d'engager du matériel à la fiabilité plus que perfectible, donc c'est sans doute une bonne chose de ne pas se précipiter). De plus, compte tenu de la contraction de l'offre décidée par l'EF SNCF sur l'axe nord-sud, la seconde relation proposée aux allemands pour le trafic Allemagne-Sud France reprend la seule mission passant par la ligne du pied du Jura, concession politique imposée par l'Etat suite à la situation de blocage rencontrée en Franche-Comté (les élus jurassiens s'estimant à juste titre les grands perdants de la mise en service de la branche Est). Donc le temps de parcours de/vers Lyon et Marseille n'est pas vraiment attractif pour cette relation, ce qui n'a pas motivé fortement la partie allemande, c'est un euphémisme. Argument à relativiser comme l'a précisé Frédéric, car d'une part le nombre de sillons ajoutés est limité (il est supérieur aux 2/sens évoqués initialement, vu que l'offre Paris-Province/Suisse a été renforcée par rapport au DAM et que Paris-BFC avait été "rationnalisé" au fil des années), d'autre part les sillons PSE à V270 vont disparaître, ce qui redonne de la capacité à la ligne (les 2 sillons actuels V270/heure prévus dans la trame de sillons RFF consomment l'équivalent d'un sillon V300). Ton combat anti-TGV (ici et sur d'autres forums) te conduit à ce type d'analyse à l'emporte-pièce, dyonisos. La LGV RR n'est pas une LGV Est bis. C'est une vision très parisienne que de raisonner de la sorte (même si tu es aidé par la vision qu'ont de ce projet nombre d'acteurs du ferroviaire... hélas). Ta comparaison n'est pas vraiment objective. D'un côté tu prends la population de la quasi-totalité de l'IdF alors que de l'autre, tu te limites à la seule agglo de Strasbourg. Quand on réalise des prévisions de trafic (ce fut mon quotidien 5 années durant), on intègre l'ensemble des pôles générateurs de trafic. Sur l'axe nord-sud, Strasbourg (dont l'aire urbaine dépasse les 500 000 h) n'est pas le seul pôle de trafic. Il faut en fait intégrer l'essentiel de la population alsacienne et celle du nord de la Franche-Comté, on est donc au-dessus de 1,5 millions d'habitants pour la zone nord, en trafic nord-sud franco-français. La LGV RR était au départ un projet à trois branches, qu'on a tronçonné en petits morceaux du fait du refus de l'Etat et de RFF de réaliser la branche Est (pourtant modeste en termes de coûts à l'origine... avant l'inflation actuelle constatée sur les projets ferroviaire, toutes opérations confondues -cf. SEA par exemple-) d'une seule traite. Il est clair qu'en imposant ce tronçonnage, c'est surtout l'axe nord-sud qui allait être pénalisé (la non-réalisation du tronçon nord coûte jusqu'à 25' dans la configuration d'offre la plus performante, avec la branche Est complète). Pour beaucoup de dirigeants, ce projet est une hérésie dans le sens où il ne prolonge pas -en continuité s'entend- une LGV existante... Si l'on raisonne ainsi, il n'y a pas d'avenir pour la GV en France en dehors de la nouvelle étoile de Legrand constituée par les LGV 1,2,3,6 et leurs prolongements. Tant pis pour les 3/4 des voyages annuels qui n'ont pas l'IdF pour origine ou destination et pour le trafic international qui ne vise pas que Paris... Les mentalités ont décidément bien du mal à évoluer en France. Regardons un peu hors du seul prisme parisien... Christian