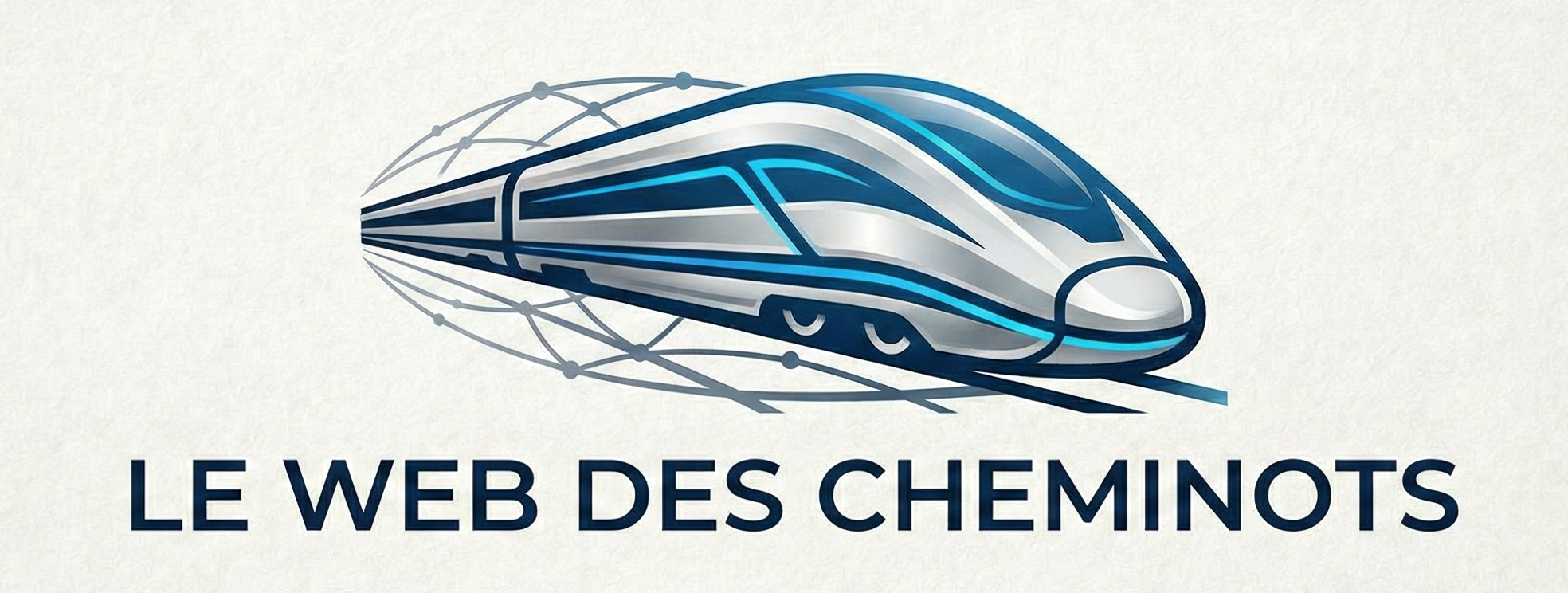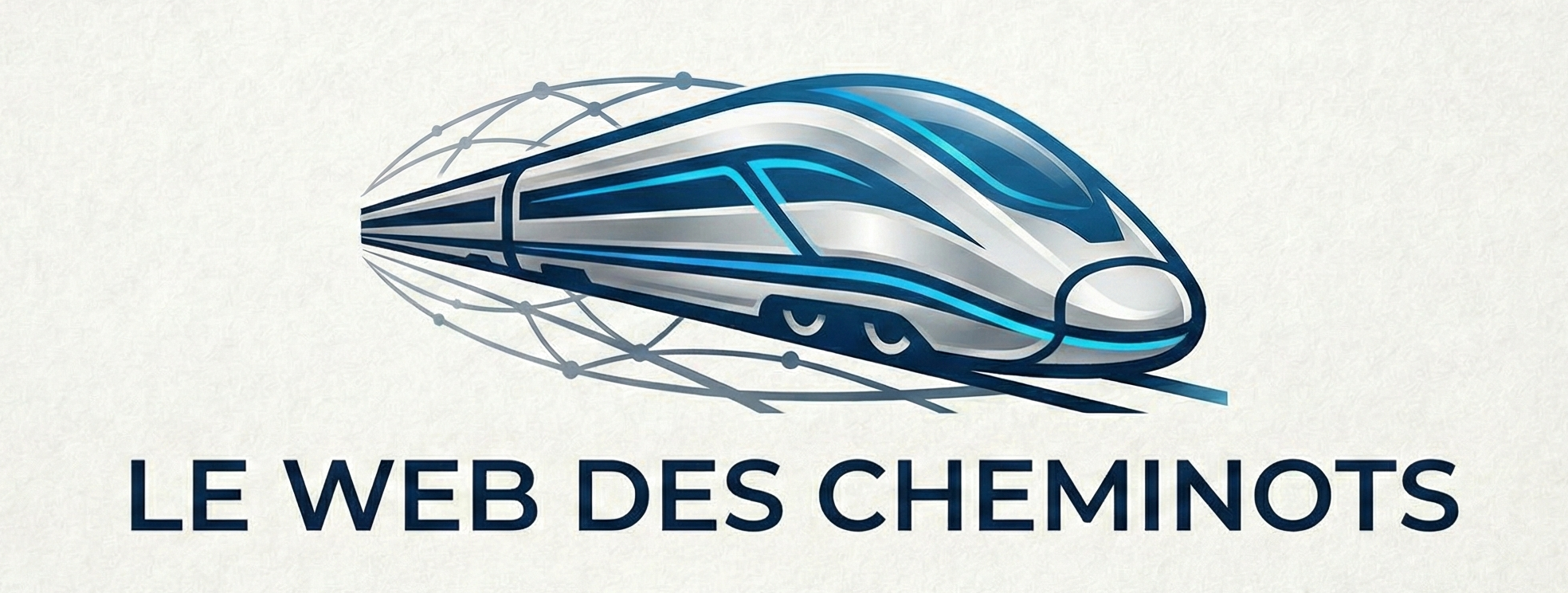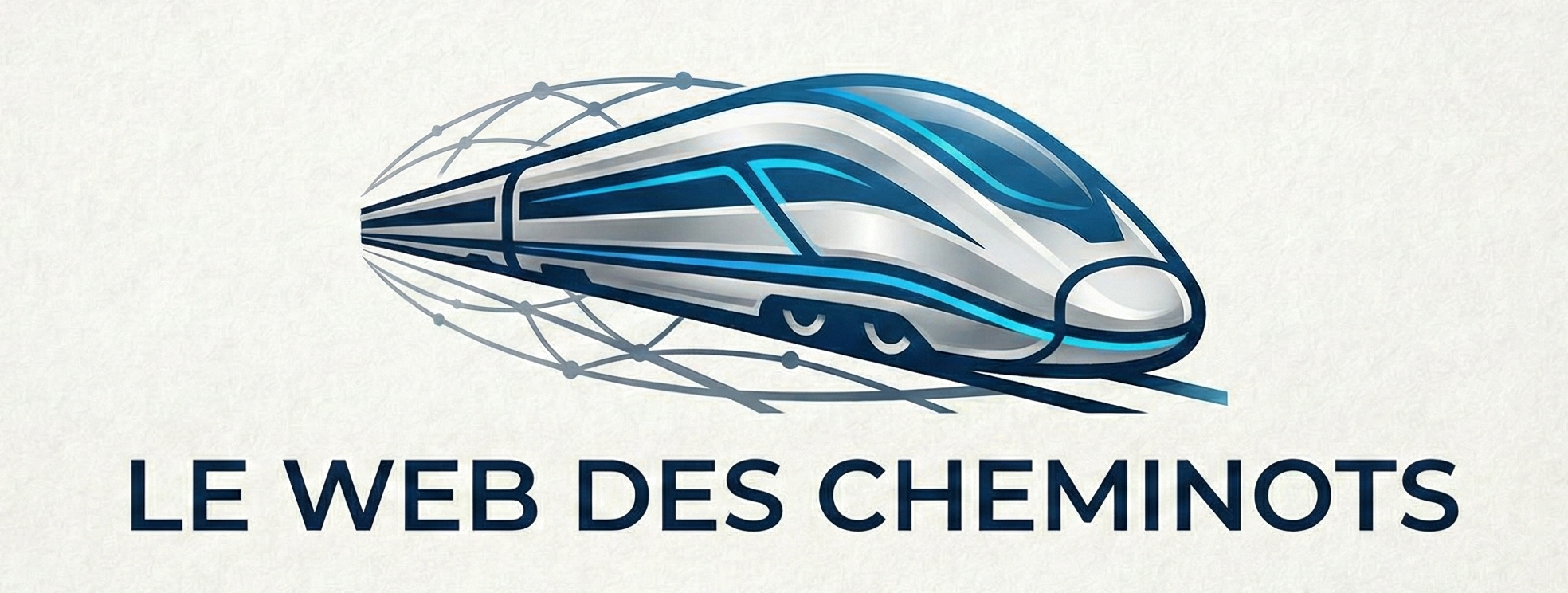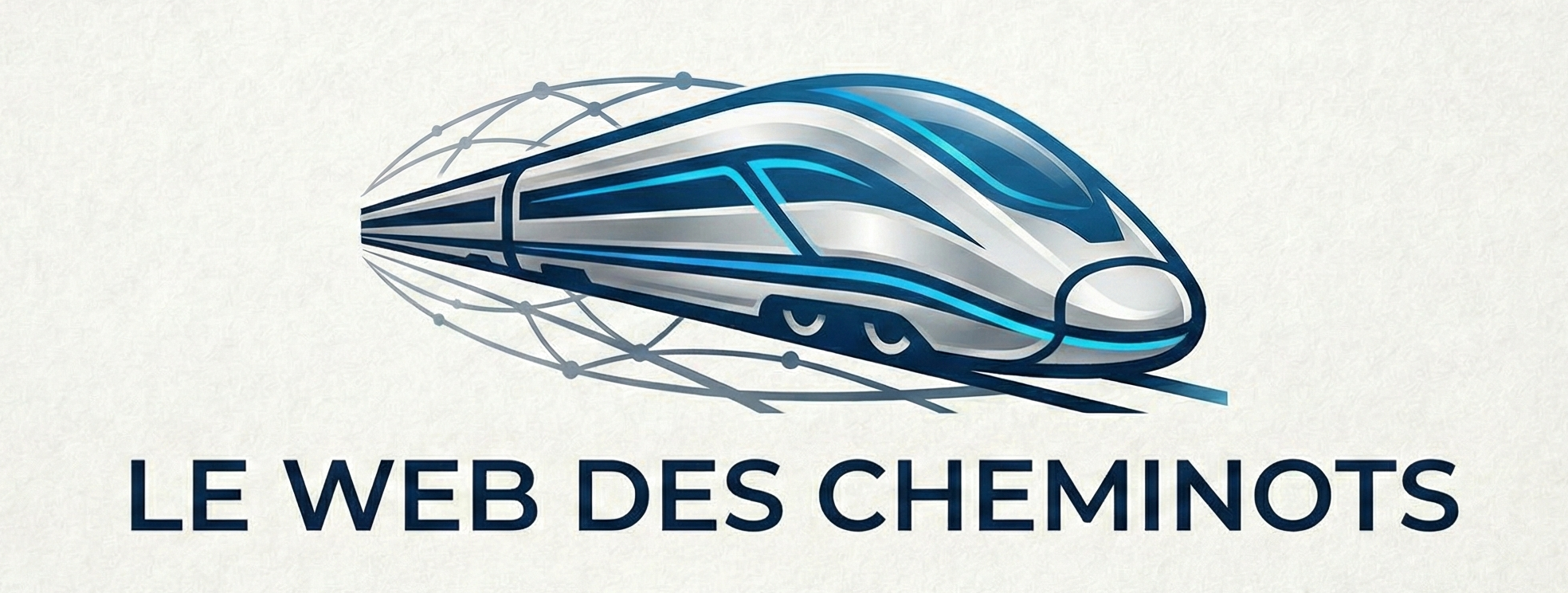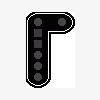Tout ce qui a été posté par pompon
-
Cabines et pupitres de conduite
Mouais. Avec un truck à mon avis c'est pareil. Les signaux bas ou les agents de manoeuvre, ils ont vite fait de disparaître du champ. Je sais qu'il y a pire que les 64700, mais tu ne m'empêchera pas de penser qu'un pupitre derrière un grand pare-brise c'est quand même mieux. Evidemment ça oblige à changer de poste à chaque fois qu'on change de sens, mais... vous n'êtes pas des culs-de-plomb, que je sache? controleursncf
-
[Alstom] - Contrats, infos générales, projets
Cf. réponse de Vinces. Par ailleurs c'est pas parce qu'on remplace les cantons fixes par des cantons mobiles, que ça devient gratuit... (j'aurais tendance même à penser le contraire).
-
[Alstom] - Contrats, infos générales, projets
Il n'y a pas que ça! Il faut aussi redécouper les cantons. Sinon, il faut un canton de plus pour la séquence d'arrêt, et malgré l'accroissement de vitesse ça réduit le débit de la ligne. Si RFF veut bien payer une transformation quand même assez lourde de la signalisation, tant mieux...
-
Freinage TGV
C'est assez rationnel, quand on y réfléchit un peu : en banlieue il est plus facile d'équilibrer "l'offre" et la "demande" de courant, que sur la ligne Béziers-Neussargue (par exemple )
-
Les Perles Du Dialecte Cheminot
Moi je ne me suis jamais permis d'être insolent avec mes Chefs ...mais j'aime bien la façon dont on m'a expliqué le principe de la prise de sens, quand il y a enclenchement de sens : "Tu as un relais de sens dans chaque poste, et c'est le premier qui bande qui encule l'autre." :Smiley_25:
-
Freinage TGV
A ma connaissance, mais je ne suis pas expert en la matière : 1) le freinage par récupération n'existe pas que sur les TGV, mais aussi sur certaines locomotives classiques; 2) le courant produit n'est pas redistribué sur le RTE, il est beaucoup trop irrégulier pour ça. Le freinage par récupération n'est possible que quand il y a d'autres trains qui tractionnent dans le même secteur que les trains qui freinent, de façon à équilibrer globalement le circuit; 3) il n'y a pas de miracles : soit un train consomme du courant, et accumule de l'énergie cinétique, soit il en produit, et perd de l'énergie cinétique. Il ne peut pas à la fois consommer et produire du courant! Théoriquement l'énergie restituée pendant le freinage pourrait être presque aussi importante que celle consommée pendant l'accélération. En pratique, je suppose qu'on en est assez loin.
-
Vidéo AGV
Oui c'est vrai qu'on aurait pu avoir pire! Il me semble que le nez bizarre des Shinkansen dernier cri a plus pour but de réduire l'effet de piston à l'entrée des tunnels, que de réduire la résistance à l'avancement à l'air libre. En aérodynamique "pure", c'est-à-dire à l'air libre, la forme du nez du TGV est très bien. Son défaut est peut-être de laisser passer un peu trop d'air sous le train, parce que sur la longueur d'un train la couche d'air qui frotte entre les caisses et le ballast, contribue énormément à la résistance à l'avancement. Mais allonger le nez n'apporterait pas grand chose. Je pense que le gain aérodynamique de l'AGV s'explique plus par un meilleur profilage des détails (essuies-glaces, raccords divers, carénage des bogies) que par la forme du nez.
-
Vidéo AGV
Moi aussi. Le nez du TGV classique peut aussi faire du 360, et même du 574,8. En fait c'est du bluff cette histoire de vitesse de l'engin : la vitesse réelle dépendra du cantonnement de la ligne sur laquelle il circulera. Sur les LGV existantes, il roulera à 300 ou 320, comme les TGV.
-
Pourquoi les MI2N et Z2N sont dispensées de respecter les TIV type C
Très instructif, mais ça n'explique pas tout. Il y a un rapport avec la masse freinée ? Et les amortisseurs, quel rôle jouent-ils là dedans?
-
Cabines et pupitres de conduite
Je vois très bien ce que tu veux dire... donc, si je comprends bien, tu ne changes pas de poste de conduite? La visibilité à gauche, tu t'en fous? revoltages
-
Ecartement de la voie
Voilà une hypothèse bien plus vraisemblable en effet. Les dates ne concordent pas tout-à-fait avec celles du Larousse, il faudra creuser cette histoire...
-
Rech. info sur technicien supérieur études
Il est possible et même fort vraisemblable qu'on te propose une affectation dans nos labos : Vitry pour le Matériel, ou Saint-Ouen pour l'Equipement (laboratoire des rails, des bétons, des télécoms, de la signalisation). Je ne te décris pas le boulot, je pense que tu ne seras pas dépaysé!
-
Rech. info sur technicien supérieur études
Descriptif... en fait, il y a plein de postes possibles. Déjà, deux grands domaines : soit tu seras à l'Equipement, soit tu seras au Matériel. Et dans chaque domaine, des spécialités : voie, caténaires, signalisation, télécommunications (ça c'est pour l'Equipement). Au Matériel, je ne connais pas. Il y a les wagons, les locos diesel ou électriques, les freins, l'électricité, les systèmes embarqués, mais je ne sais pas comment tout ça est organisé. Je sais seulement que l'ingénierie Matériel est beaucoup plus décentralisée que l'ingénierie Equipement, les études se font essentiellement dans les établissements (qui viennent d'être rebaptisés "technicentres" mais en gros, ça reste des usines...) Bref. Ton boulot, d'une manière générale, sera de vérifier que les prestations ou le matériel fournis par les constructeurs, répondent bien aux cahiers des charges de la SNCF. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose... Concrètement, pour les études des postes d'aiguillage par exemple, c'est très codifié. Il y a ce qu'on appelle les Plans Techniques qui sont faits par la SNCF, qui décrivent précisément les besoins fonctionnels, ainsi que les Directives d'Etudes (génériques et propres à chaque poste) qui décrivent les règles de l'art. Et le boulot d'un technicien supérieur consiste à faire la directive d'étude propre au poste et à vérifier que les schémas de réalisation du poste d'aiguillage sont conformes à tout ça. ça peut être aussi de faire l'étude elle-même quand c'est sur des installations déjà exploitées, parce qu'il y a des phases à prévoir et les constructeurs ne savent pas trop gérer ça, d'autant plus qu'on travaille sur des installations anciennes, des vieux schémas... L'homologation des produits est un peu moins codifiée, on travaille sur des prototypes (ex : un nouveau type de feu, un nouveau système de contrôle de vitesse...) Les cahiers des charges ont une forme plus classique, il faut rédiger des cahiers d'essais pour nos laboratoires, faire un examen critique des PV qui reviennent des labos, reporter les anomalies aux constructeurs, négocier avec eux les modifications à apporter au prototype... Bien entendu, on ne te demandera pas de faire une étude tout seul du jour au lendemain. Il y a 25 semaines de formation environ, en école et sur le terrain. Je te donne juste deux exemples, en fait il y a plein de spécialités possibles et chacune a un peu sa façon de travailler.
-
Ecartement de la voie
J'ai entendu cette explication à Nanterre il y a 15 ans, et pourtant je n'y ai jamais cru. Mon petit doigt me disait que pour trouver une mesure de 4 pieds 8 pouces 1/2 en accolant deux chevaux côte à côte... mais pas trop près l'un de l'autre... il fallait vraiment avoir envie de tomber sur 4 pieds 8 pouces 1/2! En fait il s'agit simplement d'un chiffre "rond" pour un Anglais. Le développement du chemin de fer fut très anarchique à ses débuts, en Grande-Bretagne. Chaque compagnie avait son écartement. Chacune avait elle sa vision de la largeur d'un cheval ? L'un des réseaux les plus connus au début du 19ème siècle, à traction animale, a un écartement de 48 pouces, soit 1,22 m. La loi mit un terme à cette pagaille en imposant en 1843 un écartement unique, celui utilisé par Stephenson. C'était celui des mines de Killingworth (4,5 pieds) majoré d'1/2 pouce pour assurer le jeu dans les courbes. Il faut noter que dans l'empire Romain, les chariots étaient guidés par des ornières taillées dans les chaussées. L'écartement des chariots était déjà fixé par une loi et un charron qui ne la respectait pas risquait la peine de mort. (source : Larousse des trains et des chemins de fer, Clive Lamming) Difficile de connaître la valeur de cet écartement : il semble qu'au cours des siècles il ait varié de 1,1 m à 1,44 m... Quoi qu'il en soit, le moins que l'on puisse dire est que les Anglais n'ont suivi l'exemple Romain que très tardivement, et qu'ils n'ont pas spécialement retenu la valeur en vigueur pour les chariots Romains, mais plutôt celui du constructeur le plus influent.
-
Pourquoi les MI2N et Z2N sont dispensées de respecter les TIV type C
Ah oui, merci de ce rappel... mais ça ne nous donne pas la réponse!
-
Cabines et pupitres de conduite
Ah! Je suis bien content de trouver quelqu'un qui affirme que les 64700 sont faites pour la manoeuvre, parce qu'elles ont un pupitre transversal... Peux tu justifier ton propos? (pour les béotiens comme moi qui n'ont jamais conduit de train et se demandent bien quel intérêt il peut y avoir à se tenir de côté pour conduire!)
-
[BB 15000] Sujet Officiel
Euh... oui et de plus elle n'a pas de panto de secours, donc la question se pose encore moins! Je m'égarais...
-
[BB 15000] Sujet Officiel
Effectivement les 15000 sont à hacheur, non?
-
Pourquoi les MI2N et Z2N sont dispensées de respecter les TIV type C
Parce qu'ils sont sensés respecter les TIV de type B. (et les TIV ordinaires, bien sûr!)
-
Demissioner a la SNCF
Non, il relève du code du travail.
-
[BB 15000] Sujet Officiel
Non, même les monotension (BB 16000, 17500...) ont deux pantographes. La 15000 est l'exception. Je pense qu'il s'agit d'un souci d'économie, tout simplement. Après, c'est vrai que j'imagine mal un train lourd repartir sous 1500 V avec un panto prévu pour 25000. Mais à vrai dire je n'en sais rien.
-
Cabines et pupitres de conduite
Existe-t-il vraiment des machines faites pour la manoeuvre? :rolleyes:
-
Bourrage et entretien de la géométrie
Ouf, j'ai quelques restes. Je maintiens qu'un rail ne s'oppose pas à sa propre déformation. :rolleyes:
-
Bourrage et entretien de la géométrie
Allez, un peu au hasard, je dirais 25°.
-
Bourrage et entretien de la géométrie
Bah, tout fout l'camp... :rolleyes: