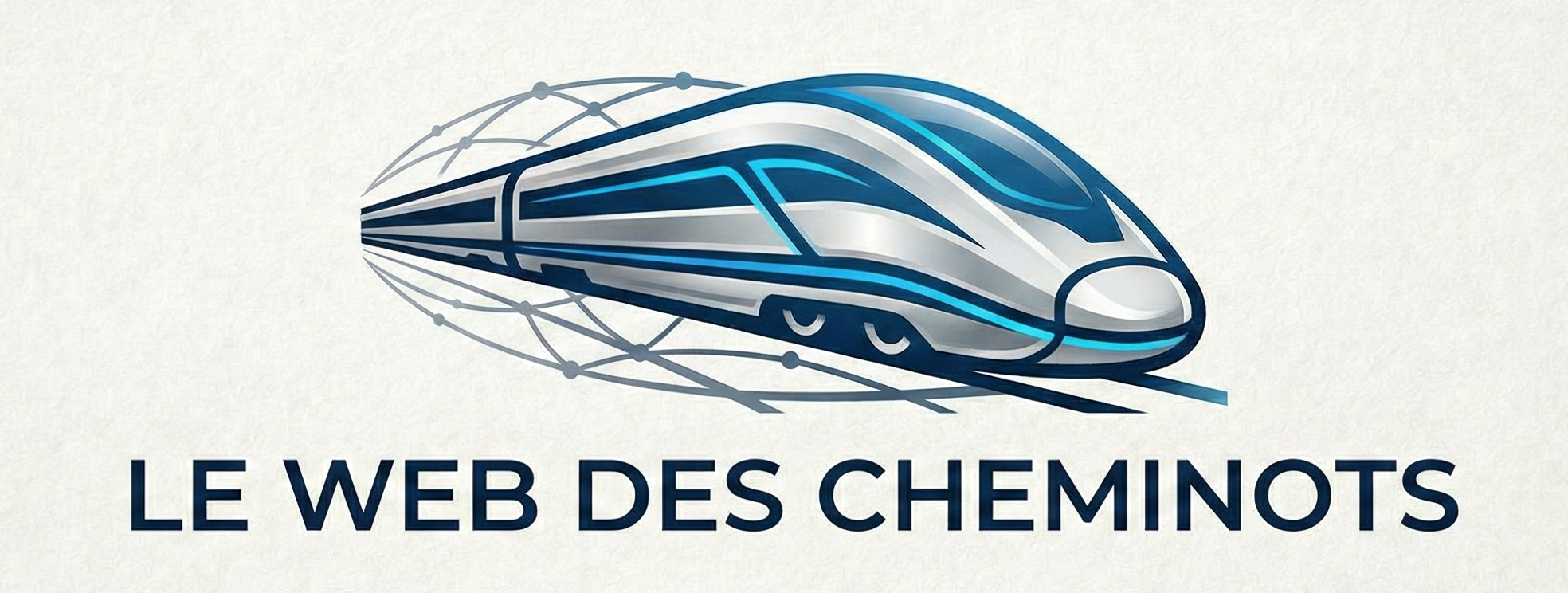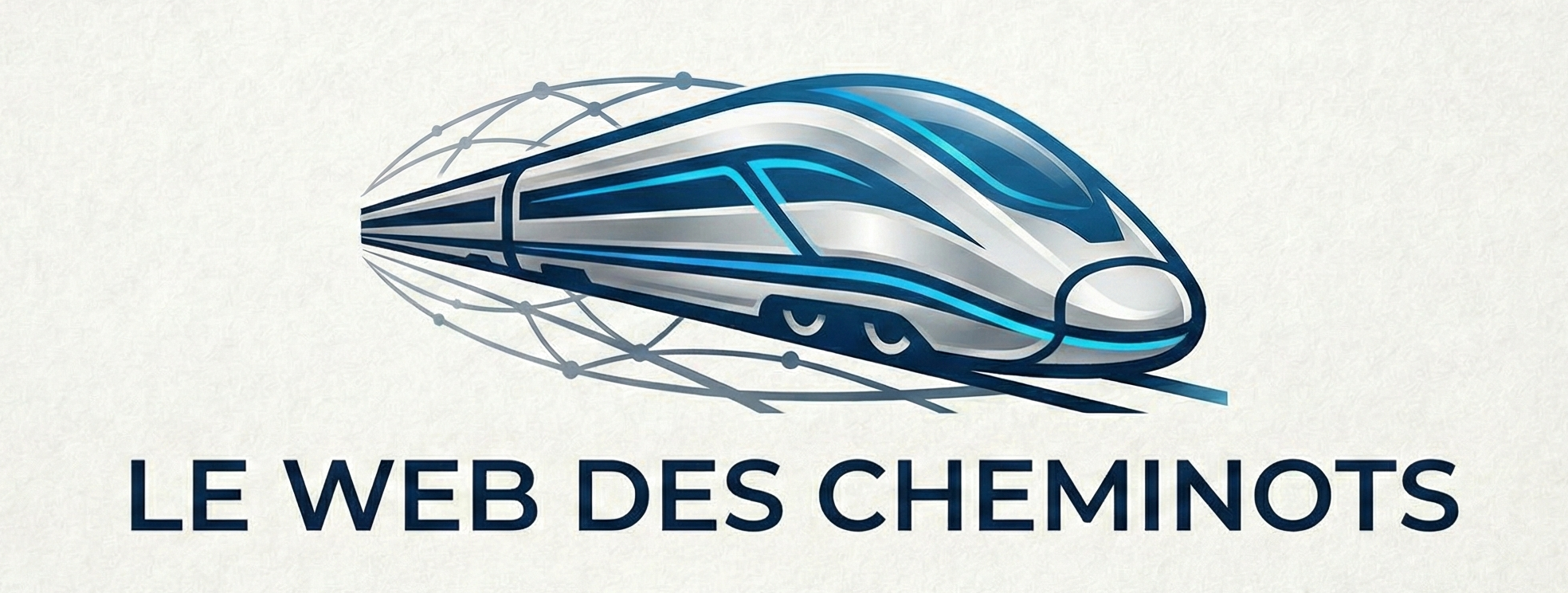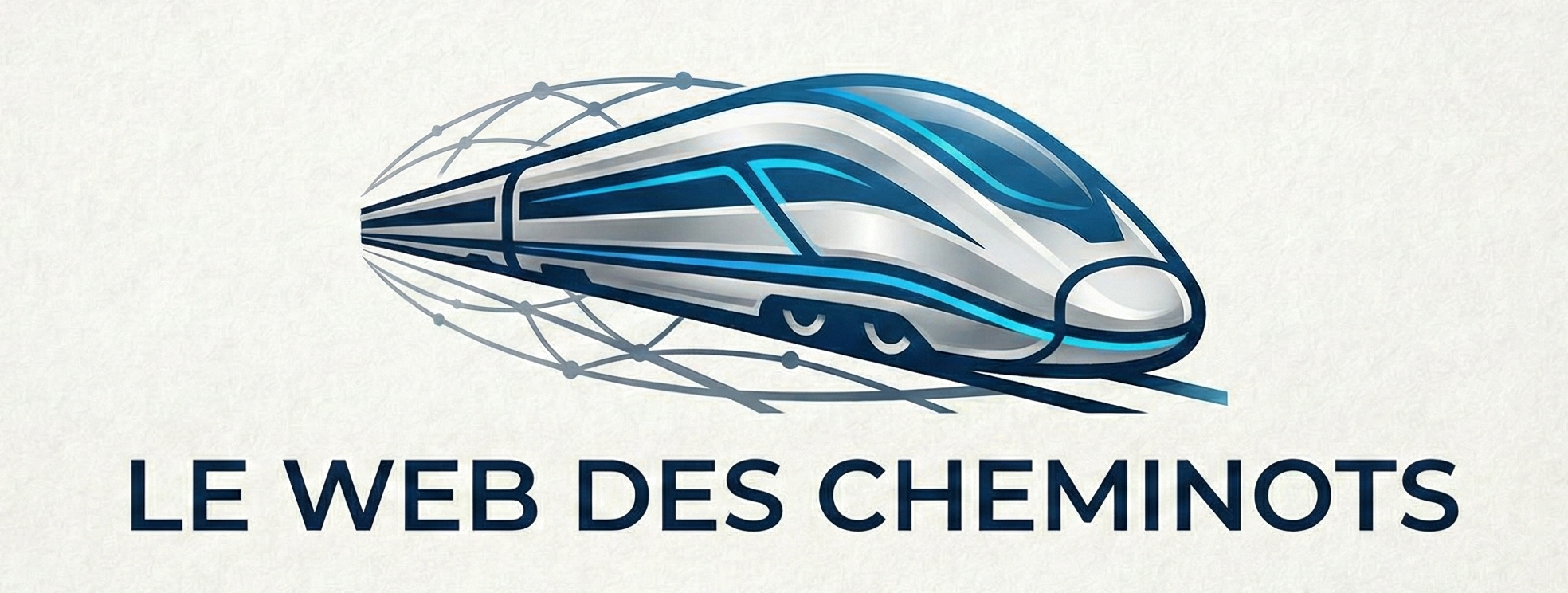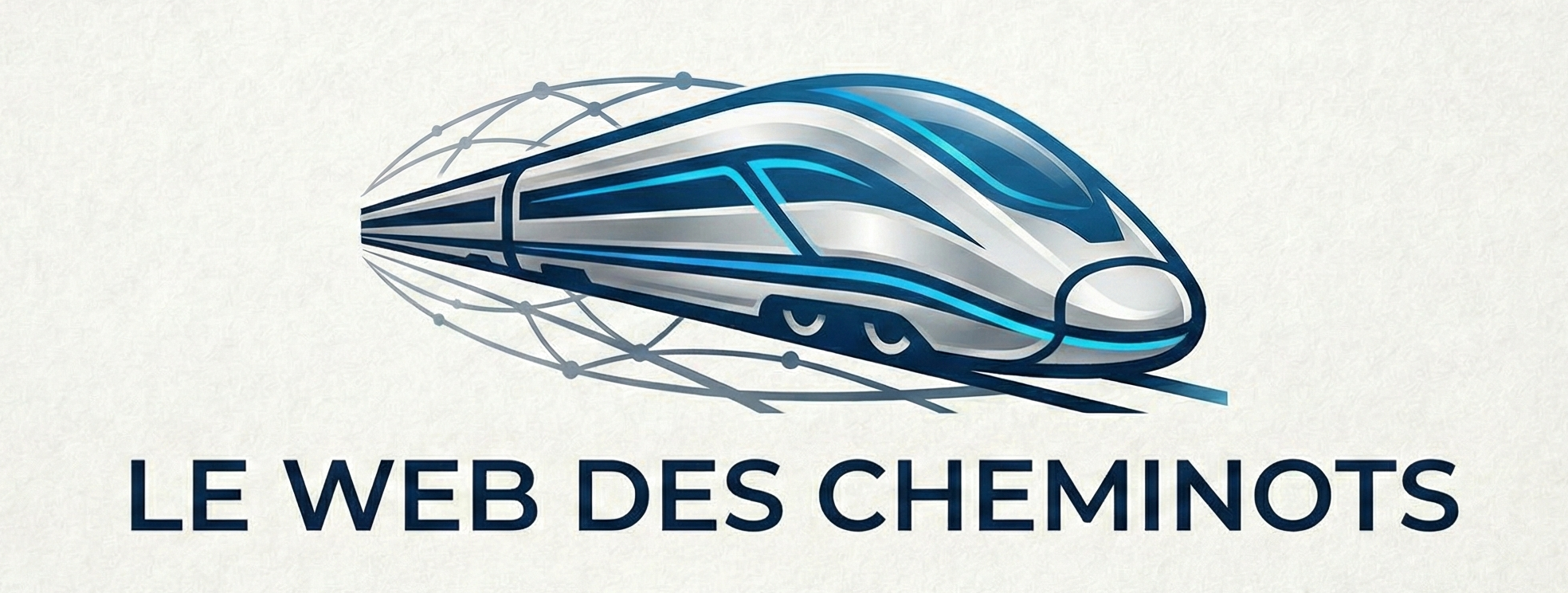Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
Que se passe t-il entre Cercottes et Chevilly
Si Votre Honneur m'autorise à m'aventurer en terrain glissant (pour un non-taupier)... je faisais allusion aux dispositions mises en oeuvre pour compenser l'écart par rapport à la température de référence (pour la libération des contraintes), soit par réchauffage du rail (l'ancienne méthode), soit via le recours à la mise en tension mécanique (vérins). J'avoue n'avoir pas pratiqué moi-même mais ayant eu comme collègues ou chefs plusieurs anciens taupiers, ça m'a permis d'avoir quelques rudiments de culture "V". Par période froide, je ne voulais pas dire négatives, mais courantes en période hivernale (5-10°C). Quand la température est proche de celle de référence, c'est l'idéal pour cette phase du chantier mais bon, dans la vrai vie, on ne peut positionner les chantiers dans les seules périodes les plus tempérées (et la météo varie...). Pour la mise en place d'une LTV (activée si nécessaire), on a bien ce type de situation durantc certaines phases de chantiers : la LTV est reprise aux infos FLASH destinées aux ADC mais peut parfois ne pas/plus être activée sur le terrain (c'est l'inverse qui est gênant... encore qu'il faille relativiser... on ne tombe pas sur un TIVE non annoncé et en général quand le taux est bas, des dispositifs d'attention sont prévus [répétition, flash...], sans compter les distances de ralentissement actuelles, tirées vers le haut). La solution du commutateur fermé sur un axe de cette importance, c'est vraiment le degré zéro de l'exploitation ferroviaire (ça devrait être réservé aux situations incidentelles). Christian
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Merci à TRAM21 pour son éclaircissement. J'avais bien un doute en lisant sa réponse (et connaissant un peu le monsieur...) mais bon, c'est plus clair désormais, nous n'étions pas en phase. Il a totalement raison de rappeler que "plus la VL est basse, plus il faut "coller" au plus près de la VL". Pour répondre à Aldo : - les gares où l'on peut rentrer à 80 ne sont pas légion et ne concernent pas celles en impasse ou les grandes gares où la réception sur signaux fermés est la règle ; si le quai est long et le matériel bon freineur, un arrêt en 450 m à cette vitesse correctement effectué ne secoue pas les voyageurs et n'abîme pas le matériel (cf. l'exploitation suisse ou sur LGV chez nous) ; au delà de 80/90, cela devient sportif et c'est peu souhaitable pour les engins comme pour les voyageurs, quand ce n'est pas impératif (FU...) ; sur LGV, des entrées à quai à 80 (en tête de quai, freinage engagé) sont courantes et tout à fait normales (sur signaux ouverts s'entend) ; - des entrées et sorties de gare efficaces, c'est du temps de gagné sur la marche et pour la fluidité de l'exploitation ; le constat actuel est qu'on écoule moins bien le trafic à volume équivalent par rapport à il y a 30 ans... bien que le matériel soit dans l'ensemble plus performant, en traction comme en freinage... cherchez l'erreur ! A sined : on évoquait initialement les arrivées et non les départs. Concernant ces derniers, la marche à vue prescrit de ne pas dépasser 30 km/h (depuis qu'une VL existe, sur le RFN, cela n'est pas si ancien). S'il est normal que le train tienne compte de la possibilité de rencontrer un carré fermé en bout de quai (quoique ce ne soit pas normal de donner le départ sur un carré fermé ou un sémaphore), un TGV n'est pas un convoi fret et le conducteur n'aperçoit pas le signal 50 m en amont.. Quand on voit certains départs de TGV en US à 10/15 km/h (voire moins !) sur 200 m, ça fait de la peine à voir pour le chemin de fer (et c'est la cata pour le fonctionnement de la gare) car objectivement, il n'est pas nécessaire de circuler à une vitesse si basse en sortie de gare même en marche à vue et la position du signal est connue (contrairement à d'autres cas où le conducteur ne connaît pas forcément l'implantation exacte des signaux).
-
Que se passe t-il entre Cercottes et Chevilly
Salut, la libération des contraintes est possible en période froide (heureusement car sinon, la maintenance de l'infrastructure serait vraiment problématique) mais elle nécessite un process particulier donc demande plus de temps (ou réduit le rendement du chantier). Le dispositif mis en oeuvre est très pénalisant pour l'exploitation, surtout sur un axe de cette importance. L'installation d'une LTV a demeure n'aurait-elle pas été préférable, quitte à ne l'activer que les jours de forte chaleur (les autres jours, dépose des équipements à demeure et balises KVB neutralisées) ? Christian
-
[Voiture Corail] Sujet Officiel
Salut, merci pour ces explications, pas toutes très ragoutantes comme tu l'as dit mais bon, la "vraie vie" est aussi faite de ce type de "réalités", quotidiennes pour les collègues du Matériel ou de la Voie... Les wc à recirculation utilisés sur les TGV jusqu'au milieu des années 2000 n'ont rien d'écolo (le formaldéhyde utilisé comme biocide [est-ce toujours le cas ?] n'a pas bonne réputation, soit dit en passant) et sont remplacés par des équipements à eau claire sur les matériels récents (ça ne rend pas la vidange plus agréable mais au moins, on évite l'utilisation de produits toxiques). Il est clair que le rejet à la voie n'est pas vraiment problématique sur les zones circulées à vitesse élevée (à condition de ne pas confondre les toilettes avec la poubelle... ce qu'on voit trop souvent hélas) mais en zone de gare, c'est franchement pas terrible (même lorsque le train passe en vitesse... si c'est du Corail avec wc à dépression... bien s'éloigner du quai est vivement conseillé ! ). Sur les TER2N ng, une solution transitoire fut étudiée (je ne sais si elle a été mise en oeuvre) pour une partie du parc en attendant que certains centres de maintenance soient dotés de systèmes de vidange et de rincage (fixes ou mobiles) des réservoirs de rétention (ça fonctionnait comme sur les VB2N modernisées, avec utilisation du réservoir tampon et rejet à la voie asservi à la vitesse du train [au lieu des balises en voie mises en place pour les VB2N]). La solution est probablement le recours à des bio-réacteurs, sorte de "fosses septiques" embarquées, qui permet de limiter les opérations de vidange (une fois par mois ou plus), sans pour autant nécessiter l'utilisation de produits chimiques toxiques ni dégrader l'allure des voies. Les voitures pilotes des VU IV des CFF ont été équipées de la sorte. Sur les navires modernes transportant des passagers, un équipement de dépollution embarqué (sorte de mini-station d'épuration) est présent, avec traitement des eaux noires (les eaux grises sont directement rejetées à la mer ou subissent un traitement allégé). Bonne soirée (le repas est derrière nous... ouf !) Christian PS : vu le nombre d'EF qui ont installé des réservoirs de rétention sur leurs voitures à l'occasion d'opérations de révision, je suppose que des solutions techniques ont été trouvées pour dégager la place nécessaire sous caisse (ça n'est jamais en toiture, bien évidemment... sur certains matériels 2N modernes, c'est par contre positionné en caisse, faute de place en dessous). En Suède, le réservoir a été installé en milieu de voiture sur le matériel des années 70... ce qui génère de la tuyauterie donc augmente probablement les sujetions de maintenance.
-
[Voiture Corail] Sujet Officiel
Sur le second point, lorsque la rénovation TEOZ a été décidée, il restait encore un parc conséquent de Corail au sein de GL (près de 3300 VTU/VU ont été construites, en ne comptabilisant par les voitures couchettes). Quant au premier, les quais des gares terminus françaises donnent parfois l'impression de décharges à ciel ouvert (bon j'exagère un peu... on est pas en Inde où sur ce plan, c'est vraiment un autre monde !). Il y 'a manifestement un effet d'entraînement : les gens sont d'autant plus tentés de balancer leurs papiers ou déchets qu'il en a déjà à même le ballast. Sans jouer du "c'était mieux avant", la plupart des voyageurs ne respectent plus l'interdiction d'usage des wc en gare (c'est pourtant toujours mentionné à l'intérieur). Il est vrai que cela peut paraître anachronique d'avoir encore ce type d'équipement rustique à bord mais on respecte bien d'autres "interdits" dans les lieux publics... En théorie, les toilettes doivent être verrouillées sur le chantier de formation et maintenues fermées avant le départ des trains des gares tête de ligne mais c'est loin d'être toujours le cas et peu satisfaisant pour le voyageur (pour les cas de force majeure s'entend...). Et à l'arrivée (trains terminus), on ne va évidemment pas monter à bord pour éjecter les voyageurs présents dans les wc. A Austerlitz où stationnent les trains de nuit, ce n'est effectivement pas très ragoutant. Il faudrait faire passer un train aspirateur régulièrement pour nettoyer les voies... cela existe sur le métro mais ça na plus l'air d'être le cas sur le RFN (ce serait pourtant très utile sur certaines lignes d'IdF... et plus efficace que le nettoyage manuel qui mobilise du personnel et prend beaucoup de temps).
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
C'est dangereux d'"attaquer" le quai à 30 ??? J'enfoncerai une porte en rappelant que c'est aux très basses vitesses qu'on perd le plus de temps, et donc qu'on accentue la saturation des installations d'entrée de gare qu'on dégage laborieusement. On voit régulièrement des TGV parcourir les 400 m du quai à moins de 20 km/h... j'ai même quelques exploits constatés en tant que voyageur (pas loin de 2' entre l'entrée à quai et l'arrêt complet... qui dit mieux ?). A PSL, le KVB est également installé (avec son 000 pénalisant pour la conduite) et pourtant nombre de trains entrent toujours en bout de quai à 25/30... la distance au heurtoir étant pourtant bien plus courte que sur les gares accueillant des TGV et les coeff de décélération du KVB bien inférieurs à ceux du fleuron de GL. On devrait suggérer un stage en gare de Zurich Hbf, où les trains entrent à 40 et tiennent cette vitesse sur la moitié du quai sans problème ni secouer les voyageurs (heureusement car passer de 40 à 0 en 200 m... ce n'est pas vraiment un exploit en matière de décélération pour un train de voyageurs, surtout équipé du FEP). A+ Christian
-
Qu'est ce donc ?
Sur le premier point, je suis d'accord avec ta conclusion (ce n'est pas gênant pour le moment). Pour le reste, j'aimerais comprendre ce qui a motivé la restriction dès la seconde circulation, car dans mes notes de réunion, j'avais bien noté la référence aux 7' mais avec la réserve évoquée précédemment (pour aboutir aux conclusions de l'étude, s'agissant du delta de température). J'ai fait référence aux voies ballastées sur le réseau allemand car les sections en voie sur dalle voient circuler à VL 300 des UM d'ICE 3 sans restriction (cas de Cologne-Francfort)... le rail est de même type qu'en France, aux nuances d'acier près. On pourrait comprendre que le risque de flambage soit plus élevé (ou intervienne plus vite ce qui revient au même) sur une voie ballastée. Sur le second, pour avoir obtenu (par le maître d'ouvrage lui-même) la note explicative rédigée par INEXIA, cette dernière fait uniquement référence aux croisements de trains à GV... sur une infra qui de toute manière n'a pas été conçue pour la mixité (rampes de 35 notamment) et a été DUPée comme LGV voyageurs. Il faut savoir qu'à l'origine, le tunnel devait avoir une section de 100 m², le rendant apte aux circulations non étanches à 300 km/h (tracé réservant 350... héritage de la conception SNCF à l'origine) mais que dans un contexte de dérive des coûts, RFF a retenu la réduction de la section (avec d'autres mesures) à 80 m²... arguant à l'époque que cela n'aurait pas de conséquence sur les performances. L'argument alors avancé (pour faire passer la pilule) était que l'on pourrait toujours circuler à 300 avec du matériel étanche aux ondes de pression... Mais comme le dispositif de fermeture des volets de clim et de glonflage des joints de porte n'est pas conçu comme un équipement de sécurité... et que du matériel non étanche est sensé pouvoir circuler (cela ne concerne que les TGV A qui ne devrait pas venir sur la ligne en service régulier, d'autant que seul un petit sous-parc est équipé de la TVM 430), la VL a été abaissée en dur (dans la signalisation) à 270 de part et d'autre du tunnel (respect du critère de sécurité tympanique pour les voyageurs en cas de croisement à Vmax dans des rames non étanches, dans la configuration de front d'ondes la plus défavorable). La position reprise dans la note amalgame les notions de confort tympanique et de sécurité des voyageurs pour justifier le recours à un abaissement à 230 (heureusement pas permanent) en cas de probabilité de croisement sous le tunnel (un dispositif a été monté à partir de la signalisation au sol, interfacé avec les postes SEI encadrants). De mémoire, les tunnels des NBS allemandes aptes à 300 ont une section de 90 ou 92 m² il me semble, et l'étanchéité aux ondes de pression des ICE 3 est plutôt moins bonne que celle des TGV les plus récents. Le tunnel de Saverne sur la seconde phase de la LGV Est sera bitube et en principe apte à 320 (a minima 300). Le directeur de la ligne nouvelle (un ancien de V) s'est battu pour conserver les performances de la ligne (merci à lui !), contrairement à ce qui s'est passé sur la branche Est du TGV RR.
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Merci pour le lien. Contrairement à ce qui est écrit sur le site, les éléments limités à 270 ne seront pas tous radiés à brève échéance, la majorité des bicourant V270 étant modifiés V300/TVM430. Christian
-
Qu'est ce donc ?
Ayant participé au projet TGV Est, et notamment aux réunions où était évoqué, côté direction du projet SNCF, les problématiques d'interfaces matériel/infra, je me souviens des discussions sur ce sujet en 2006 ou début 2007 et notamment de ladite étude... pour laquelle on évoquait que l'hypothèse d'augmentation de la température jusqu'au seuil critique nécessitait plusieurs freinages d'ICE 3 au même endroit, dans un contexte à la base déjà défavorable (fortes chaleurs). L'avis collégial (sur ce sujet) était que la question se poserait dans une perspective de long terme avec des batteries d'ICE espacées au block sur la LGV... Les 7' ont été repris ex abrupto par RFF dans sa norme de tracé des sillons dès la seconde circulation, mais je ne saisis toujours pas la raison objective d'un choix aussi maximaliste (*), à moins que l'argumentaire qui nous avait alors été présenté s'avère en fait erroné et ait été revu depuis (à ma connaissance non, c'est juste le résultat d'une interprétation un peu rapide et simpliste d'une synthèse rédigé dans un sens ultra-prudentiel). Je ne dis nullement qu'il faille ignorer le risque si l'occurence est faible mais dans le cas présent, si le delta de température nécessite 5 ou 6 séquences de freinage successives sur un faible laps de temps, il est incompréhensible qu'on interdise à deux ICE d'utiliser l'espacement permis par le block. D'où ma remarque sur l'approche parapluie. Sur la LGV Rhin-Rhône, le maître d'oeuvre a raisonné de la même manière en préconisant à RFF (qui a payé !) un zin-zin abaissant la VL à 230 lors des croisements dans l'unique tunnel de la ligne, alors qu'on circule aujourd'hui à 270 km/h dans le tunnel de Vouvray (de longueur voisine) de section nettement inférieure (71 contre 80 m² sur RR) et avec du matériel non-étanche sans que cela pose de problème (contrairement aux tubes de Villejust où la VL a été abaissée après la mise en service, pour limiter la gêne des voyageurs)... Sur la LGV Méd, on roule à 230 dans les ouvrages souterrains de Marseille, de section 65 m² (avec le même matériel que prévu sur RR). A force d'ouvrir le parapluie de manière de plus en plus systématique, il ne faut pas s'étonner qu'on augmente les coûts d'exploitation du ferroviaire et qu'on diminue en parallèle son efficacité, sans raison objective. Hélas, ce n'est pas avec la multiplication des acteurs impliqués dans le fonctionnement du système ferroviaire et la volonté de l'Etat de se couvrir au maximum qu'on pourra espérer revenir à une approche plus raisonnable et vertueuse. Dommage pour le rail... (*) les Allemands qui utilisent leurs ICE 3 sur des tronçons de LGV également ballasté (il n'y a pas que de la voie sur dalle) n'appliquent pas de règle d'espacement, à ma connaissance.
-
[MI09 RATP] Sujet Officiel
Le tronçon central du RER C pourrait bénéficier de NExT, mais sûrement pas à un horizon aussi proche. Pour 2013, la seule évolution prévue à ma connaissance est la suppression (partielle) des LPV40, côté ouest. On est bien loin de NExT...
-
[MI09 RATP] Sujet Officiel
NExT est un projet SNCF à la base, auquel RFF a été par la suite associé (forcément...). A ma connaissance, le premier site visé pour son possible déploiement sera le tronçon central du RER E, prolongé à la Défense. C'est un projet de long terme qui vise à permettre la circulation en mixité de convois sous mode P-A et conduite manuelle, la signalisation au sol demeurant à cet effet, ainsi que pour le fonctionnement en mode dégradé. Le débit maximal serait évidemment obtenu en mode P-A pour tous les convois, mais le fait de conserver l'infra accessible aux matériels non équipés est une fonctionnalités de base visées par ce projet, l'équipement devant pouvoir être mis en oeuvre de manière progressive (par tronçon) et étendu à d'autres lignes ou sections denses du réseau d'IdF, voire au-delà. NExT n'a pas encore atteint le stade des études détaillées. La question cruciale de son portage économique est encore loin d'être réglée. Et dans un contexte désintégré avec une multitude d'acteurs, sa genèse n'en sera que plus lourde complexe.
-
Qu'est ce donc ?
Bonsoir, il est surprenant que la règle de l'espacement à 7' sur la LGV Est ait été reprise dans le registre de l'infra car les conclusions de ladité étude mettaient en évidence qu'il fallait une succession de plusieurs ICE 3 au block freinant au même endroit, en conditions climatiques défavorables (température élevée du rail à l'état initial) pour justifier un accroissement de l'espacement (de mémoire 5 ou 6 circulations et non deux). Le parapluie semble encore avoir été grand ouvert (en l'état actuel du parc ICE 3 MF, cette disposition ne pose pas de souci pour l'exploitation de la ligne, évidemment). S'agissant de la prise en compte ou non des patins dans la détermination de la catégorie du train sur le réseau allemand, ce n'est pas très clair pour le non-spécialiste et même vu d'une partie des freinistes du Matériel, de ce côté du Rhin (pas contre les patins sont un pré-requis si l'on veut dépasser 140 sur LC). Il semble que les hypothèses prises en compte pour la fixation du taux soient extrêmement défavorables, ce qui explique que les TGV français aujourd'hui tous équipés du frein HP très performant se voient imposer la VL140 ou au mieux 155 pour le POS. L'ICE 3 MF a été recalé à V220 sur le réseau classique du RFN dans des conditions qui semblent également un peu discutables, au sens où l'approche aurait été là aussi maximaliste et "parapluie"... Est-ce une réponse du berger à la bergère ? Seuls les rares initiés ont un avis éclairé sur la question, et encore (car ce ne sont pas les mêmes qui sont intervenus dans le processus final d'homologation, par définition puisque les dossiers étaient portés par chacune des deux EF historiques dans leur pays respectif)...
-
[MI09 RATP] Sujet Officiel
Bonjour, Sur la première partie (le SACEM n'est pas la TVM du pauvre), je souscris à 100%. SACEM est tout à fait adapté à l'exploitation d'une ligne dense urbaine utilisant un matériel roulant conçu pour cet usage. On est dans la logique du freinage sur ordre, ce qui permet d'afficher les instructions de freinage au plus tard, dans une logique de conduite restant manuel (donc il demeure une marge de manoeuvre pour le conducteur, mais elle est faible, il doit donc réagir sans attendre et appliquer un freinage de service significatif). Cela ne rend pas la conduite très intéressante mais c'était ça ou le PA, plus lourd à mettre en oeuvre, pour arriver à écouler un trafic élevé sans aucun alternat dans les gares (performance remarquable quand ça fonctionne). Le RER A, c'est une vitesse moyenne près du double du RER E intramuros pour un volume de train 70% supérieur (avec du matériel plus ancien). Sur le second point, la TVM n'a pas besoin de courbe d'alerte car contrairement au KVB les vitesses but de son COVIT sont basées sur des taux toujours nettement supérieurs aux Vbut prescrites (hormis sur la séquence d'arrêt terminale) ce qui permet de préserver dans l'ensemble une ergonomie de conduite correcte (si le fonctionnement du système est bien maîtrisé par ses utilisateurs cela s'entend). Pour les séquences d'arrêt (canton présentant 000), la contrainte est de ne pas dépasser le taux fixe au franchissement des boucles ponctuelles lorsqu'on a affaire à un tampon dit "minimal", cas des gares par exemple. Les boucles K22 de la TVM 430 sont positionnées très près des repères Nf (60 m en amont) donc elles ne sont pas du tout gênantes en cas de freinage "normal"... et de plus sont bien visibles au sol (au centre de la voie), ne nécessitant pas d'entrer à quai à 30 ou même 40 km/h comme on le voit trop souvent. En TVM 300, les K65 (équivalent des K22, utilisant une technique différente de transmission) sont implantées plus en amont (en palier à ~250/300 m du repère Nf) mais le taux de vitesse à respecter étant nettement plus élevé, le risque d'être pris en charge est quasi nul à moins de pratiquer une entrée "à la suisse"... ce qui ne rien pas d'arriver chez nous (ou alors c'est que le conducteur s'est loupé...). Dans les deux cas, la séquence d'arrêt comporte un canton à Vbut 80 ou 60 donc la vitesse est déjà cassée en amont (pas génial sous l'angle du débit). Le taux de décélération retenu par le COVIT est relativement bas (pour du matériel TGV) sur le dernier canton en l'absence de canton tampon (0,7 m/s² en palier), c'est l'autre point important à retenir pour éviter toute mauvaise surprise (un TGV en conditions nominales pouvant largement dépasser 1 m/s²). Mais 0,7 m/s² demeure une valeur élevée dans l'absolu, ça correspond par exemple à une entrée à 90 km/h sur un quai de 450 m... (moins dans la pratique car il faut tenir compte de divers paramètres et d'une marge de sécurité pour éviter toute mauvaise surprise mais ça donne quand même une idée des marges offertes par le système... on peut aborder sans problème le quai à 60 [freinage engagé et maintenu] sur 000 sans risque de déclenchement du COVIT). En TVM, le débit est peu optimal lors les trains se suivent dans les zones de gare (le système n'a pas été optimisé dans ce but, avec un sous-découpage des cantons comme sous SACEM), mais la séquence d'arrêt est néanmoins resserrée aux vitesses réduites. On accentue par contre ses effets en généralisant l'anticipation des freinages, que les concepteurs de la TVM n'ont jamais préconisé (ils ont conçu le système avec des marges intrinsèques de sécurité importantes, qui ne nécessitent aucunement de rajouter une couche supplémentaire comme cela a été préconisé par la suite lors des formations à la conduite sur LGV [on a totalement dévoyé le système et désoptimisé le couple infra/mobile en préconisant ces anticipations de freinage qui n'ont pas de raison objectives sur le plan de sécurité]). La logique de la TVM, ça reste du Vbut au point but (ou à la limite à l'approche du point but), pas du freinage "au plus tôt"... adapté à d'autres types d'exploitation, tel SACEM ou les réseaux aux cantons très courts, comme en Allemagne par exemple (avec des cantons inférieurs à 1000 m autorisant VL160, autant dire qu'un freinage franc et immédiat est logique dans ces conditions). C'est clair qu'une conduite automatisée n'est pas nécessairement idéale sur le plan des économies d'énergie (quoique l'informatique et l'électronique embarquées ont permis de réels progrès) mais sur une infra dense, ce qui prime c'est le débit et le maintien de performances correctes (alors que les deux ne vont en général pas de pair). Lorsque les trains ne circulent pas à distance de block et sont à l'heure voire en avance, une conduite manuelle tenant compte du profil et évitant de trop solliciter le matériel est préférable, si les performances demeurent au rendez-vous. En exploitation dense (c'est le cas sur le coeur du réseau TGV français, au moins aux heures les plus chargées... pas uniquement en Transilie), ce qui compte est d'écouler le trafic dans les meilleurs conditions et de tirer au mieux parti du block... le critère énergétique ou d'usure des garnitures de freins passe après, on ne peut jouer sur les deux tableaux. Vu qu'on estime difficile voire impossible de revenir à la logique de la Vbut au point but (a minima sur LGV) sur le RFN, je pense pour ma part que la seule solution est de mettre en place progressivement le freinage automatique sur les séquences d'arrêt et de ralentissement, comme au Japon, en commençant par les LGV (l'exploitation sous ERTMS 2 s'en rapproche, cf. Perpignan-Figueras pour ceux qui auraient déjà eu l'occasion de fréquenter la ligne, ou la LGV Est lors des essais sous ERTMS). Le projet NExT porté par Transilien s'inscrit dans cette logique. Christian
-
Qu'est ce donc ?
Salut, les patin EM ne sont pas imposés pour circuler sur le réseau allemand mais sont requis pour obtenir un taux poids-frein permettant de circuler à une vitesse proche de celle des ICE de la DB sur les tronçons de ligne classique non équipés de la LZB (signalisation de cabine allemande), en gros les portions à VL<=160. Les PBKA sont limités à 140 -malgré leur freinage très performant- sous PZB/Indusi (les équipements de sécurité des lignes classiques allemandes)... Le POS a pour cette raison été doté -comme les récentes RGV 2N2- de 4 paires de patins, obtenant ainsi l'autorisation de circuler à 155 km/h sous PZB (160, c'était probablement trop demander... mais bon, les relations franco-allemandes dans le domaine ferroviaire ont toujours été difficiles, même si les événements tragiques du siècle passé sont aujourd'hui de l'histoire ancienne). Seuls les ICE 3 disposent de FCF (les générations précédentes ont des patins classiques, qui agissent principalement par frottement sur la surface du rail et sont réservées au FU). Nombre d'automoteurs SNCF disposent de patins EM. Christian
-
vitesse imposée
La V.I. gère le freinage électrique... ce qui n'est pas le cas sur les automobiles, forcément (à ce propos, les hybrides sont-elles équipées d'un limiteur et celui-ci fonctionne t-il en descente en utilisant la faculté du moteur électrique à retenir -partiellement- le véhicule ?). Sur les engins moteurs (ferroviaire) modernes équipés d'un frein électrique puissant et performant, la plupart des freinages de maintien peuvent être assurés par une V.I. en état de marche. Un exemple parmi d'autres : sur la VU Saint André le Gaz - Chambéry, un TGV R ou D peut descendre la pente de Saint-Cassin (avant Chambéry) en 25 pm sans nécessiter un seul coup de frein pneumatique et parcourir toute la ligne pourtant en bosses et limitée à 90 avec la V.I., ce qui autorise de très bonnes performances (on peut approcher le trait), à défaut de l'agrément de la conduite et d'une consommation d'énergie minimale (ce dernier point, c'est bien quand le train est à l'heure ou en avance, quand il y a du retard à rattraper, ça passe au second plan).
-
[Voiture Corail] Sujet Officiel
Le programme "Nouvelle déco" a suivi le programme Corail + (qui ne portait "que" sur 800 voitures, de mémoire), avant que ne se généralise le transfert au TER de nombreuses voitures Corail. Dans la modernisation C+, le remplacement des WC traditionnels (qui n'ont rien de marin, technicentre... pas de pompes comme sur un bâteau de plaisance mais un simple trou et une banale chasse d'eau) par des WC à dépression (mais sans réservoir de rétention...) comptait pour la moitié de la facture totale de la rénovation (2x200 kF de l'époque, sur un coût global de 850 kF, frais de RG déduits). Vu la fiabilité de ces équipements (notamment en période de gel) et les effets indésirables de la vidange extérieure sous pression (certains personnels ou voyageurs n'ont pas trop apprécié d'être aspergés... ce que l'on peut comprendre aisément), ce choix fut pour le moins peu judicieux, avec le recul (encore une demi-mesure, soit dit en passant, la plupart de nos voisins passant aux systèmes à rétention lors des modernisations de leurs matériels, ce que n'a jamais fait la SNCF). Ce qui m'a franchement surpris, c'est le choix de puiser principalement dans le parc Corail+ pour réaliser les TEOZ, alors qu'il s'agissait de voitures déjà anciennes, des séries VU et VTU 75 à 78, pour l'essentiel. Pas vraiment logique si l'on voulait péréniser ce matériel... (la réponse qui m'a été faite à l'époque, c'est que cela limitait le coût car il n'y avait pas à reprendre les toilettes, que l'on conservait à l'identique). Christian
-
La SNCF perd son procès face à un voyageur ponctuel
C'était aussi un retour sur terre (l'abandon de cette idée pour le moins irréaliste). Au début des années 90, le staff dirigeant de GL est fasciné par le modèle aérien, au premier chef son patron de l'époque, J-M Metzler, qui a emmené son équipe aux USA voire fonctionner le logiciel SABRE et l'optimisation commerciale à American Airlines (on est en pleine période post-dérégulation, issue de l'ère Reagan). L'idée de copier l'avion et de faire des gares GL des zones "étanches" est un point de vue pour le moins discutable sur le RFN, vu l'importance des flux ferroviaires et la mixité avec le trafic à courte distance. Les Japonais ou plus récemment les Espagnols ont pu développer cette approche, du fait d'un réseau dédié en raison de l'écartement différent avec le réseau classique, et du niveau modeste du trafic pour le cas espagnol (où il y a demeure même une certaine mixité), ou de la concentration sur un faible nombre de gares au Japon. Dans les gares parisiennes tête de ligne, c'était peut être envisageable, à coût assez élevé mais un contrôle d'accès aux quais généralisé (autrement plus contraignant qu'à l'époque du ticket de quai, dans l'idée de ses défenseurs) dans nombre de gares de province parait pour le moins utopiste et hors d'atteinte sur le plan économique, sans compter que l'exploitation en quai dédié n'optimise pas la gestion globale des moyens, donc gâche de la capacité dans un système par essence mixte (i.e. avec tous types de trafics sur la même infra). Donc dire que cela était prévu... non, c'était souhaité par quelques âcteurs clé au sein de GL, dans leurs bureaux de la place de Budapest (à l'époque). Vu des exploitants du quotidien, ce genre de "vision" a toujours reçu un accueil plus que mitigé. La tendance sécuritaire actuelle pousse désormais à nouveau dans ce sens, pour les gares nouvelles, au détriment de la fluidité. On a plus souvent une approche dogmatique et manichéenne dans ce pays, où le pragmatisme n'est la première de nos qualités. A Valence TGV, des accès ont été construits (sur le tard) pour relier directement quais TER et TGV (le bon sens !)... mais ils ne sont pas utilisés en situation normale, car il faudrait positionner du personnel pour contrôler les accès aux quais TGV au droit des ascenseurs (ce qui n'est pas prévu pour des raisons économiques) et l'exploitant tient d'autre part à imposer le passage par les espaces commerciaux de la gare (ce qui impose d'emprunter 3 escaliers mécaniques car il faut monter pour redescendre au niveau des voies TGV). Même type de constat pour la gare de Belfort-Montbéliard TGV, sur le futur TGV Rhin-Rhône : alors qu'un accès direct TER-TGV était techniquement réalisable avec la ligne Belfort-Delle qui va être réhabilitée, l'exploitant de la gare s'y est opposé, avec l'aval de l'Etat (pour ce dernier dans une logique sécuritaire de fermeture de l'accès au quai TGV), imposant un détour aux voyageurs en correspondance afin de passer systématiquement par le BV (non positionné au droit de la ligne TER mais plus au sud)... Qu'il faille limiter les flux inutiles et faire en sorte que les trains partent à l'heure est une chose (il y a des progrès à faire dans ce domaine), ce n'est pour autant qu'il faille raisonner uniquement "vu du producteur" et rendre la vie compliquée aux voyageurs. Le train n'est pas l'avion... pour lequel on déplore la lourdeur des contrôles d'accès actuels et de fait la pénalisation très forte ressentie sur les trajets court ou moyen courrier (pour aller à l'autre bout du monde, on n'est pas à une heure près).
-
La SNCF perd son procès face à un voyageur ponctuel
Salut, la décision préconiser l'accès au TGV à H-2' au plus tard (et de supprimer l'affichage du train et de la voie dans les gares le permettant) a été prise en 2005 ou 2006 et n'est que la suite logique de la généralisation de la séquence de départ allongée mise en place sur les TGV (autres que PSE), en 2002-2003 (le système avait fonctionné 12 ans durant avec la procédure "normale"...). Si l'objectif à la base est louable (faire en sorte que les trains puissent partir à l'heure), la manière d'y parvenir est comme souvent chez nous discutable, car on pénalise clairement le voyageur, plutôt que de chercher à améliorer d'abord l'efficacité de fonctionnement du système ferroviaire (qu'on a au contraire dégradé, ici encore). Dans les années 90, avait été institué le principe des départs techniques (i.e. l'horaire graphiqué) aux minutes "+" des grandes gares tête de ligne, ce qui permettait de rendre compatible le lancement de la séquence de départ à l'approche de la minute ronde (i.e. quelques secondes avant au plus tôt) et la mise en mouvement du train conformément à l'horaire tracé. Mais cette disposition gênait les tenants du suivi de la ponctualité au départ, le système ne pouvant, parait-il, pas tenir compte de ce décalage de 30" (il avait donc tendance à accentuer le nombre de trains en retard aux dires du système informatique, du fait de ce décalage de 30")... Dans le même temps, la pratique sur le terrain avait déjà conduit à faire partir les trains à la minute ronde... donc progressivement les sillons ont été modifiés dans ce sens. Après plusieurs années d'attentisme, sous l'action d'un dirigeant efficace, il a enfin été décidé de modifier l'informatique embarquée pour supprimer la temporisation de 25" (totalement improductive et ayant conduit à allonger les temps d'arrêt) demandée aux ASCT lors de la séquence de départ des TGV. Ce mesure sera effective quand l'ensemble du parc aura été modifiée (à la fin de l'année en cours, de mémoire). Je doute pour autant qu'on revienne à une pratique moins pénalisante pour les voyageurs, et surtout adaptée aux gares tête de ligne, principalement terminus (il est probablement difficile de demander à la maison Voyages de raisonner autrement que "vu de Paris"), et qu'on décale le lancement effectif de la séquence de départ de H-1' à H-30" au niveau du train (on prétextera que le maintien des H-1' joue dans le sens de la robustesse du système... quitte à faire poireauter le train 30" inutilement, portes fermées). Le cas du voyageur ayant porté plainte est probablement limite mais il a au moins le mérite de souligner la logique du système plus tournée vers le "confort" de l'exploitant que vers la satisfaction du client final et l'efficacité du fonctionnement du système. A l'inverse, dans un pays latin comme la France, il y aura toujours des voyageurs qui veulent accéder au train au moment du départ voire lorsque le train démarre... quitte à mettre en danger leur vie ou/et celle du personnel, et a minima perturber l'exploitation. Il faut donc bien fixer des limites. Le concept du départ à la minute "+" me semblait pour ma part le mieux adapté... de même que l'introduction d'un temporisation dans l'horaire infra, l'horaire commercial repris dans les supports commerciaux et l'heure réelle de départ (c'est ce qui est pratiqué en Allemagne, où comme en Suisse il est interdit de fermer les portes avant l'heure officielle de départ, principe de bon sens). Cela suppose évidemment que les outils utilisés pour établir les horaires soient suffisamment modernes pour permettre ce type de distinguo (ce n'est pas le cas des outils actuels, dépassés sur le plan technique)... Pour revenir au départ sur avertissement voire S cli, sous exploitation KVB (i.e. sans réouverture continue), ce n'est pas vraiment la panacée, surtout dans les zones denses et les gares où les signaux sont très rapprochés (cas de PLY par exemple). Le cas de Dijon actuel, caricatural, est le résultat d'une "mise aux normes" (lors de la mise en place du PAI et de la CCR) appliquée dans une logique parapluie n'ayant même pas tenu compte des conséquences sur l'exploitation ferroviaire du durcissement des conditions d'ouverture des signaux (avec la généralisation des S cli, remplaçant les avertissements sur un plan de voie par endroit absolument pas modifié). S'étonner que les conducteurs soient réticents à partir sur du S cli... c'est ce constat qui est pour le moins sidérant. On n'est pas dans un PANG (où les trains repartent d'eux même... si rien ne s'y opposent) mais dans une grande gare. Christian
-
Détresse du TGV 6123 : Paris - Marseille
La contraction sur le nord en 2007 avait à la base une justification économique (d'où le choix de "rationaliser" l'offre suite à la dégradation du bilan économique, notamment [mais pas uniquerment] du fait de l'évolutiion à la hausse des péages RFF), même si le contexte tendu côté matériel au démarrage de l'exploitation du TGV Est poussait également dans ce sens (rames Réseau sorties des roulements intersecteurs et SE+Nord pour engagement massif sur l'Est donc nécessité de faire également de la productivité sur le parc PSE). Le débat sur l'utilisation "rationnelle" du TGV n'est pas nouveau. Mais comme cela a déjà été rappelé dans ce fil (et dans d'autres), la contraction sur le coeur du réseau TGV réduira le trafic et passera mal auprès des élus. Il faudra donc la porter au plus haut niveau et l'assumer (ce scénario ne déplairait pas forcément chez certains acteurs du système, sans trop le défendre ouvertement, bien évidemment). Lorsqu'on a mis en service la LGV Atlantique branche Ouest, la rupture de charge a été généralisée à Rennes côté Bretagne sud, Rennes-Quimper n'étant pas encore électrifié. Le trafic n'a évolué qu'à la marge, malgré un gain de temps de l'ordre d'une heure et une augmentation de l'offre Paris-Rennes conséquente... alors que les correspondances avaient été correctement montées. Le trafic n'a réellement décollé qu'à partir du moment où les TGV ont rejoint Lorient puis Quimper... Autre illustration, sur les relations intersecteurs, on retrouve les trois quart du trafic Nord-Atlantique dans les trains directs, qui sont pourtant plus lents que les meilleures combinaisons Lille-Bordeaux via Paris (avec un temps de correspondance raisonnable). Il y a certes quelques dessertes "politiques" et franchement discutables sur le plan économique mais un des atouts du TGV, c'est précisément d'offrir des relations directes ou avec peu de correspondances à des voyageurs GL peu enclins à changer de train (le cas suisse n'est pas vraiment transposable à la France). Vouloir casser le modèle actuel aurait d'autant plus de conséquences que la maison GL a choisi un désengagement progressif de l'offre classique depuis la fin des années 90 (le passage récent des TEOZ dans TET n'est que l'ultime traduction de la concentration sur le seul TGV et son modèle économique très influencé par l'aérien). Si on supprime par exemple les rares TGV qui relient la Lorraine à Lyon et au midi de la France (ce que certains souhaiteraient, pour améliorer la productivité du parc), je doute qu'on remette du train classique estampillé GL à la place... or il n'y a pas d'offre TER entre Dijon et Nancy. Les relations Strasbourg-Lyon auraient subi le même sort que bien d'autres transversales s'il n'y avait eu la perspective de la LGV Rhin-Rhône, projet dont la composante nord-sud n'a jamais vraiment été portée par la maison GL (LGV excentrée du réseau existant, reliant une province française à une autre sans même tangenter l'IdF... un OFNI vu de la Tour Traversière)... Petite remarque pour finir : Paris-Besançon, c'est 2h30-2h40... les 3h40/50, c'est pour les 2 A/R prolongés/amorcés à Belfort, dans la perspective du TGV RR.
-
Détresse du TGV 6123 : Paris - Marseille
A mon sens, les causes sont à rechercher ailleurs que dans le dimensionnement du parc. Il serait intéressant de mettre en rapport l'évolution du parc (notamment en places offertes) et celle du trafic, depuis la mise en service du TGV Est (il n'y a pas eu de développement d'offre majeur depuis juin 2007). Une seule rame SE est à ce jour radiée...
-
Détresse du TGV 6123 : Paris - Marseille
La stratégie que tu évoques n'a été mise en oeuvre qu'à la marge jusqu'à présent (avec quelques réductions sur des TGV Province-Province essentiellement) et laissera des traces si elle est vraiment appliquée (l'offre classique à moyenne/longue distance ayant été réduite à se plus simple expression). Le constat que formule assouan est plutôt révélateur de difficultés structurelles... car dans les faits, le parc TGV actuel est réellement excédentaire (heureusement car dans le cas contraire, l'échéance de décembre prochain avec le démarrage du TGV Rhin-Rhône serait très mal engagée).
-
Détresse du TGV 6123 : Paris - Marseille
Salut, le parc actuel est largement excédentaire malgré les rames sorties du parc pour rénovation ou gros entretien... vu que la livraison des Duplex (au sens générique du terme) est continue depuis des années (elle a juste été un temps ralentie) alors que le trafic est plutôt atone, pour différentes raisons (conjoncture, effet de l'augmentation des tarifs...). C'est une situation (parc excédentaire) que l'on rencontre avant chaque mise en service de LGV.
-
[ Z 870 Stadler ] Sujet officiel
Merci pour les photos ! Juste un détail concernant le dernier message, l'équivalent de l'OFT en France, c'est la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), dépendant du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et de la Mer (ex-ministère de l'Equipement) : http://www.developpe...nerale-des.html. La compétence spécifique "sécurité ferroviaire" pour le réseau ferré national (St Gervais - Le Châtelard en fait partie), hors cadre général (qui reste de la compétence du ministère) a été confiée à un organisme indépendant (l'EPSF), comme préconisé par les textes européens. L'organisation du système ferroviaire français est de plus en plus simple et de moins en moins bureaucratique, comme on peut le constater au quotidien... Christian
-
[le KVB] Sujet officiel
Salut, Les courbes de freinage du KVB pointent le plus souvent V=0 au niveau du signal d'arrêt annoncé fermé (et Vbut pour les ralentissements, sans marge additionnelle contrairement à la TVM). En revanche, les courbes sont levées à 40/35 (FU, alerte) ou 15/12,5 (d°) suivant la nature du signal et la distance carré - point à protéger (limite de garage garage franc...). Sur sémaphore, S cli et carré à glissement "long" (>=200 m en palier... critère défini par rapport aux convois fret les plus mauvais freineurs), c'est le premier cas qui s'applique. Sur les carrés à glissement "court" (tout est relatif...), c'est le second. Dans la première configuration, la vitesse max prescrite à l'approche du signal est de 30 (pour être en-dessous de la courbe d'alerte), dans la seconde, la VL prescrite est de 10 km/h, pour la même raison. Sur les carrés et les sémaphores de block non permissifs, le KVB ajoute un contrôle de franchissement au droit du signal resté fermé (donc FU déclenché si les balises sont franchies même à très basse vitesse, hormis via la procédure [bP FC] ad hoc décrite précédemment). Oui, au niveau du signal. Sur les v6 KVB, il n'y a plus d'indication comme déjà rappelé. En l'absence de KVBP actif, le contrôle à 40/35 reste actif à proximité du signal jusqu'à son franchissement, d'où la prescription de la VL30... Les premiers développements du KVB ont été fait avec une technique de type "analogique", qui nécessitait un nombre important de balises dans certaines configurations (itinéraires multiplies concernés par les signaux, nombre élevé de taux de vitesse à prendre en compte, combinaison de séquences "signaux" et "changement de VL" etc.) Depuis une quinzaine d'années, le KVB sol numérique (SN en abrégé) remplace le KVB sol analogique lors des modernisations de l'infra ou sur les nouvelles installations. En KVB SN, on n'a pas que 2 balises sjmsb. La combinatoire catagories de trains/VL peut également être plus élevée (en KVB analogique, les limites imposées par le système ont conduit dans certains cas à abaisser la VL de certaines catégories d'engins [reprise aux RT], faute de codage disponible sur le terrain !). Le KVB se veut l'"image" de la signalisation. A partir du moment où le changement de taux de VL n'est pas annoncé (donc renvoie à la seule connaissance de ligne par le conducteur, a minima à la consultation préalable des RT), il est tout à fait cohérent que le KVB n'intègre pas de courbes de décélération en amont. Ce n'est pas une signalisation de cabine (comme ETCS 1 ou SACEM par exemple). Au contraire, l'absence de courbe d'alerte et de FU en amont de ces points de transition de VL rend le système transparent pour le conducteur... ce qui est loin d'être toujours le cas dans nombre d'autres configurations. Si le convoi est pris en charge au point de transition de VL, c'est qu'il circule en ce point à VL+10 km/h a minima, cas de dysfonctionnement mis à part... Le positionnement différent constaté entre RT et infra terrain pour le KVB, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le KVB en lui même qui est en cause mais la discordance entre son paramétrage au sol et les indications reprises dans les RT. Les UP Traction doivent faire remonter ces paramétrages inadéquats à RFF/GID. C'est une source de référence effectivement (Marc a été un temps en charge du programme KVB à l'Infra SNCF). Christian
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Les deux documents cités TT0457 et 0927 (internes SNCF et émanant de la direction de la Traction) décrivent le fonctionnement du KVB et pas du tout les aspects managements de la sécurité et suivi des événements de conduite, internes à l'EF. A ce titre, il devraient exister sous une forme "générique", destinée à l'ensemble des EF, car on gagne toujours à comprendre comment fonctionnent les systèmes de sécurité. Bien évidemment, cette tâche de mise à disposition d'une documentation technique des équipements de sécurité ne devrait pas incomber à l'EF SNCF ou alors moyennant rémunération de la prestation par l'EPSF ou RFF. Si le point à protéger est à distance suffisante du signal oui mais ce n'est pas toujours le cas surtout en zone de gare et alors des courbes descendant jusqu'à zéro rendraient quand même l'approche des signaux délicate, à moins d'avoir des recalages répétés de l'odométrie embarquée et un système plus fin que le KVB. Avec un freinage automatique, ce serait plus aisément envisageable, mais on change de logique de conduite et le recalage de l'odométrie resterait essentiel pour viser un fonctionnement performant et sûr.