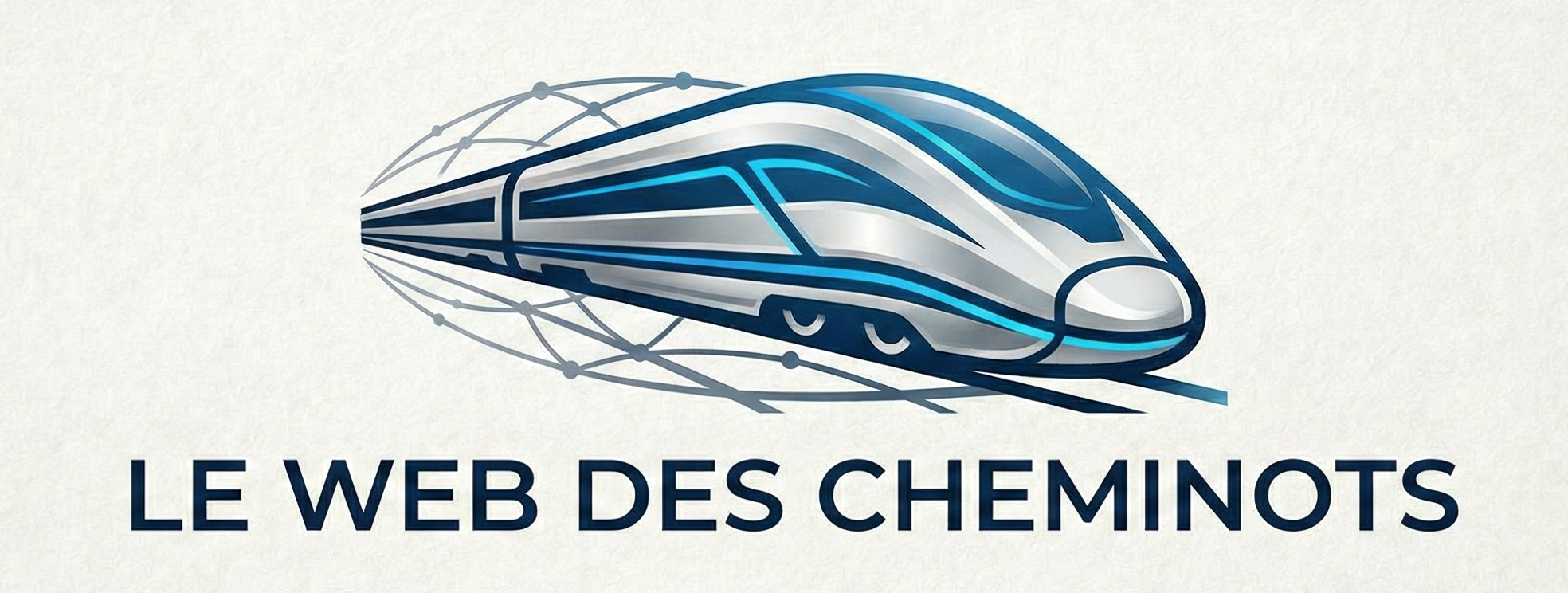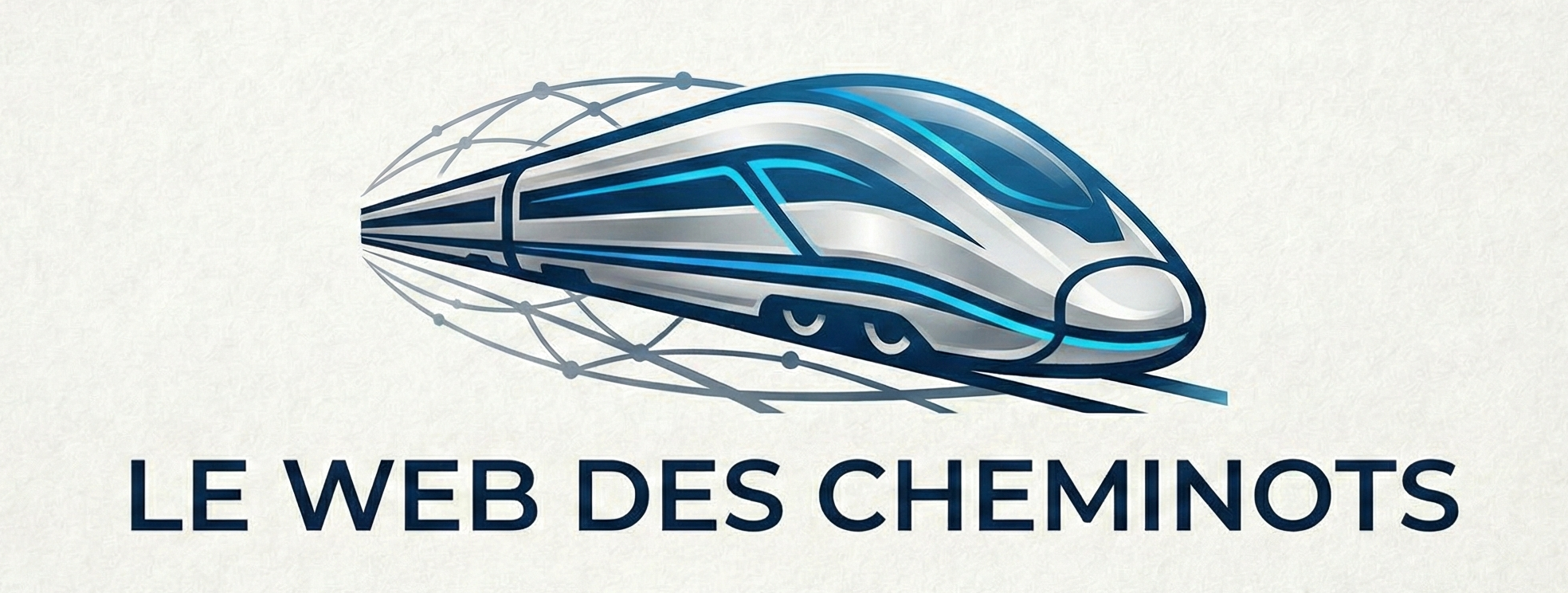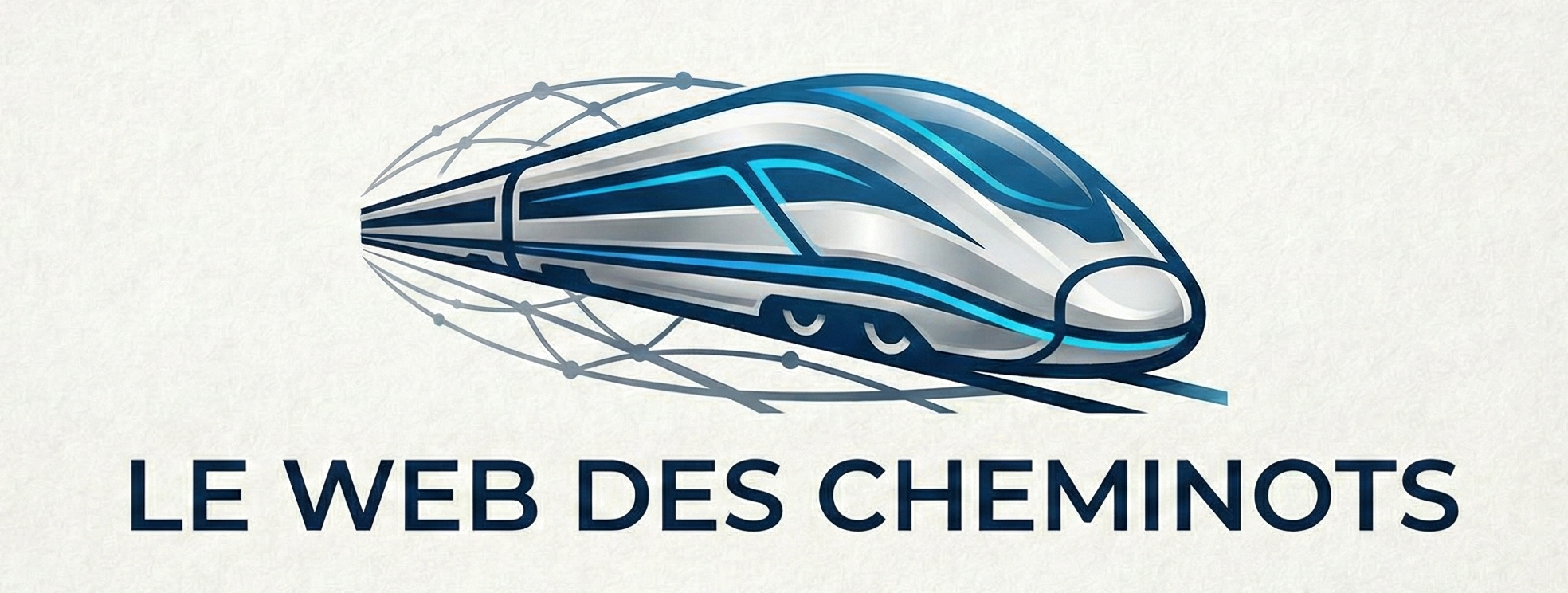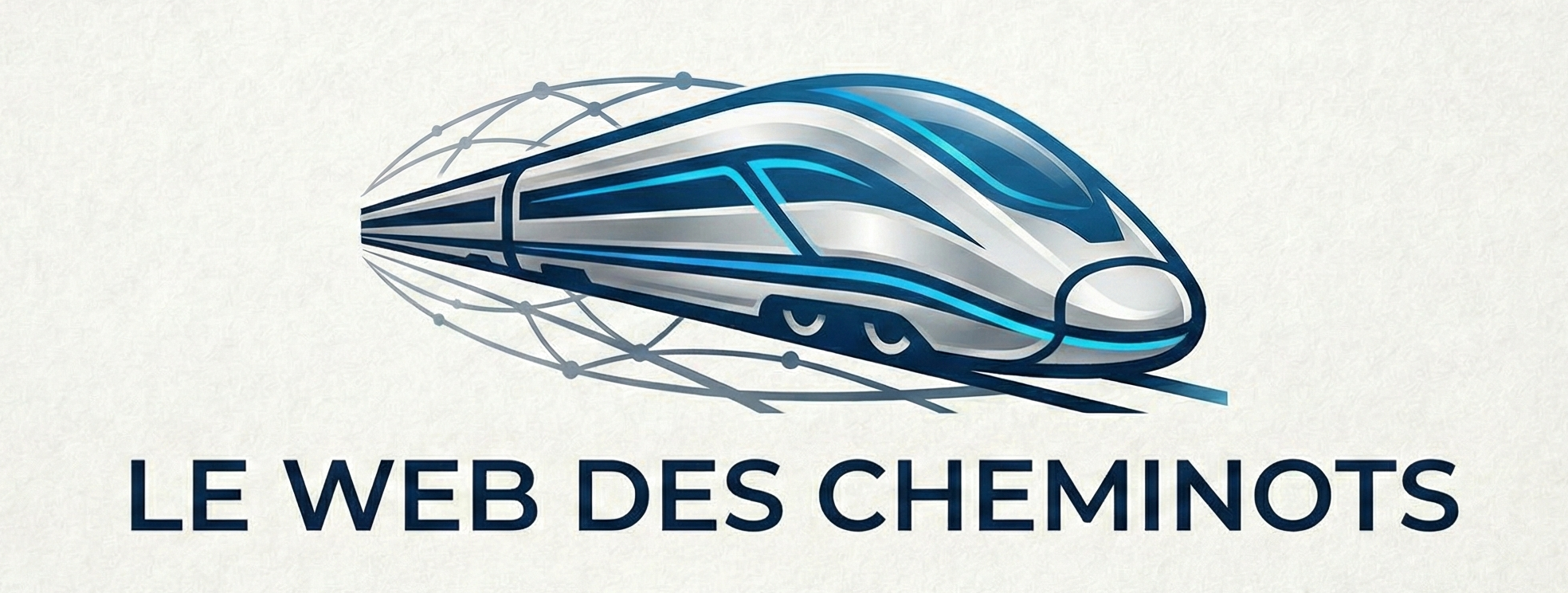Tout ce qui a été posté par JujuY
-
Moteur de traction
Là je ne suis pas d'accord. Dans un moteur asynchrone, les barres longitudinales sont en cuivre et elles sont mises en court-circuit aux extrémités du rotor. Le champ magnétique du stator induit du courant dans ces barres de cuivre. Ce courant de court-circuit provoque un champ magnétique qui en s'opposant au champ magnétique du stator provoque la rotation du rotor. Voir le lien suivant http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone Un rotor de moteur asynchrone est simple et il ne présente pas de pièces d'usure (hormis les roulements à billes ou à rouleaux). En particulier il n'y a pas de collecteur ou de bagues collectrices, avec ses contacts tournants (balais). Au contraire, un rotor de moteur synchrone est équipé d'au moins deux bagues collectrices circulaires (et de balais) pour alimenter en énergie le rotor (Voir le lien suivant http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_synchrone). Ici les balais peuvent s'user à moins d'avoir une auto-excitation comme le principe des fameuses statodynes (plusieurs machines assemblées sur le même rotor dont l'une sert à alimenter le rotor du moteur synchrone principal) Et je ne parle même des moteurs à courant continu, où la plaie, à la fois en production et en maintenance, c'était le collecteur avec ses fines lames en cuivre argenté (pour sa dureté), isolées entre elles, sur lesquelles des balais viennent faire contact, en créent des court-circuit entre deux lames consécutives avec la giclée d'étincelles (arcs) qui va avec. Dans une atmosphère explosive, seul un moteur asynchrone peut être utilisé (aucun contact tournant donc aucun risque d'étincelle en fonctionnement)
-
BEA-TT, déraillement du TER n° 17929 le 26 juin 2013 à Lyon (69)
Les mauvaises langues pourraient dire que c'est la faute au fameux "sandwich SNCF" Bon je sors Par contre sur le principe, le rapport du BEA montre effectivement des lacunes dans les règles et procédures de maintenance de ce type d'essieu (et pour les autres types ??)
-
[Z 5300] Sujet Officiel
JH = Jeumont Heidmann = combinateur à cames voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeumont-Heidmann
-
collision TER/ semi-remorque à Guipavas pas de blessé
Et après tu vas sans doute mettre une caméra pour vérifier et enregistrer que l'afficheur fonctionnait bien et sans défaut (en cas d'accident c'est la faute à qui ?), tu ajoutes toutes les langues locales (ici le Breton) pour s'adresser à un public le plus large. Bref il n'est pas raisonnable de dé-responsabiliser l'automobiliste en reportant les contraintes sur RFF. Il existe un code de la route applicable en toute circonstances. SI la voirie est impraticable pour certaines catégories de véhicule, la signalisation routière doit le mentionner.
-
Rupture d'attelage sur le RER B - 02/12/2014.
J'avais compris, sans doute à tord, que les communications via le 06 étaient proscrites car non enregistrées (cf le rapport sur l'accident de Maillé http://www.bea-tt.equipement.gouv.fr/resume-du-rapport-final-a472.html )
-
Rupture d'attelage sur le RER B - 02/12/2014.
Effectivement car pour moi, la B c'est l'ancienne ligne de Sceaux
-
Belgique: delestage electrique, les trains ne rouleront plus...
Ce n'est pas inscrit dans les spécifications (publiques ou non ) que j'ai pu consulter... Mais c'est hors sujet alors je ne développerai pas ici
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
Petit rappel : l'accélération et la décélération à basse vitesse d'une rame TGV, n'est pas du même ordre de grandeur qu'une rame omnibus... Car ce n'est pas fait pour... Quel est l'endroit qui use le plus, mécaniquement, une rame TGV : la sortie de la gare de Lyon avec ses multiples aiguillages, posés trop près l'un de l'autre, par manque de place
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
A puissance identique, le poids d'un transformateur 50Hz est bien supérieur à celui d'un convertisseur statique.... Et sur une rame TGV à 2 niveaux, il vaut mieux transporter des passagers que de la tôle magnétique...
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
Je ne vois pas pourquoi une rame Duplex fatiguerait à faire l'omnibus ! (le freinage mécanique à basse vitesse, des manœuvres de portes : heureusement qu'il y a de la marge). Et pour ceux qui comparent avec une moto, je rappellerai qu'il n'y a ni embrayage, ni boîte de vitesse et encore moins de refroidissement liquide (hormis le TFP) sur une rame Duplex. Donc l'utilisation à vitesse modérée avec de nombreux arrêts ne pose pas de problème spécifique. C'est comme la légende urbaine qu'un conducteur de TGV m'a raconté lors d'un accompagnement : Il avait fait un FU intempestif (lié à un défaut technique en cours de traitement) quelques semaines auparavant et son chef traction lui avait affirmé, qu'à cause de sa prétendue boulette, toutes les plaquettes de frein de la rame devaient être changées... (heureusement qu'une rame TGV peut supporter plusieurs freinages d'urgence sans maintenance spécifique : neuve pendant les marches de réception il y a déjà un FU à Vmax, pour contrôler la distance d'arrêt).
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
Comme je l'ai écrit plus haut, je n'ai pas tous les détails internes de ces petits convertisseurs, mais on ne transforme pas une source 3x380 en 1 x 230 sans "travail" sur la forme d'onde. Sinon on monte un simple transformateur 380/230 entre deux phases... mais c'est plus lourd Exact pour le nombre (2 en R1, 8 en R4 et 4 en R8) car j'ai compté un peu trop vite, le local de service de R4 est alimenté par le CVS qui alimente la salle R3 inférieure On s'éloigne su sujet initial....
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
Certes mais je m'échine à écrire que la source d'énergie des prises passagers (dite prise de courant à la place) n'a pas de relation directe (en terme de forme d'onde) avec la distribution 380V triphasée (3 phases sans neutre) qui est distribuée sur toute la rame. Les prises passagers sont alimentées à partir d'un convertisseur (1 CVS pour la salle inférieure, 1 CVS pour la salle supérieure) qui convertit le 380V triphasé en 230V monophasé avec mise à la masse du neutre et protection par un disjoncteur différentiel 30 mA. Sur Dasye, c'est sur le folio 38A du recueil des schémas BT par exemple. Donc la forme d'onde de l'énergie disponible à la place dépend uniquement du petit CVS (3x380v / 230V) et comme il y a beaucoup de ces petits CVS (au moins 16 sur une rame Dasye)...
-
[CC 65500 - 060DA] - Sujet Officiel
D'après la photo du moteur (et ce que j'ai trouvé sur un autre site), le moteur diesel est constitué de 2 moteurs de 6 cylindres accolés (2 moteurs 6LDA28 accolés), soit 12 cylindres au total de 280 mm de diamètre par 360 mm de course
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
Il ne faut pas confondre les onduleurs qui fournissent le réseau triphasé de bord (destiné à la climatisation et au chauffage) et les onduleurs du réseau monophasé qui alimentent les prises destinées aux passagers. Le premier cas est bien sinusoïdal car il alimente des moteurs asynchrones, mais pas le second (à mon humble avis). A l'occasion je vérifierai, par une mesure directe... Pour l'histoire des surtensions sur le réseau ERDF, cela arrive de temps en temps (deux amis ont eu cette mésaventure à 8 ans d'intervalle)... Si le neutre est rompu (connexion desserrée, coupure de câble accidentelle, etc) entre le transformateur de distribution et un groupe d'usagers alimentés en triphasé, le neutre devient flottant et la tension délivrée à l'usager est farfelue (en gros plus on consomme en monophasé (chauffage électrique par ex.) plus on se "protège" par rapport au voisin qui consomme peu. Pour mes deux amis, c'est, pour chacun, une installation dans une zone pavillonnaire, avec un défaut sur le branchement de neutre commun de la zone pavillonnaire. Le neutre de toute la zone pavillonnaire se retrouve isolé du neutre du réseau ERDF, et ensuite c'est le bazar complet. Heureusement ERDF a reconnu sa responsabilité dans les deux cas, mais le traitement par les assurances n'a pas été le même...
-
Incendie sur un engin moteur en gare de La Gouesnière-Cancale (Ille-et-Vilaine)
Je parle des filtres installés sur l'armoire de cabine motrice. A chaque fois qu'une carte de l'armoire revient en réparation , elle est couverte de fibres et particules métalliques au point que je me demande toujours comment les isolements sont encore respectés et tenus. Et les quelques fois où je suis intervenu directement sur rame pour des tests, l'état des filtres expliquait les constatations sur les cartes.... Un filtre encrassé peut très facilement être le foyer d'un incendie par la simple aspiration d'un mégot, car même si la matière du filtre est non combustible, les poussières accumulées se consument avec une fumée horrible (déjà constaté en environnement métro)
-
Incendie sur un engin moteur en gare de La Gouesnière-Cancale (Ille-et-Vilaine)
L'objet du post ou le PS ?
-
A quoi sert le disjoncteur dans un train ?
Déjà il n'y pas un disjoncteur mais plus de 100 disjoncteurs sur un TGV par exemple. Un disjoncteur, c'est à la fois un moyen de protection (ouverture automatique en surcharge) et un moyen d'isolement volontaire (commandé électriquement si les conditions de fonctionnement de l'équipement concerné sont présentes) Il y a des disjoncteurs ultra-rapides pour s'isoler de la source de tension (via la caténaire), donc déjà deux disjoncteurs complètement différents, en terme de volume et de structure, sur une locomotive bi-courant Un disjoncteur pour le courant continu (1500V / 3000V) avec ses énormes cheminées de soufflage d'arc Un disjoncteur pour le courant alternatif (25000V / 15000V) monté sur ses isolateurs HT, en toiture en principe Chaque équipement de puissance possède aussi son propre disjoncteur Chaque équipement alimenté par la batterie possède son propre disjoncteur (à commande manuelle) Un disjoncteur de protection contre les surcharges permet de réduire l'influence d'un défaut local, en limitant (isolant) le circuit en défaut (comme à la maison).
-
Incendie sur un engin moteur en gare de La Gouesnière-Cancale (Ille-et-Vilaine)
Surtout que sur une locomotive électrique, il y a des tas de trucs qui peuvent prendre feu (filtres non entretenus, batteries, transformateur / cuve à self) en plus des moteurs. PS : pour les filtres, j'ai du mal à comprendre la périodicité de nettoyage sur les TGV...
-
[TGV Réseau] Sujet Officiel
Motrice de réserve ou non, le numéro interne de suivi (codage des équipements, adressage réseau, etc) doit être adapté pour que les équipements puissent appartenir au même réseau informatique. Le SIAC reflète donc le numéro interne, et non pas le numéro peint à l'extérieur. Les éléments de codage des équipements sont démontables et transférables d'une motrice à l'autre car non liés électriquement au câblage. Ces éléments sont bien sûrs remplaçables si destruction.
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
Je ne dispose pas des spécifications exactes des onduleurs (et du filtre de sortie) qui alimentent le réseau de prises mises à disposition des passagers, mais je peux affirmer sans trop me tromper que la forme d'onde doit être très éloignée de la sinusoïde, quasi pure, habituellement délivrée par ERDF (moins de 5% de taux de distorsion harmonique (THD)) pour se rapprocher du taux de 40 à 45% de THD, très similaire aux petits onduleurs de sauvegarde pour PC (backup UPS). Sur les prises mises à disposition des passagers, il me semble qu'il y a une étiquette du genre (réservé aux appareils informatiques de moins de 150 W). Car un transformateur classique n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie (génération de pointes de courant à chaque commutation), alors que les petites alimentations (pour PC portable, tablette, et autres téléphones portables) acceptent sans broncher (en principe) ce genre d'alimentation, car elles comportent un redressement du signal d'entrée, puis une mini-alimentation à découpage. J'ai, par contre, quelques doutes pour les dernières générations des alimentations secteur des téléphones/smartphone, car leur taille miniature est très surprenante. Pour fournir une pseudo sinusoïde (presque carrée), c'est beaucoup plus simple, techniquement, que de fournir une sinusoïde quasi parfaite à 50 Hz. En effet un onduleur simplifié, c'est un simple pont en H avec 4 MOSFET commandés de manière "brutale" à 50 Hz avec un temps mort autour du passage à zéro, alors qu'un onduleur qui génère une sinusoïde quasi parfaite, c'est aussi un pont en H (Mosfet ou IGBT en fonction de la puissance) commandé de manière très fine (modulation de largeur d'impulsion, MLI) à 16 ou 20 kHz (voire plus) pour reconstituer une sinusoïde à 50 Hz. Cela génère plus de pertes de commutation donc c'est plus gros et plus cher... C'est donc juste une question de prix... Pour revenir aux clauses que notre ami considère comme abusive, si le THD réel était affiché par étiquette à coté de chaque prise, 99,9 % des utilisateurs seraient incapables de comprendre l'adéquation entre cette information et leur appareil. Donc la clause est plus vague et cherche à rejeter tout responsabilité (aux risques et périls de l'utilisateur). De manière pratique, je peux vous dire que j'ai branché, lors de tests, avec ou sans passagers, sur les prises "passagers" des TGV de très nombreux équipements (PCs portable, téléphones, oscilloscopes, enregistreurs) sans rencontrer le moindre souci. La seule particularité c'est que tous les équipements que j'utilise, ont une batterie interne. Le raccordement sur les prises 230V, sert uniquement à recharger cette batterie interne
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
Il y a du monde dans le "fond" de la R4 (batterie tronçon, CVS, onduleurs, clim R4) bref du lourd et volumineux. Et le bar actuel (partie supérieure) est aussi un gros consommateur électrique (meubles réfrigérés, chauffe-plats, etc). Je n'ai pas d'information sur la miniaturisation de ces éléments de puissance, même de conception ancienne pour certains (mais pas pour tous les équipements, car heureusement il y a déjà eu des changements technologiques au fil des séries de matériel). Et de toute façon, si je connaissais des trucs "innovants" je ne l'écrirai pas dans un forum, avant la sortie d'usine du matériel concerné.
-
[Z 5300] Sujet Officiel
SI, si très beau. Au premier coup d’œil, on a même l'impression que la rame est en lévitation.
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
L'informatique embarquée est soumise aux mêmes contraintes de variation de tension d'alimentation primaire (= BT = 50 à 90V) et comme tous les calculateurs embarqués (contrôle/commande des tous les équipements CVS, onduleurs pour réseau de bord, onduleurs de traction, etc) les alimentations internes (secondaires) sont régulées à des valeurs très précises et très stables quelles que soient les outrages externes (variations BT, variation température, variation de charge), dans une fourchette de +/-2 à 3 % en général Les prises 230V mises à disposition des passagers et du personnel de bord sont alimentées à partir de petits onduleurs alimentés par l'un des réseaux électriques de bord (environ un onduleur par voiture ou par motrice). Je ne connais pas les spécifications de ces onduleurs, mais je suppose que les tolérances ERDF (+/-10 %) sont appliquées. Toutes ces prises sont opérationnelles lorsque la tension caténaire est présente (+ panto levé) et rame préparée. Il n'y a donc aucun risque (sauf panne non détectée) d'avoir une tension de 276V, car entre la caténaire et la prise 230V il y a au moins deux étages intermédiaires qui stabilisent les variations (caténaire --> réseau de bord -->230V)
-
Déraillement d'un train Intercités à Brétigny-sur-Orge
Avec des "si" on peut aussi refaire le monde ! La signalisation doit assurer son rôle, point barre !
-
Stabilité de l'alimentation électrique des engins moteurs.
La fréquence est liée à la vitesse de rotation des moteurs synchrones ou asynchrones donc à la vitesse de la rame. La tension du bus continu intermédiaire dans les blocs moteurs peut varier en fonction de la vitesse de rotation des moteurs (optimisation du rapport U/F). Depuis des lustres, les différentes générations d'électronique de puissance, soit pour piloter les moteurs de traction, soit pour piloter les auxiliaires (CVS, réseau AC et DC de bord) se jouent des variations de la tension caténaire, pour faire au mieux vis à vis des caractéristiques à respecter (accélérations, etc). A bord, la tension batterie dite "72V" est spécifiée comme variable entre 50 à 90V en fonction de très nombreux paramètres (chargeur batterie actif ou non). là aussi les équipements doivent supporter ces variations sans broncher, voire même accepter des excursions temporaires de 50V à 36V ou de 90V à 115V. sans parler des micro-coupures.