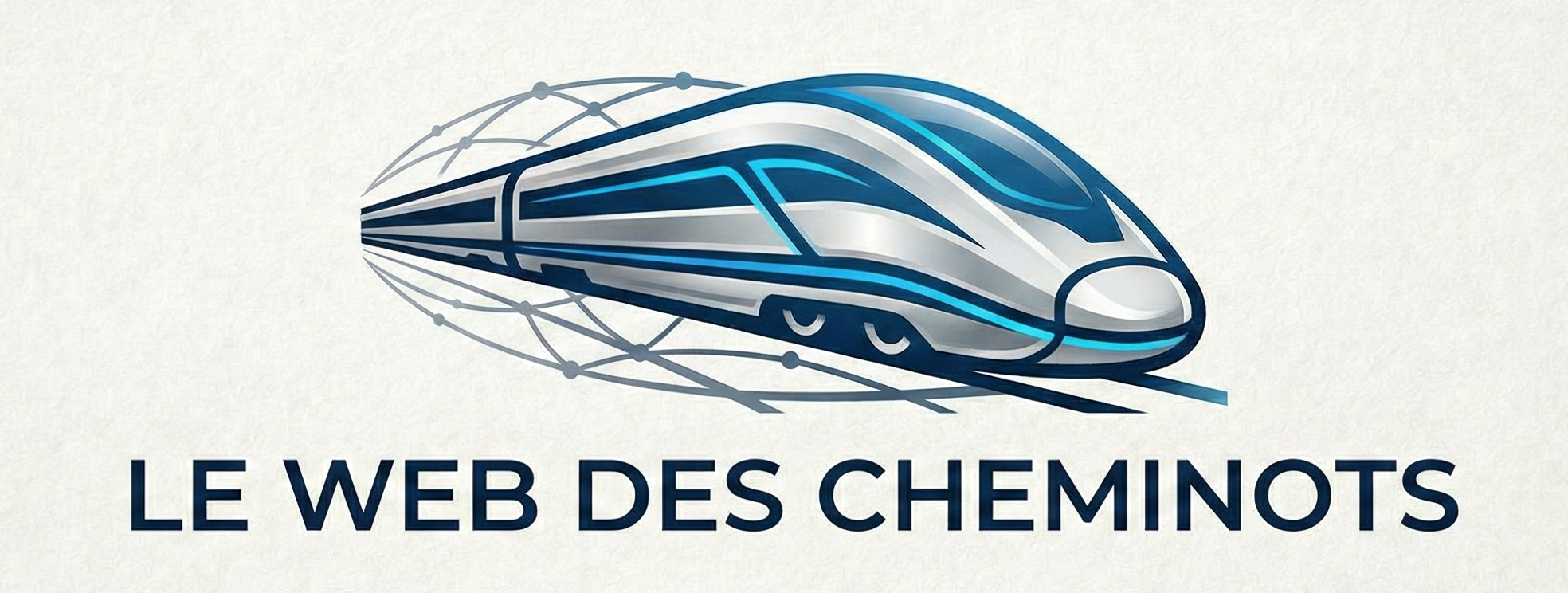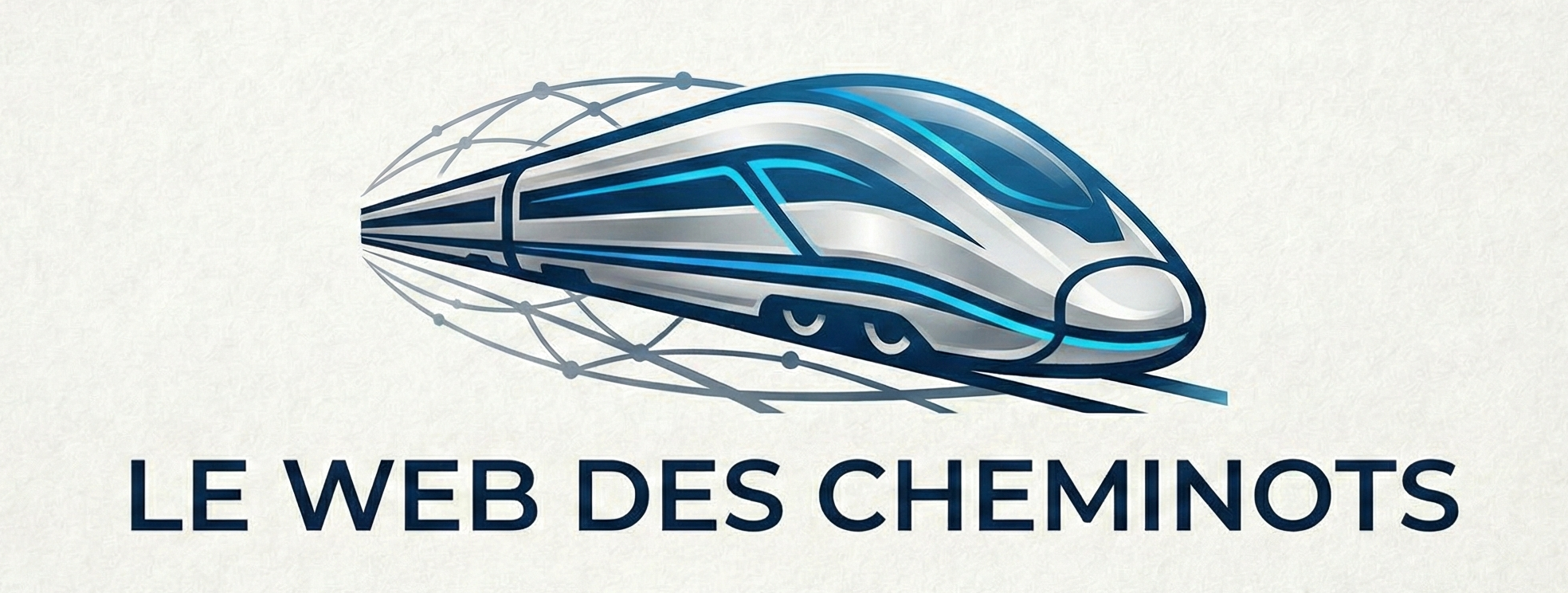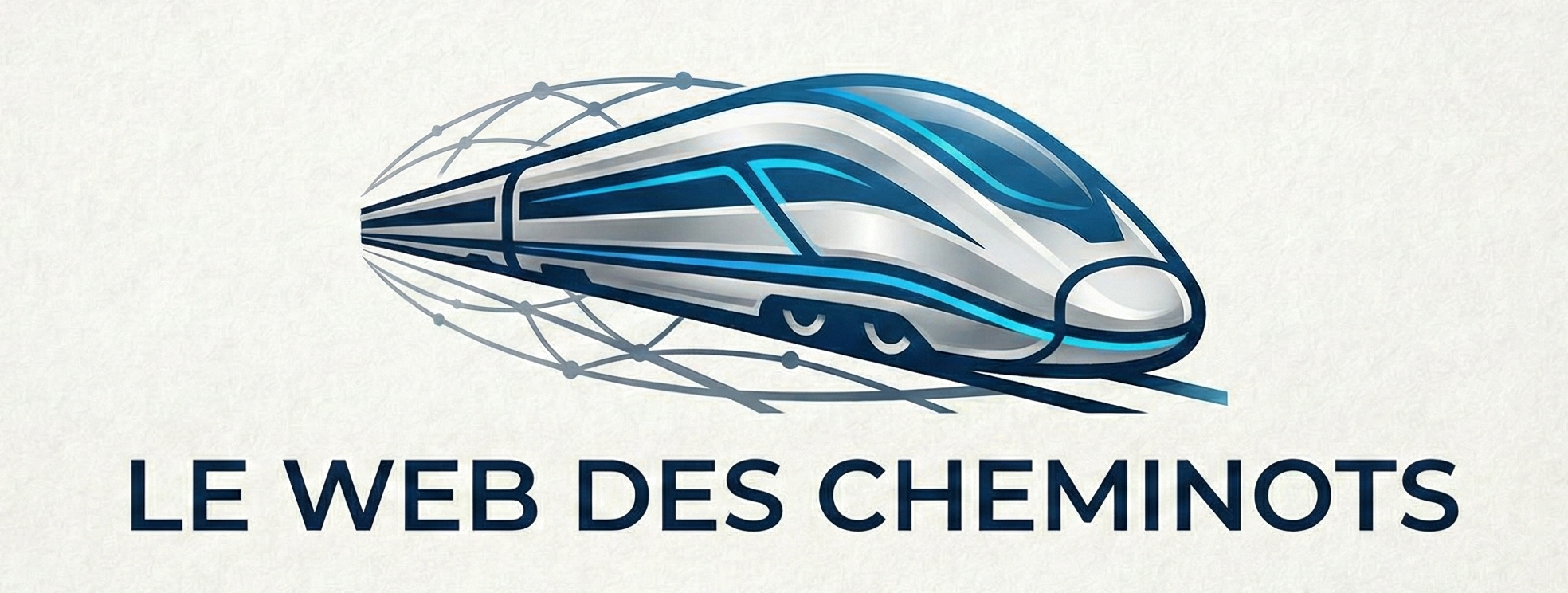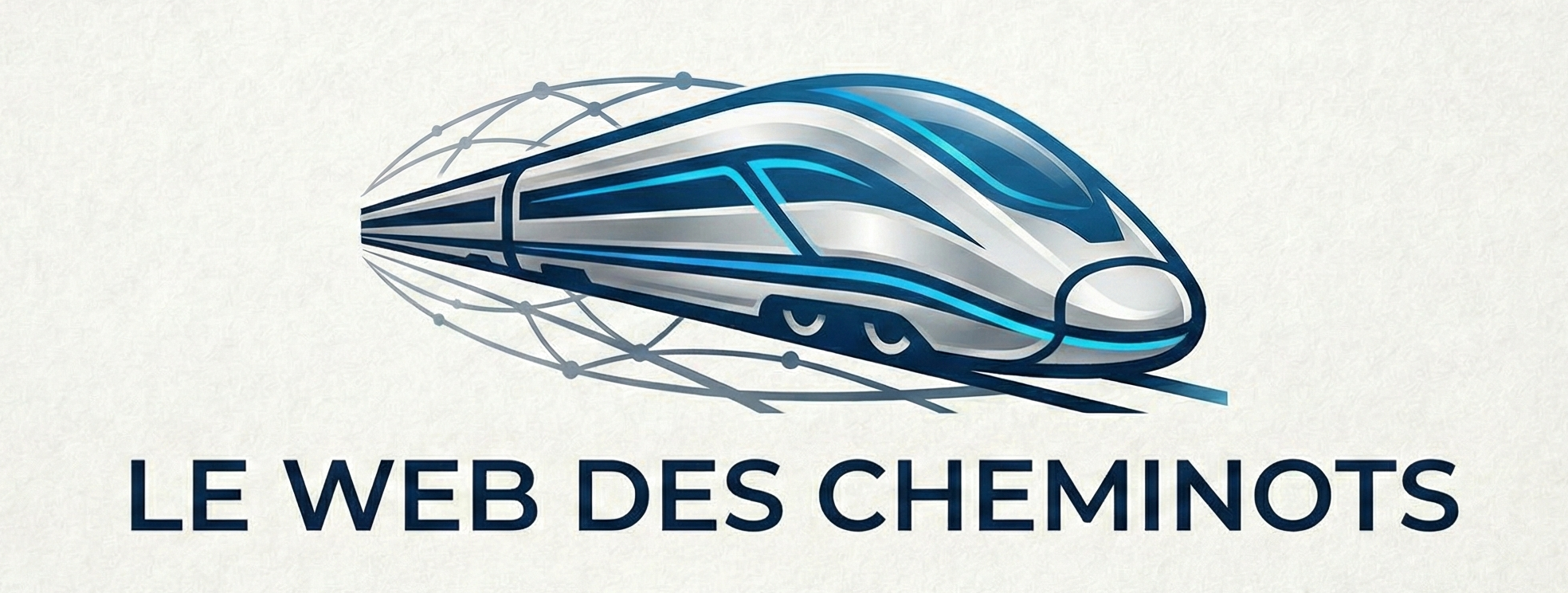Tout ce qui a été posté par Dom Le Trappeur
-
Taxe carbone : estimez ce qu'il aurait pu vous en couter
Comme pour la CSG ?
-
Taxe carbone : estimez ce qu'il aurait pu vous en couter
Et de toute façon c'est le citoyen (consommateur, client, usager, utilisateur...) qui paye la taxe donc pourquoi se priver d'une taxe supplémentaire ? D'après je ne sais plus qui... Sarko a créer une dizaine de taxes depuis qu'il est notre Très Cher Président... Taxer les entreprise, les routiers etc etc... De toute façon ils répercuteront les taxes dans les prix...
-
Actualités Politiques
La garde à vue à nouveau sur la sellette Selon le contrôleur des lieux de privation de liberté, le nombre de ces procédures serait de 750 000 en 2008, très au-dessus des chiffres officiels. Jean-Marie Delarue dénonce l’obsession de la sécurité. En septembre, l’Office national de la délinquance chiffrait à 578 000 le nombre de gardes à vue en 2008. Soit une hausse de 54 % par rapport à 2000. Derrière cette croissance inquiétante, l’obsession présidentielle du chiffre. Une dérive arithmétique comme un hypothétique paravent à l’échec de sa politique sécuritaire. Depuis de longues semaines, les magistrats, et même une bonne partie des policiers, dénoncent cette idée fixe élyséenne. Hier, dans un entretien accordé au Journal du dimanche, c’est le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, qui a apporté sa pierre au débat : « Ma hantise, c’est l’obsession actuelle de la sécurité. Le problème, c’est que la sécurité n’a jamais de fin. » D’ici à la fin janvier, le contrôleur, nommé en juin 2008, doit remettre le résultat de son tour de France des prisons et commissariats. Au final, ce sont plus de 200 établissements qui ont été visités. Le constat promet d’être accablant. Et parfois surprenant : « Nous avons découvert que le nombre de gardes à vue est minoré. D’après nos estimations, cela peut représenter 20 à 25 %, voire 30 % des effectifs. On arrive à 750 000 gardes à vue, ce qui est beaucoup », détaille Jean-Marie Delarue. Les explications, le contrôleur général les trouve dans les infractions liées au Code de la route, qui ne seraient pas comptabilisées. Il souligne également, au passage, des « registres de garde à vue souvent mal tenus : il manque l’heure de fin, ou alors on fait signer la page de sortie à la personne dès son arrivée ». Et de s’interroger, par ailleurs, sur ces errements : « C’est curieux… Est-ce par commodité, parce que les policiers sont débordés ? » Autres griefs évoqués : l’inconfort et les conditions de détention parfois humiliantes, citant pour exemples le retrait systématique du soutien-gorge pour les femmes, l’absence de savon et de serviette dans les douches ou encore « les gens qu’on ne laisse pas aller aux toilettes ». Avant même le rapport final de Jean-Marie Delarue, ces déclarations pourraient relancer la polémique sur la garde à vue. Depuis le 17 novembre, le barreau de Paris et l’association Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat réclament une réforme des conditions de garde à vue. Lionel Decottignies L'Humanité http://www.humanite.fr/La-garde-a-vue-a-no...sur-la-sellette
-
Actualités Politiques
Sûr...ils vont demander une prime de risques... bigbisous
-
Déraillement transilien à Choisy le Roi
Le trafic du RER C reste perturbé une semaine après un accident Reuters Le trafic est toujours perturbé sur le RER C, une semaine après un accident sur une voie dans le Val-de-Marne, annonce la RATP. Des équipes sont encore à l'oeuvre pour réparer les dégâts occasionnés par la chute sur les rails d'un bloc de béton, après qu'un automobiliste a percuté dimanche 20 décembre le parapet d'un pont enjambant la voie. "Le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne C du RER avec un train toutes les 30 minutes environ", écrit la RATP sur son site internet (www.ratp.fr). Les gares situées entre la Bibliothèque François Mitterrand, dans le sud-est de Paris, et Juvisy, dans l'Essonne, ne sont pas desservies. Le trafic est normal sur les autres lignes de RER, notamment sur la A, où les conducteurs ont mis fin à leur mouvement de grève entamé le jeudi 10 décembre. Clément Guillou
-
Heu c' est légal ca ?
Peux-tu nous donner deux précisions : As-tu reçu ce message par MP ou dans ta boîte perso e-mail Ce message a -t-il été envoyé par "cheminots" ou a -t-il été envoyé ou a-t-il transité par le Forum"cheminots.net" Au fait pourquoi cette boîte cheminots (peuvent pas causer en français ?) n'ouvre-t-elle pas directement un fil de discussion ouvert à tous sur le forum ? Bon ceci dit proposer un CDD (de quelle durée ? 15 jours 3 semaines ?) à des cheminots qui sont en CDI...
-
Bon Anniversaire !
Bon Anniversaire 8 membres fêtent leur anniversaire ce jour km315(43), Bloupeur(22), mat_37(35), Altaria(21), franck(29), Triton56845(23), dc57(31), flintstone(37)
-
Heu c' est légal ca ?
N'entravant rien à la langue de Shakespeare, je ne me sens absolument pas concerné... Désolé
-
RER A : pourquoi l'Elysée a choisi la fermeté ?
RER A : pourquoi l'Elysée a choisi la fermeté LE MONDE | 24.12.09 | La grève des conducteurs du RER A est entrée, jeudi 24 décembre, dans sa 14e journée. Elle aura été la plus longue qu'ait connue l'entreprise sur le réseau RER depuis 1995. A trois mois des élections régionales, alors que les transports sont un sujet éminemment sensible en Ile-de-France, le conflit a aussi pris valeur de test politique. S'il est resté silencieux sur le sujet "pour ne pas gêner les négociations", explique l'Elysée, Nicolas Sarkozy n'en a pas moins suivi de très près l'évolution du conflit. La position de fermeté de la direction face aux revendications des conducteurs en grève a été validée par le conseiller social du président, Raymond Soubie, en accord avec Pierre Mongin, le PDG de la RATP. Elle tranche avec ce qui s'était passé en novembre lorsqu'une grève était survenue sur la ligne B du RER. Les syndicats de la RATP et de la SNCF avaient alors obtenu gain de cause en moins de cinq jours. La gauche et quelques voix à droite s'étaient une nouvelle fois gaussées de l'inefficacité de la loi sur le service minimum. Exactement comme en décembre 2008-janvier 2009 où la longue grève des cheminots de la SNCF avait conduit à la totale paralysie de la gare Saint-Lazare le 13 janvier, faisant mentir l'affirmation de M. Sarkozy selon laquelle : "Aujourd'hui, lorsqu'il y a une grève, personne ne s'en aperçoit." Cette fois, changement de stratégie. "Dans le contexte de crise, ne pas donner l'impression de céder était la seule stratégie à tenir pour éviter la contagion du mouvement à l'intérieur de la RATP et au-delà", explique l'entourage du chef de l'Etat. C'était la position de départ de M. Mongin. D'autant plus risquée qu'après le récent départ de la directrice des ressources humaines, Josette Théophile, et de Pascal Auzannet, directeur du RER, il manquait des interlocuteurs rompus aux difficiles négociations avec les syndicats. L'Elysée a soutenu la fermeté, car il a parié sur l'impopularité du conflit. Il a aussi voulu démontrer que cette fois-ci la loi sur le service minimum du 21 août 2007 était bien entrée en application, comme l'a rappelé le premier ministre François Fillon. Pour la deuxième fois de son histoire, la RATP a fait appel à quelque 80 cadres de l'entreprise pour conduire les rames à la place des conducteurs grévistes. " C'est la première fois que nous assurons notre objectif d'un train sur deux en heure de pointe", s'est félicité M. Mongin. Cette possibilité de recourir aux cadres pour suppléer les conducteurs prééxistait à la loi sur "le service minimum". Mais le premier ministre s'est empressé de voir dans cette mesure la conséquence directe et bénéfique de la loi du 21 août 2007, "qui permet aux voyageurs franciliens d'aller à leur travail et d'en revenir". Dans la précampagne des élections régionales, le conflit aura été aussi l'occasion d'une épreuve de force politique entre Valérie Pécresse, tête de liste UMP en Ile-de-France, et Jean-Paul Huchon, le patron (PS) de la région, également président du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Mme Pécresse s'en est pris à "l'immobilisme et la passivité" de M. Huchon. La candidate UMP l'a enjoint d'user de ses prérogatives de président du STIF pour mettre en place des "bus de remplacement", injonction que M. Huchon a qualifiée de "plaisanterie. Un million de personnes, ça fait 10 000 bus...". "M. Huchon est parti à Copenhague en laissant les usagers du RER A sur le quai, a confié Mme Pécresse au Monde, mardi 22 décembre. Comme si la région ne pouvait rien faire." M. Huchon n'a pas attendu les critiques de l'UMP pour dénoncer le "pourrissement volontaire" du conflit dans le but de "faire porter le chapeau à la région". Il a rappelé que "le seul responsable du conflit est l'entreprise exploitante dont l'Etat est actionnaire. Le STIF n'est pas chargé des personnels des entreprises. Il s'occupe du fonctionnement et de l'exploitation du réseau". Le président socialiste de la région s'est toutefois gardé de donner "raison" aux grévistes, comme l'a fait Benoît Hamon, le porte-parole du PS. Il se serait exposé aux critiques encore plus virulentes de Mme Pécresse qui lui reproche "d'avoir jeté de l'huile sur le feu en proposant au gouvernement de nommer un médiateur alors que le conflit était en voie d'apaisement". Jean-Paul Huchon s'est en revanche promis, s'il est réélu, de remettre en question le contrat qui lie le STIF à la RATP et dont le montant, a-t-il rappelé, s'élève à 4 milliards d'euros par an. "Quand je vois Pierre Mongin et la RATP investir dans des opérations asiatiques ou exotiques les bénéfices qu'ils font, plutôt que de réinvestir sur l'Ile-de-France je ne suis pas content", a-t-il grondé. Béatrice Jérôme
-
Le Bar de la Rotonde
S'est-elle fait vacciner contre le virus...?
-
La grande vitesse en Chine
La Chine inaugure une ligne à grande vitesse, la plus rapide au monde samedi 26 déc, PEKIN (AFP) - La Chine a inauguré samedi une nouvelle ligne de transport de passagers à grande vitesse entre les métropoles de Wuhan (centre) et de Canton (sud), la plus rapide au monde selon les autorités avec une vitesse moyenne de 350 km/h, ont rapporté les médias officiels. PUBLICITÉ Cette ligne de 1.069 kilomètres de long, dont les travaux ont été lancés en juin 2005, est un des tronçons de celle qui reliera à terme Pékin à Canton, capitale de la province du Guangdong, a indiqué l'agence Chine Nouvelle. Montrant des images des trains flambant neufs partant de la gare de Wuhan, produits grâce à des transferts de technologie étrangère, la télévision officielle CCTV a souligné que le trajet serait de trois heures, contre 10 avant l'entrée en service de la ligne à très grande vitesse. "Le train peut aller jusqu'à 394,2 km/h, c'est le plus rapide au monde en opération avec deux trains couplés en double traction", a déclaré Zhang Shuguang, directeur du Bureau des transports au ministère des Chemins de fer. La vitesse moyenne des trains à grande vitesse est de 243 km/h au Japon, de 232 km/h en Allemagne et de 277 km/h en France, selon Xu Fangliang, ingénieur général de la ligne Wuhan-Canton, cité par l'agence Chine Nouvelle. Cette nouvelle ligne de transport de passagers permettra aussi d'alléger la pression qui pèse sur le trafic fret en provenance de la région industrielle du Guangdong, l'une des principales zones industrielles de la Chine. Pékin mène un ambitieux programme de développement du ferroviaire qui vise à doter la Chine de 120.000 km de lignes -- contre 86.000 km actuellement, le deuxième réseau au monde après les Etats-Unis --, dont 12.000 à grande vitesse. La première ligne à grande vitesse avait été inaugurée au moment des jeux Olympiques en août 2008, reliant Pékin à la ville portuaire de Tianjin en une demi-heure. En septembre, les autorités avaient indiqué vouloir près de 300 milliards de dollars (plus de 205 milliards d'euros) dans la construction de 42 lignes à grande vitesse d'ici 2012 afin de soutenir la croissance.
-
Actualités Politiques
"Ce que Sarkozy propose, c'est la haine de l'autre" LE MONDE | 26.12.09 | Démographe et historien, Emmanuel Todd, 58 ans, est ingénieur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED). Inspirateur du thème de la fracture sociale, repris par Jacques Chirac lors de sa campagne présidentielle de 1995, il observe depuis longtemps la coupure entre élites et classes populaires. Il livre pour la première fois son analyse du débat sur l'identité nationale. Sans dissimuler sa colère. "Si vous êtes au pouvoir et que vous n'arrivez à rien sur le plan économique, la recherche de boucs émissaires à tout prix devient comme une seconde nature", estime-t-il. Que vous inspire le débat sur l'identité nationale ? Je m'en suis tenu à l'écart autant que possible, car ce débat est, à mes yeux, vraiment pervers. Le gouvernement, à l'approche d'une échéance électorale, propose, je dirais même impose, une thématique de la nation contre l'islam. Je suis révulsé comme citoyen. En tant qu'historien, j'observe comment cette thématique de l'identité nationale a été activée par en haut, comme un projet assez cynique. Quelle est votre analyse des enjeux de ce débat ? Le Front national a commencé à s'incruster dans le monde ouvrier en 1986, à une époque où les élites refusaient de s'intéresser aux problèmes posés par l'intégration des populations immigrées. On a alors senti une anxiété qui venait du bas de la société, qui a permis au Front national d'exister jusqu'en 2007. Comme je l'ai souligné dans mon livre, Le Destin des immigrés (Seuil), en 1994, la carte du vote FN était statistiquement déterminée par la présence d'immigrés d'origine maghrébine, qui cristallisaient une anxiété spécifique en raison de problèmes anthropologiques réels, liés à des différences de système de moeurs ou de statut de la femme. Depuis, les tensions se sont apaisées. Tous les sondages d'opinion le montrent : les thématiques de l'immigration, de l'islam sont en chute libre et sont passées largement derrière les inquiétudes économiques. La réalité de la France est qu'elle est en train de réussir son processus d'intégration. Les populations d'origine musulmane de France sont globalement les plus laïcisées et les plus intégrées d'Europe, grâce à un taux élevé de mariages mixtes. Pour moi, le signe de cet apaisement est précisément l'effondrement du Front national. On estime généralement que c'est la politique conduite par Nicolas Sarkozy qui a fait perdre des voix au Front national... Les sarkozystes pensent qu'ils ont récupéré l'électorat du Front national parce qu'ils ont mené cette politique de provocation, parce que Nicolas Sarkozy a mis le feu aux banlieues, et que les appels du pied au FN ont été payants. Mais c'est une erreur d'interprétation. La poussée à droite de 2007, à la suite des émeutes de banlieue de 2005, n'était pas une confrontation sur l'immigration, mais davantage un ressentiment anti-jeunes exprimé par une population qui vieillit. N'oublions pas que Sarkozy est l'élu des vieux. Comment qualifiez-vous cette droite ? Je n'ose plus dire une droite de gouvernement. Ce n'est plus la droite, ce n'est pas juste la droite... Extrême droite, ultra-droite ? C'est quelque chose d'autre. Je n'ai pas de mot. Je pense de plus en plus que le sarkozysme est une pathologie sociale et relève d'une analyse durkheimienne - en termes d'anomie, de désintégration religieuse, de suicide - autant que d'une analyse marxiste - en termes de classes, avec des concepts de capital-socialisme ou d'émergence oligarchique. Le chef de l'Etat a assuré qu'il s'efforçait de ne pas être "sourd aux cris du peuple". Qu'en pensez-vous ? Pour moi, c'est un pur mensonge. Dans sa tribune au Monde, Sarkozy se gargarise du mot "peuple", il parle du peuple, au peuple. Mais ce qu'il propose aux Français parce qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes économiques du pays, c'est la haine de l'autre. La société est très perdue mais je ne pense pas que les gens aient de grands doutes sur leur appartenance à la France. Je suis plutôt optimiste : quand on va vraiment au fond des choses et dans la durée, le tempérament égalitaire des Français fait qu'ils n'en ont rien à foutre des questions de couleur et d'origine ethnique ou religieuse ! Pourquoi, dans ces conditions, le gouvernement continue-t-il à reprendre à son compte une thématique de l'extrême droite ? On est dans le registre de l'habitude. Sarkozy a un comportement et un vocabulaire extrêmement brutaux vis-à-vis des gamins de banlieue ; il les avait utilisés durant la campagne présidentielle tandis qu'il exprimait son hostilité à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne dans un langage codé pour activer le sentiment antimusulman. Il pense que cela pourrait marcher à nouveau. Je me demande même si la stratégie de confrontation avec les pays musulmans - comme en Afghanistan ou sur l'Iran - n'est pas pour lui un élément du jeu intérieur. Peut-être que les relations entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, c'est déjà pour lui de la politique extérieure ? On peut se poser la question... Si vous êtes au pouvoir et que vous n'arrivez à rien sur le plan économique, la recherche de boucs émissaires à tout prix devient comme une seconde nature. Comme un réflexe conditionné. Mais quand on est confronté à un pouvoir qui active les tensions entre les catégories de citoyens français, on est quand même forcé de penser à la recherche de boucs émissaires telle qu'elle a été pratiquée avant-guerre. Quels sont les points de comparaison avec cette période ? Un ministre a lui-même - c'est le retour du refoulé, c'est l'inconscient - fait référence au nazisme. (Christian Estrosi, le 26 novembre, a déclaré : "Si, à la veille du second conflit mondial, dans un temps où la crise économique envahissait tout, le peuple allemand avait entrepris d'interroger sur ce qui fonde réellement l'identité allemande, héritière des Lumières, patrie de Goethe et du romantisme, alors peut-être, aurions-nous évité l'atroce et douloureux naufrage de la civilisation européenne.") En manifestant d'ailleurs une ignorance de l'histoire tout à fait extraordinaire. Car la réalité de l'histoire allemande de l'entre-deux-guerres, c'est que ce n'était pas qu'un débat sur l'identité nationale. La différence était que les nazis étaient vraiment antisémites. Ils y croyaient et ils l'ont montré. La France n'est pas du tout dans ce schéma. Il ne faut pas faire de confusion, mais on est quand même contraint de faire des comparaisons avec les extrêmes droites d'avant-guerre. Il y a toutes sortes de comportements qui sont nouveaux mais qui renvoient au passé. L'Etat se mettant à ce point au service du capital, c'est le fascisme. L'anti-intellectualisme, la haine du système d'enseignement, la chasse au nombre de profs, c'est aussi dans l'histoire du fascisme. De même que la capacité à dire tout et son contraire, cette caractéristique du sarkozysme. La comparaison avec le fascisme, n'est-ce pas excessif ? Il ne s'agit pas du tout de dire que c'est la même chose. Il y a de grandes différences. Mais on est en train d'entrer dans un système social et politique nouveau, qui correspond à une dérive vers la droite du système, dont certains traits rappellent la montée au pouvoir de l'extrême droite en Europe. C'est pourtant Nicolas Sarkozy qui a nommé à des postes-clés plusieurs représentantes des filles d'immigrés... L'habileté du sarkozysme est de fonctionner sur deux pôles : d'un côté la haine, le ressentiment ; de l'autre la mise en scène d'actes en faveur du culte musulman ou les nominations de Rachida Dati ou de Rama Yade au gouvernement. La réalité, c'est que dans tous les cas la thématique ethnique est utilisée pour faire oublier les thématiques de classe. Propos recueillis par Jean-Baptiste de Montvalon et Sylvia Zappi
-
panne au tunel sous la manche
Panne d'Eurostar : le réquisitoire d'Eurotunnel lefigaro avec agences 25/12/2009 | L'opérateur du tunnel sous la Manche affirme avoir convenablement réagi, suite aux pannes de l'Eurostar, et dénonce les erreurs de la compagnie ferroviaire et de la police anglaise. Eurotunnel n'est pour rien dans la grande pagaille qui a suivi la panne il y a tout juste une semaine dans le tunnel sous la Manche. C'est le message adressé vendredi par l'opérateur, dans un communiqué aux allures de réquisitoire. S'estimant «injustement suspecté de ne pas avoir réagi comme il convenait», Eurotunnel rejette en grande partie la faute sur Eurostar. «Eurotunnel n'est ni la cause de ces pannes, ni en charge de la relation clientèle d'Eurostar», affirme le groupe, ajoutant que ses «équipes sont intervenues avec rapidité et professionnalisme, au-delà même de leur tâche normale». Dans le détail, Eurotunnel critique l'information fournie aux passagers par la compagnie ferroviaire. «Bien qu'en relation continue avec nos équipes, il est évident que les équipages d'Eurostar n'ont visiblement pas relayé les informations utiles aux passagers», ce qui a notamment «conduit à un mouvement d'inquiétude» dans un des trains concernés, «nous obligeant par sécurité à décider son évacuation immédiate par un tunnel de service», affirme Eurotunnel. Une navette a alors été envoyée «pour le sauvetage des personnes», mais «les délais de cette évacuation ont été malheureusement allongés parce que les équipages d'Eurostar, en totale violation avec les procédures de secours, ont demandé aux passagers de prendre leurs bagages avec eux». Environ 2.000 personnes sont restées bloquées dans le tunnel pendant la nuit du 18 au 19 décembre, après cette panne liée aux intempéries. Certains passagers sont restés coincés pendant plus de 17 heures sans eau et sans nourriture, ce qui a provoqué une vive polémique. Un déficit de communication Dans son communiqué, Eurotunnel épingle aussi la police du Kent, pour avoir selon lui, «de manière incompréhensible, engagé d'interminables vérifications» des voyageurs rapatriés sur Folkestone pour être repris en charge par Eurostar. Après cela, les deux trains envoyés de Londres pour récupérer les passagers sont arrivés «très tard, sans approvisionnement, sans équipage». Et Eurotunnel de souligner «que toutes les opérations de secours ont été dirigées à partir de 0h40 par les Etats français et britannique». Jeudi, la commission franco-britannique supervisant le trafic dans le tunnel sous la Manche avait estimé qu'Eurostar et Eurotunnel n'avaient pas correctement rempli leur mission d'information auprès des passagers. Lundi, Eurostar avait dénoncé un manque d'information entre le personnel à bord des trains et Eurotunnel. D'après Eurotunnel, le centre son PC de crise et les trains sont pourtant resté en contact permanent : «si tel n'avait pas été le cas, les opérations de secours très complexes n'auraient pu être réalisées en toute sécurité». En guise de conclusion, Eurotunnel promet tout de même de faire «tout ce qui est en son possible pour permettre à Eurostar de surmonter cette crise le plus rapidement possible», en rappelant que les deux groupes collaborent depuis 15 ans pour assurer les liaisons sous la Manche. Il indique avoir proposé «des mesures concrètes pour améliorer la rapidité et le confort des évacuations», comme la mise à disposition «par Eurostar ou ses actionnaires» d'une troisième unité de dépannage et d'un train de voyageurs, plus confortable que les navettes.
-
panne au tunel sous la manche
Panne d'Eurostar : le film des opérations selon Eurotunnel AFP 25/12/2009 | Dans la nuit du 18 au 19 décembre, cinq trains sont tombés en panne dans le tunnel sous la Manche à cause de la neige, paralysant le trafic des Eurostar pendant trois jours. • 20h53 : un premier Eurostar (9157) transportant 679 passagers tombe en panne à cause de la neige. Le groupe Eurotunnel, qui dispose de deux unités de dépannage, en envoie une sur place qui intervient et finit par tracter le train jusqu'à Londres. Il arrive à Londres vers 00H15. • 22h38: un deuxième Eurostar (9053) avec à son bord 700 passagers tombe en panne à l'intersection des deux tunnels ferroviaires sous la Manche. La seconde unité de secours d'Eurotunnel tente de se rendre sur place. • 23h10: le troisième Eurostar (9055), qui transportait 700 passagers, tombe également en panne et bloque l'arrivée de la deuxième unité de secours qui finalement va venir le pousser jusqu'à Folkestone, entre 01H00 et 02H00 du matin. • 00h00: une navette passager qui transporte habituellement les voitures dans le tunnel sous le Manche, va chercher les passagers du deuxième Eurostar (9053), pour les acheminer en Grande-Bretagne. Mais la durée de cette évacuation a été allongée parce que les équipages d'Eurostar ont demandé aux passagers de prendre leurs bagages avec eux. Les passagers arrivent vers 03H00 du matin à Folkestone (Grande-Bretagne). • 00h40: les opérations de secours, menées jusqu'alors par Eurotunnel, sont reprises en main par les Etats français et britannique, selon le dispositif de coopération entre les deux Etats pour oeuvrer dans le tunnel sous la Manche (BINAT). • 00h51: un quatrième Eurostar (9057) avec 664 passagers à son bord, tombe en panne, alors qu'il devait basculer dans le tunnel opposé. Les équipages d'Eurostar n'ayant «pas relayé les informations utiles» aux passagers, un «mouvement d'inquiétude» s'est créé dans ce train, ce qui a obligé Eurotunnel à décider son évacuation immédiate par le tunnel de service, car le train n'était pas tractable. La coque située à l'avant du train et protégeant l'attelage refusait de s'ouvrir, indique Eurotunnel. Le groupe a envoyé une deuxième navette, mais la durée de cette évacuation a été également allongée parce que les équipages d'Eurostar ont demandé aux passagers de prendre leurs bagages avec eux. La navette sort du tunnel côté France vers 03h30 et les passagers vont attendre jusqu'à 05h00 pour repartir en Grande-Bretagne, dans cette navette. • 00h55: panne du cinquième Eurostar (9059), avec 630 passagers à son bord, qui se trouve derrière le 9055. Malgré une complication supplémentaire liée à son positionnement à l'intersection des deux tunnels, une évacuation est décidée. L'unité de secours va s'accrocher à ce train et au 9055 pour les pousser jusqu'à Folkestone. Les passagers de ces deux trains arrivent vers 04h00 à Folkestone. • Entre 02h00 et 06h00: Eurostar envoie deux trains à Folkestone chercher les passagers qui ont été évacués par les navettes passagers d'Eurotunnel. La police du Kent procède au transbordement des passagers entre les navettes et les trains Eurostar, mais les opérations sont très longues en raison d'«interminables «vérifications». • 05h30: reprise du service de navettes d'Eurotunnel dont plusieurs milliers de clients étaient également temporairement «bloqués sur site» en raison de «l'indisponibilité des tunnels».
-
panne au tunel sous la manche
Nos entreprises ferroviaires privées se déchirent... sûrement une affaire de gros sous en perspectives... Eurotunnel se défend et critique Eurostar après la panne Reuters Eurotunnel rejette les accusations selon lesquelles il aurait mal réagi lors de la panne monstre qui a interrompu le trafic Eurostar pendant trois jours, et critique la compagnie ferroviaire. Alors qu'Eurostar prévoit le retour à un service normal samedi entre Paris, Bruxelles et Londres, le groupe chargé de l'exploitation du tunnel sous la Manche lui reproche notamment de ne pas avoir toujours respecté les procédures de secours. Il affirme ainsi dans un communiqué diffusé vendredi que les délais d'une "évacuation ont été allongés parce que les équipages de la compagnie ferroviaire, en totale violation avec les procédures de secours, ont demandé aux passagers de prendre leurs bagages avec eux. Les querelles continuent donc sur les responsabilités dans la pagaille qui a suivi la panne de cinq trains dans le tunnel sous la Manche le week-end dernier, bloquant des milliers de passagers. Le trafic Eurostar a repris progressivement à partir de mardi. Le 23 décembre, 24 trains ont circulé sur la cinquantaine habituelle et le 24 décembre, 37, selon le communiqué d'Eurotunnel. Aucun train n'a en revanche circulé vendredi, les Eurostar ne roulant jamais le 25 décembre. La commission franco-britannique supervisant le trafic dans le Tunnel sous la Manche a estimé jeudi que les sociétés Eurostar et Eurotunnel n'avaient pas correctement rempli leur mission d'information auprès des passagers. De leur côté, les deux groupes ont une vision très opposée sur le partage des responsabilités. Des points de désaccord avaient déjà surgi le week-end dernier sur les raisons exactes des pannes ayant touché les TGV. Balayant la thèse d'une fragilité de ses trains, la compagnie ferroviaire a affirmé que les causes étaient purement météorologiques. Elle a mis en cause "une neige poudreuse exceptionnellement fine", qui s'est "accumulée dans les compartiments moteur", et "s'est condensée brutalement lors de l'entrée dans le tunnel", où il fait chaud, bloquant les systèmes de ventilation. A l'appui de sa démonstration, un responsable de l'exploitant a souligné que même les navettes d'Eurotunnel, chargées d'assurer le transport des marchandises et des véhicules, étaient à l'arrêt la nuit des pannes. COMMISSION D'ENQUÊTE Une information aussitôt démentie par Eurotunnel, affirmant que son infrastructure n'avait jamais cessé d'être opérationnelle. "Dans les mêmes conditions, nos trains marchaient et ce sont nos navettes qui ont porté assistance aux trains et aux passagers d'Eurostar", soulignait une porte-parole samedi dernier. Pour faire la lumière sur les responsabilités, le conseil d'administration d'Eurostar a nommé une commission d'enquête indépendante. Mais dans son communiqué, Eurotunnel estime que les deux personnalités qualifiées choisies par la compagnie ferroviaire ne constituent pas une commission d'enquête indépendante. Plus largement, l'opérateur du tunnel estime avoir été "injustement suspecté de ne pas avoir réagi comme il convenait". Il rappelle en détail les conditions d'intervention de ses unités de dépannage pour sortir du tunnel des TGV tombés en panne. Et il met en cause un défaut d'information des équipages d'Eurostar. "Bien qu'en relation continue avec nos équipes, il est évident que les équipages d'Eurostar n'ont visiblement pas relayé les informations utiles aux passagers", dit le communiqué d'Eurotunnel. "Ceci a conduit à un mouvement d'inquiétude dans l'Eurostar 9057 nous obligeant par sécurité à décider son évacuation immédiate par le tunnel de service, d'autant plus qu'il n'était pas tractable, la coque située à l'avant du train et protégeant l'attelage refusant de s'ouvrir", ajoute-t-il. Eurotunnel déplore également les "interminables vérifications" effectuées par la police du Kent lors du rapatriement des passagers évacués à Folkestone. La société souligne que les passagers bloqués le plus longuement sont sortis du tunnel un peu plus de cinq heures après la panne de leur train, "loin des 15 à 17 heures citées par certains commentateurs." Enfin, Eurotunnel souligne que toutes les opérations de secours ont été dirigées à partir de 0h40 par les Etats français et britannique. Gérard Bon
-
Actualités Politiques
Les lignes semblent commencer à bouger... Mais jusqu'où ? http://clementineautain.fr/2009/12/21/ense...ennes/#comments
-
Moi qui croyait qu'il n'y avait pas de pognon
Pourquoi j'ai rien eu moi... lotrela
-
etes vous sur facebook
Même chez soi il y a des caméras (webcam...) et des alarmes partout...
-
La SNCF s'explique dans une pub
Et ça c'est pas de la pub... Les tarifs du TGV augmenteraient de 1,9% en 2010 Reuters Les tarifs du TGV augmenteront de 1,9% en janvier 2010, davantage que l'inflation, croit savoir Le Figaro, citant une source anonyme proche du dossier. L'annonce devrait être fait courant janvier par la SNCF, qui avait augmenté les tarifs de 3,5% cette année et 2% en 2008. L'inflation a été de 0,4% entre novembre 2008 et novembre 2009 et l'inflation sous-jacente, hors éléments volatils comme l'énergie et l'alimentation, de 1,7%. La SNCF n'a pas souhaité commenter cette information du Figaro. Clément Guillou
-
Veolia lancerait ses TGV en 2012 avec Trenitalia
Petit rappel historique tout à fait d'actualité... http://canaille-le-rouge.over-blog.com/art...--41723466.html
-
338 SDF morts dans la rue en 2009
Et combien pour une autre et nouvelle politique que ce qu'on subit depuis disons 50 ans (1960) ... ? Et comme plus ça va, moins ça va... j'vous dis pas les jeunes pour l'avenir...
-
La SNCF s'explique dans une pub
Comme quoi une pub doit être positive... Enfin là c'est un communiqué officiel de la "DIRECTION SNCF"
-
Déraillement transilien à Choisy le Roi
Mise en examen du responsable présumé du déraillement d'un RER Reuters Un automobiliste soupçonné d'avoir causé, en état d'ivresse et sous l'emprise de drogue, le déraillement d'une rame de RER qui a fait 36 blessés et d'importants dégâts dimanche près de Paris, a été mis en examen, apprend-on au parquet de Créteil. Ce chômeur de nationalité française et âgé de 20 ans est poursuivi pour "blessures involontaires aggravées, défaut de maîtrise, délit de fuite, dégradations, usage de faux". Le parquet a demandé son placement en détention provisoire. Un juge des libertés devait trancher dans la soirée de mercredi. La SNCF a porté plainte contre lui. En percutant au volant de son véhicule le parapet d'un pont enjambant les rails au niveau de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), il a provoqué la chute d'un bloc de béton qui a fait dérailler les rames du RER C. L'accident a fait 36 blessés légers parmi les passagers et a contraint la SNCF à interrompre le trafic au départ de la gare d'Austerlitz lundi et mardi. Le préjudice de la compagnie nationale est évalué par le parquet de Créteil à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec deux rames hors d'usage, plusieurs kilomètres de câbles arrachés, des pylônes détruits et un important manque à gagner en terme de recettes d'exploitation. TRAFIC RER TOUJOURS PERTURBÉ Le conducteur était en état d'ébriété, avec un taux de 1,18 gramme par litre de sang, et avait pris de la cocaïne et du cannabis dimanche soir, selon les analyses réalisées pendant sa garde à vue. Il a quitté les lieux après l'accident et circulait avec un faux certificat d'assurance. Le parquet retient contre lui les circonstances aggravantes de "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique", l'infraction distincte de "conduite sous l'emprise de stupéfiants", et également le délit de fuite après l'accident. Pendant sa garde à vue, l'homme a dit aux policiers ne pas être directement responsable de l'accident, assurant qu'il avait été heurté par l'arrière. Il dit être parti sans réaliser les conséquences et avoir bu après coup, pour se remettre. "Les constatations matérielles infirment cette version des faits, car il n'a été relevé aucune trace de choc sur son véhicule et aucune trace de freinage", explique-t-on au parquet de Créteil. Des témoins disent que l'homme n'a pas souhaité appeler les pompiers après l'accident. Mercredi, le service grandes lignes était rétabli au départ d'Austerlitz mais, pour les RER, on ne comptait que quatre trains par heure pendant les heures de pointe. Le trafic était nul entre 10h00 et 16h00 pour permettre la poursuite des travaux de réparation nécessaires. "La situation ne peut aller qu'en s'améliorant dans les jours qui viennent mais il est très difficile de dire quand le trafic reviendra à la normale", a dit un porte-parole de la SNCF. Pour l'heure, pour des raisons techniques, les RER ne s'arrêtent pas entre le centre de Paris et la gare de Juvisy. L'Elysée a annoncé que Nicolas Sarkozy remettrait jeudi la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement à trois conducteurs du RER C afin de "rendre hommage au courage de ces conducteurs qui ont, avec sang froid et professionnalisme, su éviter que cet accident mette en danger des vies humaines". Environ 400.000 personnes empruntent chaque jour la ligne C. Service France, édité par Gilles Trequesser
-
Réforme du régime des retraites
Et je te parle pas du rappel de pension sur 9 mois que je viens de recevoir vu que la Caisse des Retraites vient de vérifier ma situation suite à la nouvelle législation sur les retraites à la SNCF... 7 euros 43 centimes ... Je rêve... lotrela
-
Déraillement transilien à Choisy le Roi
Je vois déjà la défense de l'avocat désigné d'office du "délinquant routier"... "a qui appartenait ce pont dont le parapet certainement ancien, vieux et usagé est tombé sur la voie du simple fait d'un petit choc d'une l'automobile dû au verglas qui quelque soit l'état de mon client... je demande la désignation d'un expert indépendant..."