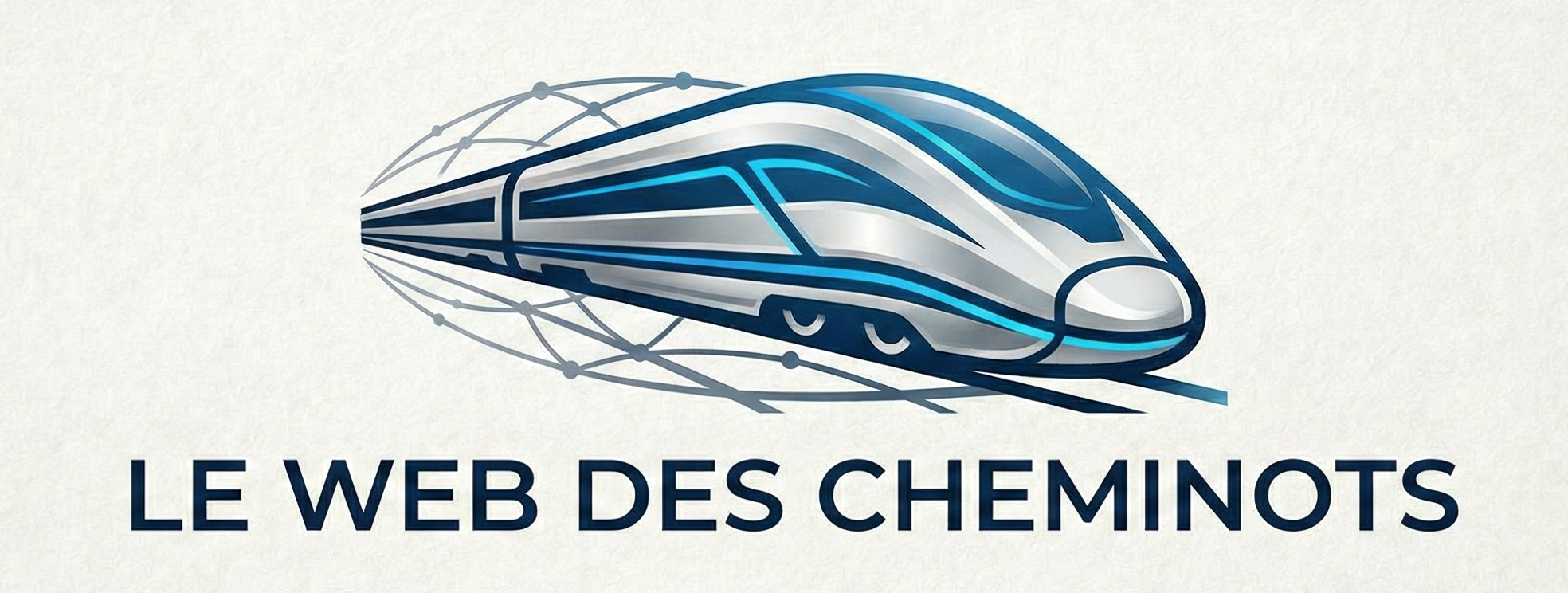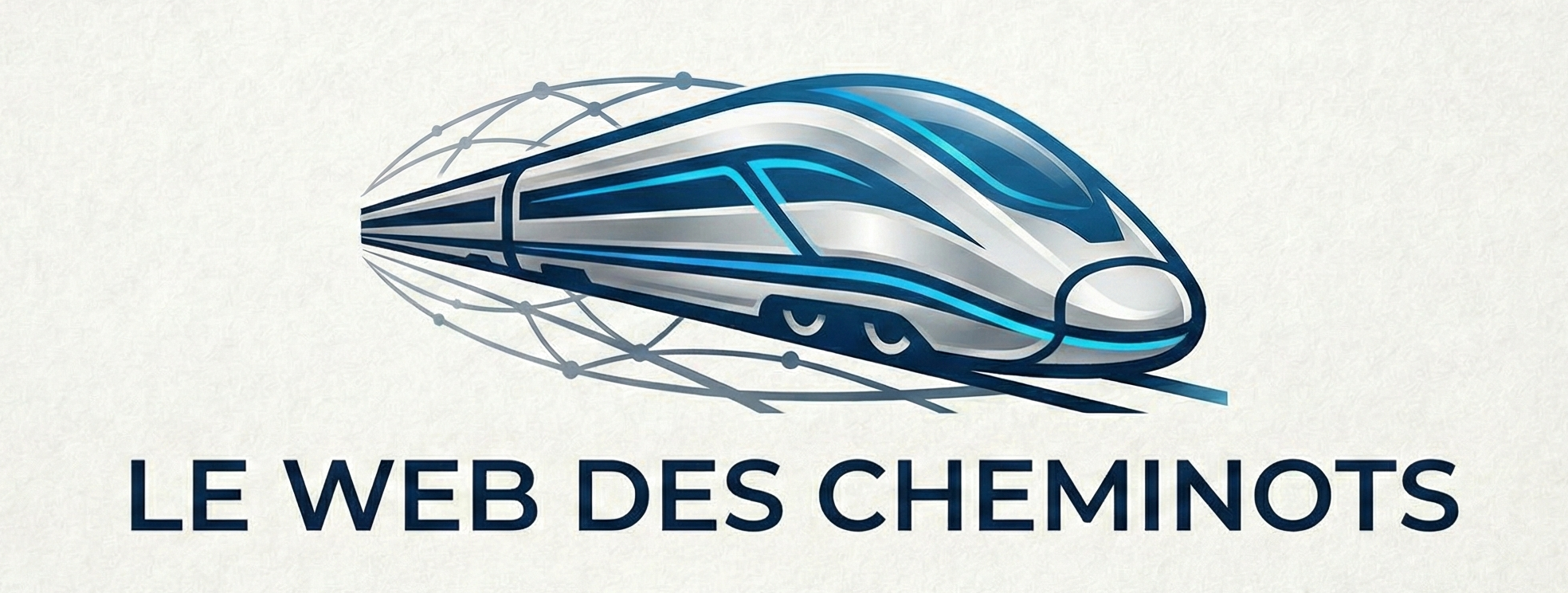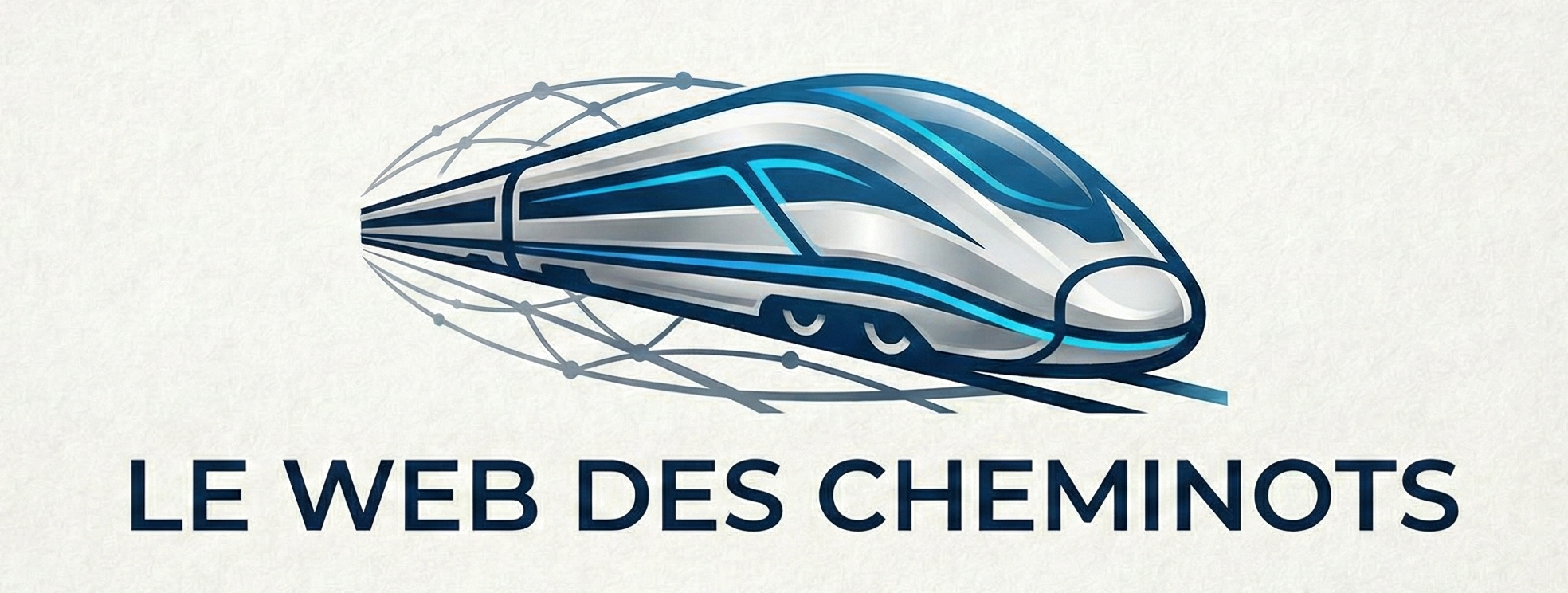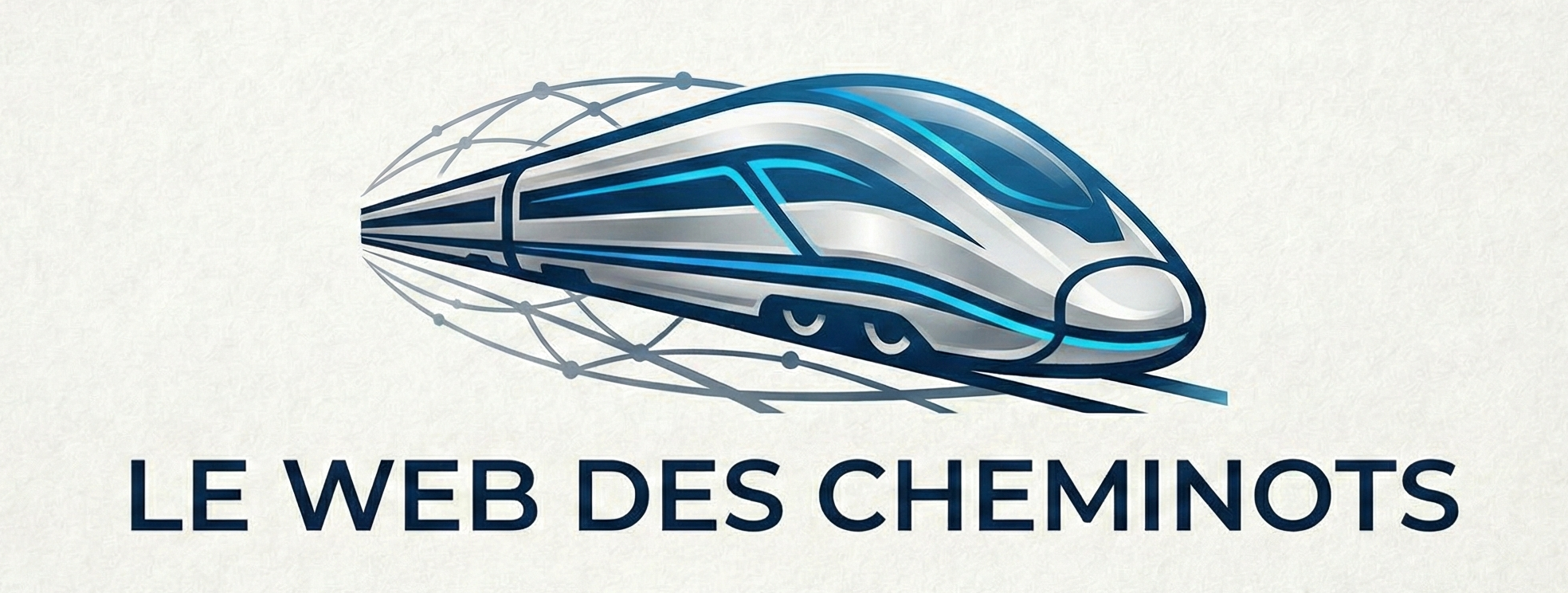Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
L’avenir du TER : des transferts sur route ? Avis de la FNAUT
C'est un peu facile de ré-écrire l'histoire. Que ces relations transversales aient été peu portées par la maison GL à partir de la fin des années 80 est une chose, affirmer que la desserte faisait le plein et tenait la route économiquement en est une autre, qui ne correspond pas à la réalité des années 90-2000 (le développement des axes routiers et la fin de la conscription y furent pour beaucoup). Ces relations étaient bien remplies en fin de semaine, et sur certaines parties du parcours. Les relations TGV Strasbourg-Lille ont été portées par quelques personnes (non majoritaires à GL) convaincues du bien fondé du développement des relations TGV Province-Province. La poursuite de l'augmentation des péages, celle des coûts internes de l'activité et la volonté de recentrer l'offre TGV sur le "coeur du réseau" en privilégiant les radiales à fort trafic ont fait que la relation Strasbourg-Lille s'est trouvée dans le collimateur peu de temps après son démarrage, d'autant que contrairement à ses homologues de/vers l'Atlantique, le trafic a peiné à monter en puissance (ce fut assez lent et resta en deça des espérances). Les gares nouvelles du TGV Est restant trop peu connues et valorisées (sans parler de l'absence de connexion ferroviaire à Louvigny), c'est surtout Strasbourg et dans une moindre mesure Champagne-Ardenne TGV qui alimente le trafic des intersecteurs du TGV Est. Sur Est-Atlantique, l'offre a été rationnalisée, les 3 A/R de/vers l'Ouest passant à deux (avec un montage en bi-tranche Nantes/Rennes) et les 3 A/R Strasbourg-Bordeaux passant eux aussi en bi-tranche avec des Lille-Bordeaux (pas terrible la robustesse du montage, dans le sens descendant...), l'équilibre économique d'un Strasbourg-Bordeaux assuré en US s'avérant hors d'atteinte, dans le contexte d'aujourd'hui...
-
Service Annuel 2012 [Sujet Officiel]
C'est la triste conséquence de l'évolution de l'organisation de la maintenance de l'infrastructure sur Tours-Bordeaux et du démarrage des travaux des nombreux raccordements de la LGV SEA, organisés à la sauce actuelle. Les coupures de l'infra explosent, avec un débit très fortement réduit de nuit et des coupures simultanées (i.e. des deux voies) plus d'une trentaine de nuits de week-ends par an, s'ajoutant au maintien du blanc-travaux de 1h50 de jour sur cet axe, du lundi au vendredi. Le hors d'oeuvre est pour 2012, une exploitation en quasi-voie unique étant envisagée de nuit à partir de 2013, avec en parallèle une louche d'une quinzaine de minutes permanentes de provisions additionnelles pour travaux dans les marches TGV Paris-Bordeaux... La Palombe bleue est la principale victime en trafic voyageurs mais les conséquences sur l'offre TGV et TER sont également importantes (positionnements horaires moins satisfaisants, densification du graphique de jour [donc fragilité plus importante de l'exploitation]. Le Talgo Paris-Madrid va subir également cette "évolution" de l'organisation des travaux sur l'axe. Le basculement via Toulouse de la Palombe avec un horaire très dégradé n'est donc en rien un choix délibéré pour tuer la relation (même si le résultat sera sans doute le même) mais le résultat du fonctionnement actuel du système ferroviaire en France et de l'arbitrage pris au niveau du ministère, la priorité ayant été donné à la réalisation des travaux, RFF et l'Etat étant contractuellement engagés vis à vis du concessionnaire retenu pour la réalisation de la LGV SEA. L'état dégradé de la voie sur plusieurs parties du parcours, constatée depuis plusieurs années (des abaissements de longue durée à 160 ont été appliqués depuis 2009) a également poussé dans ce sens, même si à court terme, il n'est pas prévu de rétablir la vitesse nominale sur l'ensemble du parcours.
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Salut, les marches du RER D sont tracées à 5% de mr (comme l'ensemble des RER SNCF), plus que 5% quand de la domestication est nécessaire pour le montage du graphique. Simplement, les montages initiaux sont effectués avec l'outil informatique CHAO, adapté (bien que vieillissant et pas parfait, il va être prochainement remplacé) au contexte dense de l'IdF (il permet du calcul plus fin et surtout la vérification du block et les contrôles des conflits). Ces montages horaires sont copiés ex abrupto (infomatiquement) dans THOR et de fait affichés en "non-calcul" (i.e. uniquement avec des données horaire, aucun calcul de marche n'étant relancé)... ce qui se traduit mécaniquement par un affichage 0/0 sur les données THOR (marges théorique et réelle). Sirius récupére ces données de manière indirecte, cela explique pourquoi la marge affichée est nulle sur ces sillons, à tort évidemment car il y a de la marge bien sûr (on voit de plus en plus des montages irréalistes sur certains sillons hors IdF [lié au mode de fonctionnement actuel de la production horaire et au manque/insuffisance de formation chez certains horairistes de fraîche date, s'ajoutant au caractère très "opérateur-dépendant" de THOR], mais rien de comparable, le principe de base demeure de tracer avec une marge bien sûr). Christian
-
Electrification en 25000 V
Le gros point faible du projet de modernisation/ré-électrification (Clermont) Béziers-Neussargues, c'était précisément la légèreté de son volet économique et dans une moindre mesure l'optimisme forcé de certains scénarios d'exploitation (j'ai lu -au moins en partie- les études citées... un avis nous étant alors demandé). Béziers-Neussargues (Clermont) n'est pas seulement handicapée par son profil en long (qui est à la fois dur et pas en V inversé : on a plusieurs successions de fortes rampes et fortes pentes), mais aussi par son tracé, élément qui joue aussi (défavorablement) dans la performance des sillons (les vitesses envisageables, surtout pour du fret, étant faibles) et les contraintes de masses admissibles. Imaginer faire transiter 40 voire 60 trains de fret par jour soit jusqu'à 12 Mt/an sur une voie unique de cette nature, même modernisée tient de l'utopie pure et simple. Ce n'est pas le Lötschberg avant doublement, Clermont-Béziers par les Causses ! Le parcours suisse d'antant était du petit lait en comparaison (et nos voisins ont investi massivement pour ne plus envoyer leurs convois de Fret par la ligne sommitale aux rampes plus faibles et bien plus courte...). Le POLT est sous-utilisé et présente des caractéristiques géométriques comme de vitesse bien plus favorables. Si le trafic Fret avait augmenté dans les proportions évoquées (par les politques) du temps de Gayssot (on nous a demandé d'étudier des scénarios à 120 Gtk voire 150, à l'époque... personne n'y croyait évidemment), la solution en attendant le CNM et Montpellier-Perpignan passait par un accroissement du transit via LImoges, si nécessaire en rajoutant des évitements circulation et en renforçant ponctuellement les IFTE, le block étant déjà modernisé et les campagnes de RVB aujourd'hui bien engagés. Des investissements sans commune mesure avec une modernisation lourde + ré/électrification Clermont-Béziers. Cette ligne (des Causses) est magnifique et comme tout bon ferroviphile, je vois son avenir avec inquiétude. Mais tenter de faire croire qu'un projet de cette nature était réaliste sur le plan économique et socio-économique, ce n'est pas très sérieux de la part des commanditaires de tels scénarios. Même en supposant la question du financement réglée (on voit ce qu'il en a été... même si les changements de majorité n'ont rien arrangé), il aurait fallu subventionner également massivement l'exploitation, pour que les EF Fret s'aventurent (significativement) sur l'infra modernisée, compte tenu des coûts d'exploitation nettement plus élevés. De quoi à donner de nouveaux arguments au sieur Prud'homme (Rémy, pas André bien sûr) évoqué dans un autre fil. Christian
-
trains electriques
Salut, Faibles en comparaison des tensions caténaires-sol. Ponctuellement, des situations comme celles que tu décris peuvent exister, effectivement. Autre illustration : les CdV à ITE (impulsions de tension élevée) fonctionnent (comme leur nom l'indique) avec des tensions crète de plusieurs dizaines de volts sjmsb (plus près de 100 que de 50 V il me semble)... mais dans ce dernier cas, les intensités débitées sont faibles.
-
[BB 36000 / 36200 / 36300] Sujet Officiel
C'est un peu plus compliqué que cela mais tu as raison de souligner que la présentation faite par seb700 ne correspond pas -sur ce point- à l'historique des faits. Les relations avec Trenitalia (en fait le groupe FS) étaient déjà difficiles avant l'entrée de la SNCF dans le capital de NTV mais cette décision (voulue par M. Faugère et G. Pépy avec l'aval de la tutelle gouvernementale, craignant que la DB ne conclut l'affaire avec la future EF privée italienne...) a été considérée comme une décaration de guerre ouverte par les FS. La situation au quotidien est dès lors devenue inextricable et Artesia n'avait plus d'avenir en tant que coopération EF SNCF-Trenitalia. Les difficultés rencontrées aujourd'hui (par les filiales de l'EF SNCF que sont SFI et SVI) avec RFI ont en fait la même cause, même si personne ne l'avouera officiellement, bien entendu. Christian d'Artesia
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Pour la zone de Dijon Ville, plus que le KVB (dont les inconvénients sont connus en matière de fluidité de l'exploitation (*)), c'est l'évolution de la signalisation qui pose question, avec cette approche parapluie généralisée qui conduit à multiplier les rouges cli (cf. nos discussions sur ce sujet il y a plusieurs mois). Le facteur aggravant pour Dijon Ville est la l'amplification du phénomène dans le sens pair, vu que deux signaux successifs ont vu leur avertissement remplacé par un S cli. Et plus récemment, on a fait de même à Besançon Viotte, où un S cli devrait être présenté dans le sens impair pour accéder aux voies D et E (de mémoire), pour cause de distance de glissement jugée insuffisante. Dans les faits, les voies demeureront accessibles à 30 très en amont du point protégé et la couverture KVB (non prise en compte puisque le système n'est pas "de sécurité") intégrale avec le pénalisant 000. On applique donc une double peine aux circulations, ici encore.... RFF a avalisé la modif, à ma connaissance. Les marches devraient être modifiées en conséquence... Rien n'est acté à ce jour pour Genlis-Villers les Pots. Christian (*) sauf à faire évoluer en profondeur le KVB (ce qui est peu probable dans le contexte d'aujourd'hui), le remède au très pénalisant et critiquable 000, c'est la mise en place du KVBP ou a minima de balises de réouverture (dont on a abandonné le principe dans les années 90, encore une fois en prétextant le risque d'une utilisation détournée du dispositif, comme pour la possibilité -à l'image du ZUB suisse- de lever partiellement le contrôle de vitesse, dans certaines conditions, à l'approche du signal abordé à vitesse réduite) dans les zones denses. Il est en effet ubuesque de voir les trains partir à vitesse d'escagot sur des signaux ouverts. Heureusement que le ridicule ne tue pas !
-
[BB 36000 / 36200 / 36300] Sujet Officiel
Salut, de mémoire, l'essentiel des essais pour valider la circulation à 200 a quand même été réalisé à l'époque car il fallait s'assurer que l'engin était conforme au cahier des charges auquel devait répondre le constructeur, qui prévoyait notamment la possibilité de circuler à 200 en tête de convois voyageurs. Qu'ensuite tout n'ait pas été mené jusqu'à son terme pour finaliser l'homologation des locs après les modifications intervenues au fil des années, c'est plus que probable. Mais il y eut bien des essais V200 sur Le Mans-Nantes au cours des années 90 sjmsb. Christian
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Salut, à ma connaissance, il n'est pas prévu de modifier les caractéristiques des engins utilisés pour le tracé des sillons sur le RER D, il est donc peu probable que les marches évoluent autrement qu'à la marge. La qualité de l'exploitation devrait quand même progresser, vu du voyageur donc c'est en soi une évolution positive. Christian
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Salut Frédéric, le relèvement à 200/220 nécessiterait un aménagement de la signalisation (adjonction de l'indication VL cli, modifications du KVB, éventuellement certains redécoupages de cantons), et un renforcement (léger) de l'alimentation électrique, en plus du remplacement des deux appareils de voie évoqués précédemment. La géométrie du tracé pourait (de mémoire) être conservée (celle de la voie serait probablement à améliorer mais c'est habituel dans ce type d'opération, les normes étant plus sévères pour cette game de vitesses). Pour les éventuels PN à supprimer, il y en a quelques uns me semble t-il (les Dijonnais du forum pourront confirmer et préciser... Tram21 en particulier), mais pas un nombre considérable c'est certain (le tronçon est court et la zone peu urbanisée). Pour ce qui est du gain de temps, il serait modeste évidemment (à la grosse je dirais une bonne min pour les TGV rejoignant/quittant la LGV), mais la prolongation de la branche Est de ce côté ne ferait gagner que deux minutes, pour un investissement bien supérieur, qui n'aurait de sens économique qu'avec une cohabitation difficile des différents trafics voyageurs et (aujourd'hui peu nombreux) fret entre Genlis et Villers les Pots... Christian eeg
-
[BB 36000 / 36200 / 36300] Sujet Officiel
Les compos sont jolies et les photos réussies, merci de nous les faire partager ! Corail TEOZ avait projeté un temps d'utiliser des 36000 sur Marseille-Bordeaux au SA 2012 (mais à ma connaissance, le projet n'avait pas dépassé la pré-étude côté activité). Christian PS : Artesia n'existera plus au service 2012... Si on a traîné des pieds pendant des années avant d'engager ces engins performants en les proposant désormais (moyennant location) à une EF concurrente, ce serait tout de même fort de café !!! pascontent
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Franchement, je n'ai jamais entendu ou vu rapporté -de source sûre- de tels propos de la part d'un dirigeant de la grande maison. Qui plus est, ce type de discours n'aurait guère de sens vis à vis de l'externe (incompréhensible et contre-productif). Je suis toujours surpris de la tournure que prennent les échanges sur les sujets touchant à la conduite. Nulle part, il n'est fait l'apologie des comportements limites ou à risques, auxquels les critiques font systématiquement référence pour justifier le maintien du statu-quo. Dans le cas présent, il était juste évoqué le fait qu'en améliorant le fonctionnement du freinage des Z2N du RER D, on contribuerait un peu à l'amélioration de l'exploitation, notamment via une meilleure tenue des marches (il est clair qu'on n'en fera pas des MI2N sur le plan du freinage). Le critère du taux de décélération est essentiel dans la conception des horaires pour les missions à arrêts fréquents. L'approche adoptée pour le calcul de marche (servant à établir les graphiques de circulation) est simplifiée (donc pas idéale dans l'absolu) mais renvoie à ce type de considération. Il faut trouver le paramétrage aussi réaliste que possible tenant compte des performances potentielles des matériels et des comportements constatés des convois (les deux n'allant pas toujours de pair). Sans viser des entrées à quai (court) à 80 km/h, on constate aujourd'hui de gros écarts entre convois, sur une même ligne et un même arrêt. A Issy Val de Seine par exemple sur le RER C, certains trains entrent en gare à 60 km/h (sur signal de sortie ouvert ou à l'avertissement) i.e. à VL de ligne dans cette zone, mais une partie d'entre eux sont plutôt à 40, certains à moins, avec tous types de matériels (par nécessairement les "vieilles" Z5600 ou 8800). Ces derniers sont pratiquement toujours en retard d'une à deux minutes car Ils pratiquent en général également le lissage des vitesses. A Haussmann St Lazare, la "crainte" du 000 présenté trop tôt conduit à des entrées escargot à quai, alors que le KVB permettrait d'aborder le quai à 50 ou même 60 (freinage engagé) sans prise en charge, vu le matériel utilisé. On constate de même des écarts de comportements importants sur les approches de carrés avec 000 (à convoi bon freineur identique). Idem pour les réceptions sur voies en impasse (qu'on peut apparenter à la catégorie précédente, sous converture KVB : comparer PSL groupes II et III et HSL par exemple : les Z 6400 font des entrées bien plus performantes en comparaison... question de formation sans doute). Il y a donc objectivement des marges de progrès intrinsèques qui ne remettent pas en cause la sécurité du système ferroviaire. L'amélioration des équipements peut y contribuer en parallèle (si les financements sont au rendez-vous). S'agissant des règles de conduite, personne ne suggère ici de ne pas les appliquer (ou alors je regarde les "mauvais" topics ... joke !). Cette évidence rappelée, il n'est pas interdit d'avoir l'esprit critique (devant son clavier s'entend) et ouvert, i.e. de regarder comment le cdf fonctionne ailleurs et comment il fonctionnait avant dans la boutique (la majorité des mécanos n'étaient pas des "Fangio" du rail, c'était des personnes sérieuses et responsables, idem pour les collègues RATP ou CFF par exemple). Si l'on prend l'exemple caractéristique de la VISA, c'est un concept qui est parti d'un constat incontestable de certaines dérives isolées de comportement pour au final promouvoir un comportement généralisé quasi-réflexe et uniformisé des conducteurs, i.e. tenant peu compte du contexte (les performances de freinage du matériel, la configuration de la ligne rencontrée, les conditions d'exploitation à l'instant t [le rail est sec ou humide, c'est la période des feuilles mortes ou non etc.]), sans prendre la peine de regarder les conséquences induites d'un tel lissage par le bas des comportements au niveau de l'exploitation. Pour les trains mauvais freineurs ou dans des conditions spécifiques, oui la démarche préconisée est parfaitement adaptée. Elle devient totalement contre-productive dans d'autres contextes, et heureusement tous les mécanos n'appliquent pas de manière "simpliste" cette règle de conduite (un cas typique que je connais bien : canton long [2500 m] sur ligne à VL90 et profil en long très changeant, avec sectionnement au milieu et en cuvette : si tu décélères en amont de l'avertissement, c'est le plantage assuré sous la section neutre avec un autom long... alors que le carré annoncé fermé est situé loin devant - autre exemple évident : les trams-trains : engager une séquence de freinage d'un ralent 30 à 2 km en amont du point but (signal d'annonce) est totalement injustifié vu les performances élevées de freinage du matériel, idem pour la VL<30 à 200 m du signal [un TT s'arrête en moins de 35 m à cette vitesse, temps de mise en action du frein comprise !). Donc pour répondre à NATman sur ce point, ne pas respecter à lettre la VISA (ce n'est nullement une sugggestion ou incitation de ma part, que les choses soient bien claires !) ne conduit pas nécessairement à mettre en danger autrui, ce que tu sous-entendais dans ta remarque... Une fois encore, vos précédesseurs ou les "anciens" encore en activité qui ont connu l'époque sans VISA pourront en témoigner (une conduite efficace et intelligente n'est pas dangereuse si elle est pro et adaptée au contexte). La généralisation des gestes réflexes en dehors des situations particulières notamment liées à l'urgence (la fermeture d'un signal devant le train par exemple ou son équivelent sous TVM etc.) tend à faire des mécanos des presse-boutons.... tout en dégradant le fonctionnement du système. Il ne faut pas s'étonner ensuite que la seule perspective qui paraisse envisageable pour retrouver un fonctionnement plus efficace, sans dégrader la sécurité, soit le recours accru aux automatismes (on y viendra vu que revenir sur certains dogmes de création récente est jugé irréaliste). Et c'est autant d'argument venant à l'appui du discours (contestable) parfois entendu dans les sphères dirigeantes, sur les mécanos "trop (bien) payés".
-
[LN7 - LGV Rhin - Rhône] Sujet Officiel
Merci à Thalys75 et joss pour les photos. Sur une LGV tout juste terminée, il est heureux que le comportement en voie d'un matériel de qualité (sur ce plan en particulier) soit bon. Je n'ai pas (encore) circulé en vitesse sur la LGV RR mais je me souviens avoir eu la même impression que vous sur la LGV Rh-A puis Méd. Sur la LGV Est, la pose de la voie comme la réalisation de la plate-forme n'a pas été d'égale qualité sur l'ensemble de la ligne. Pour ce qui concerne le racc de Villers les Pots, outre la réalisation récente des installations, il y a à mon avis une explication au ressenti très favorable. Lors de la conception de la branche Est, RFF a accepté la requête SNCF de réserver sur le plan géométrique l'implantation possible d'adv à tengente 1/65 (*), dans la perspective d'un éventuel relèvement de vitesse à 220 entre Perrigny (exclu) et Villers les Pots (aménagement qui aurait un intéret si la partie bourgignonne de la seconde phase de la branche Est n'était pas réalisée... ce qui demeure plus que plausible vu le ratio actuel coût/temps gagné... même si c'est sur le plan politique qu'un tel choix serait délicat à avaliser, si la partie alsacienne [la plus intéressante des deux] était elle réalisée). Le tracé du racc est donc très doux dans ce secteur, avec comme corrolaire une insuffisance de dévers assez faible, même à 172 km/h. Christian (*) les adv posés sont à tg 1/29, adaptés à des bifs à 160 (pour des communications entre voies, il faut du 1/46 [autorisant 170], plus coûteux car plus long)
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Salut, CRL COOL, je n'ai nullement préconisé des comportements "à la Fangio" (relis mon message). Je rappelle que le KVB est paramétré sur les automoteurs sur la base du l'état dégradé maximal (des équipements de frein) n'entraînant pas de restriction de vitesse. De ce fait et aussi du fait de son mode de fonctionnement intrinsèque, il n'est pas transparent pour la conduite. Le rendre plus proche de ce que permet réellement le matériel est donc profitable à tous (exploitants et voyageurs), tant qu'on en fait un usage approprié. Pour Rigolo, logique du parapluie et principe de précaution érigé en dogme aidant, on tend aujourd'hui à confondre volontairement le principe (sain) de la Vbut au point but (ou à l'approche du point but) avec celle du freinage "au plus tard". Seule la dernière est dangereuse et critiquable dans les faits. Au contraire, la première caractérisait à une époque pas si lointaine un "bon" conducteur (sa hierarchie dixit)... et demeure toujours en vigueur sur les réseaux qui sont restés attachés à une exploitation efficace. Illustration anecdotique : la semaine dernière, j'ai emprunté un Thalys de Bruxelles à Paris et le conducteur (45 ans à vue de nez) réalisa une très bonne marche, sans à-coup et ne reccourant pratiquement qu'au seul frein électrique. Il roula au trait (nous étions en retard au départ de Bruxelles) et ajusta bien ses freinages comme sa Vbut sur l'ensemble du parcours.... ce qui lui permit (les conditions de circulation aidant) d'arriver à l'heure à PNO (avec même une toute petite avance, l'entrée étant très performante [compte tenu de ce que permet le KVB]... et souple). Comme quoi, il ne faut pas desespérer en la matière... Christian
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
??? Sur les trains à arrêts fréquents, améliorer la séquence de freinage (comme celle de démarrage, avec d'autres moyens) n'a rien d'anecdotique sur l'ensemble d'une mission. Un court séjour chez nos voisins suisses ou allemands, ou même à la RATP suffit pour s'en convaincre. S'agissant des signaux d'arrêt, la transformation en Z2N "renforcées freinage" devrait permettre (si c'est réellement le cas ici) d'augmenter la décélération garantie paramétrée dans le bord KVB. A la clé, une plus grande transparence au niveau de la conduite et la possibilité d'améliorer certaines séquences, sans pour autant mettre en danger l'exploitation bien évidemment (là encore, voir comment on exploite hors de la sphère SNCF d'aujourd'hui... c'est toujours instructif même si tout n'est pas transposable bien sûr). Christian
-
Electrification en 25000 V
Salut, Le livre (en deux tomes) auquel tu fais référence est effectivement une source précieuse et de grande qualité. Cela n'interdit pas pour autant toute lecture critique (que les auteurs ont -pour partie du moins- adoptée aussi) de certaines décisions historiques (je pense au choix du 1,5 kV comme système unique imposé par l'Etat aux compagnies au début des années 20 sjmsb, alors que des développements avaient déjà été réalisés sous des tensions supérieures, par le Midi notamment). Pour revenir à une histoire plus récente, le choix du 1,5 kV sur Bordeaux-Montauban, pour logique qu'il fut eu égard aux engins de traction du parc SNCF de l'époque (qui continuait à acquérir des locs et autom monocourants soit dit en passant), s'est traduit par la construction de 12 sous-stations alimentées en 63 kV (tension d'alimentation [classée HTB] de la majorité des sous-sta 25 kV du réseau classique). Le choix du 25 kV ou mieux du 2x25 kV (sous doute un peu tôt pour l'époque, mais plusieurs longs tronçons de la LGV SE en construction étaient déjà prévus dans cette configuration) n'aurait pas conduit à augmenter le coût des installations fixes, bien au contraire. Et les engins récents tels que les TGV A circuleraient avec des performances supérieures lorsqu'ils sont en UM (du moins on peut le supposer, car cela dépend du niveau d'équipement retenu). Sur Tours-Bordeaux, malgré tous les renforcements (coûteux) réalisés (on compte aujourd'hui pas moins de 31 sous-sta, alimentées par une ligne HTB 90 kV et la caténaire a été renforcée en moults endroits, avec un à deux feeders de gros calibre), les TGV demeurent bridés en puissance lorsqu'il circulent en UM (on a 6 MW à la jante... soit guère mieux qu'avec une 6500, sur une plage de vitesse plus grande il est vrai) et les incidents caténaires demeurent plus fréquents que sur Le Mans-Nantes parcourue à la même vitesse, le coût de la maintenance n'ayant également rien à voir. Sur le contournement de Tours, une UM Atlantique n'approche les 270 que dans le sens impair, du fait de l'entrée en vitesse (on est au mieux à 250/260 en aval du baissez-panto et ça ne fait que baisser par la suite). En sens inverse, on atteint péniblement 250 dans les mêmes conditions, à l'approche du changement de tension (du fait du bridage de puissance), grace au profil descendant. De la même manière, la montée en vitesse au départ du Mans (vers la LGV) est laborieuse en UM. Pour du trafic dense à courte distance, le recours au 1,5 kV avait sans doute du sens, même s'il n'avait pas que des avantages (je pense notamment aux effets des intensités élevés sous l'angle des courants vagabonds). Sur les distances plus importantes et surtout à des vitesses élevées, la lourde caténaire 1,5 kV n'est pas la panacée... ou alors on utilise un équipement allégé avec toutes les restrictions que cela induit sur les performances voire le débit (cf. la caténaire Midi, invention intelligente pour l'époque mais plus du tout adaptée aux engins actuels).
-
SNCF : Le rail que l’on présente comme un mode de transport moderne, est en fait une technologie ancienne et coûteuse.
Salut, j'ai hésité à mettre mon grain de sel dans ce fil, persuadé que c'était finalement attacher trop de considération à cette nouvelle provocation "prud'hommesque" (*), l'auteur de ces propos étant devenu coutumier du fait, dans la presse complaisante avec ce type d'"analyses". Très franchement, ton initiative (Technicentre) est plus que louable mais c'est peine perdue avec ce type de personnage. Je fus un de ses étudiants (dans les années 90), lorsqu'il professait à Paris XII (c'était l'un des deux "co-corresponsables" de l'ex-DEA Transport, son alter-ego [bcp plus recommandable et respectable] étant alors Michel Savy). Cette personne se targue de bien connaître le monde des transports mais sa connaissance réelle des trransports publics (au sens générique du terme tel qu'utilisé par l'UTP) est en fait assez limitée, ce ex-prof des universités ayant travaillé essentiellement pour des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou autour de recherches macro-économiques assez éloignées du monde des entreprises de TC. Sur le plan politique, c'est un libéral peu tempéré... mais qui adopte plutôt une approche keynésienne lorsqu'il s'agit de mettre en évidence l'apport du financement public du transport routier, notamment pour la construction des routes et autoroutes (on n'est pas à une contradiction près !). C'est un proche de Christian Gérondeau, célèbre héraut de l'Union routière, aujourd'hui familier de thèses plutôt à droite de la droite, invité régulier des émissions économiques (ultra-libérales) de Radio Courtoisie (la radio "de toutes les droites" [en fait surtout de l'extrême droite])... Au fil des années, le discours de ce ancien prof (plus tout jeune) devient de plus en plus pathétique, du fait de ses "analyses" outrancières et franchement peu crédibles (rien à voir avec les positions qu'il tenait lorsqu'il dirigeait le DEA, orientées mais quand même plus sérieuses). Il ne changera pas (plus) d'autant qu'il est convaincu que lui seul (et quelques ultra partageant ses positions) a une vue objective de la situation économique qu'il dénonce... Ce que je trouve beaucoup plus critiquable et même scandaleux dans cette affaire, c'est qu'un "laboratoire d'idées" (think tank en anglais) tel que l'IFRAP puisse se prévaloir d'une quelconque reconnaissance d'utilité publique (accordée par un gouvernement "ami", sans doute...). C'est proprement inadmissible, vu qu'on est dans la théorie politique, aussi respectable ou contestable soit elle (je tiendrais le même discours pour tout autre formation de cette nature, qu'elle soit d'orientation keynésienne, marxiste, colbertiste..). Les médias qui relaient les discours de l'IFRAP (Le Monde s'est illustré dans ce sens) sont dans un positionnement propagandiste (assumé ou ignoré [c'est encore plus lamentable dans ce cas car l'inculture du journaliste est alors patente]), pas dans l'analyse et l'information objective. Les propos de l'IFRAP sur la SNCF sont le plus souvent assez nauséabond, mais si on ne les trouvait que sur leur site ou chez quelques ultra (pour qui M. Thatcher et R. Reagan furent des "tièdes"), leurs effets négatifs seraient limités. C'est le fait de relayer cette prose dans les grands médias ou même sur internet qui donne une certaine légitimité à ce genre de discours et à l'IFRAP en général, ce qui est beaucoup plus grave. D'où ma réticence à "entretenir le buzz"... Pour en venir au fond du sujet abordé dans cette itw, hélas la dérive du système ferroviaire français, tant en termes de coûts (ceux touchant l'infra ont dérivé de manière effarante en 15 ans, comme en GB après l'éclatement des BR) que d'efficacité (le cdf britannique a pour partie corrigé le tir à l'inverse du nôtre) donnent du grain à moudre à ce type d'analyse à l'emporte pièce, expliquant que le mode ferroviaire est un puits sans fond, un tonneau des Danaïdes. Malgré cette réalité peu enthousiamante, si les journalistes qui interviewent ces prétendus experts avaient un tant soit peu de culture économique et des transports en général, il ne prendraient toutefois pas pour argent comptant ces affirmations pour le moins contestable dans leur présentation. Christian (*) à noter qu'un homonyme de ce triste personnage a au contraire contribué au développement technique de la voie ferrée... on lui doit un critère bien connu des spécialistes "V"
-
Electrification en 25000 V
Franois - St Amour fut mise sous tension en 1995 (tronc commun avec Dole-Vallorbe mis à part). Son profil est moins favorable que le passage par Dole et la Bresse (ou l'axe PLM) et les évitements de la partie en VU sont peu nombreux (même si le trafic écoulé est modeste), ce qui explique qu'elle soit peu utilisée par le fret. Le niveau de trafic actuel (fret) sur l'artère principale Mulhouse-Belfort-Dijon a de toute manière atteint un niveau bien bas, donc la perspective de voir l'artère du pied du Jura reconvertie dans le transit Fret n'est vraiment pas d'actualité. A la fin des années 90, dans le cadre du contrat de plan "Saône-Rhin" (mort-né) qui se voulait une compensation à la non-réalisation du canal RR à grand gabarit, il était prévu la mise au gabarit B1 de Besançon-Montbélard (pour le trafic combiné principalement), aujourd'hui renvoyée aux calendes grecques... Le 2x1,5 kV, ça consiste, à l'image du 2x25 kV, à alimenter les installations sous deux fois la tension caténaire-rail, soit 3 kV, via un feeder -1,5 kV et des postes de transformation intermédiaires permettant de "réinjecter" du courant entre les sous-sta. Ainsi les chutes de tensions diminuent (à la fois du fait de ces points "d'injection" supplémentaires et de part l'intensité moindre générée par le transport sous 3 kV). Ce type de configuration est rendu possible par la conversion statique du courant via des équipements d'électronique de puissance.
-
Electrification en 25000 V
Salut CRL, je n'ai pas d'infos quant à un projet précis sur le RFN mais ai juste connaissance, au travers de publications internes et RFF et de discussions avec des collègues de l'Ingénierie, que cette nouvelle possibilité technique intéresserait RFF (elle est moins lourde à mettre en oeuvre qu'une ré-électrification en 25 kV). Pour ce qui concerne Moret-Montargis, je n'ai rien lu de tel sur la compatibilité potentielle 25 kV (j'étais encore à l'école lorsque les études techniques ont été réalisées) mais peut être qu'un contributeur du forum pourra nous éclairer sur ce point. En mettant la main sur la RGCF traitant de cette électrification (il est peu probable qu'aucun article ne lui ait été consacré), on devrait également avoir la réponse. Ce qui est une certitude, c'est que le dimensionnement de ce tronçon (en fait jusqu'à la sous-sta mixte de Gripois, située bien au-delà du BV de Montargis) a été fait a minima, à une époque où le recours aux Z5300 était prévu pour la desserte IdF de Montargis et où le nombre de trains de voyageurs était inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. D'où le choix de sous-sta monogroupes (un seul transfo... non secouru donc et d'une puissance assez moyenne qui plus est) et des distances assez importantes entre celles-ci (pour ce type d'électrification), entre 15 et 20 km. Basculer en 25 kV en réutilisant une partie des sous-sta serait peut-être envisageable mais il faudra gérer la transition et sauf à exploiter un temps la ligne en traction diesel voire à arrêter les circulations temporairement (au vu des dispositions retenues aujourd'hui lors de gros travaux, on peut s'attendre à tout, jusqu'à la fermeture de la ligne plusieurs mois durant), ce qui s'annonce difficile dans les sous-sta existantes, assez exiguës de mémoire (à vérifier tout de même). Des études (a minima sommaires) ont été réalisées pour renforcer l'alimentation électrique de ce tronçon de ligne, mais elles n'ont pas débouché jusqu'à présent, vu que personne n'est près à payer (pas RFF qui se refugie derrière son article 4 et réclame un financement externe pour l'essentiel, ni le STIF [et donc les collectivités et l'Etat] -pour le moment- ni Intercités/TET (dont les dessertes sont au mieux à l'équilibre). Pour faire suite à la suggestion de dyonisos, je ne suis pas certain que le passage de 1,5 à 3 kV facilite l'exploitation vu de l'EF historique et des nouveaux entrants Fret utilisant des locs électriques, même si des modifications sont envisageables sur les chaînes de traction des certains engins moteurs. Cela reviendrait à créer un troisième type d'électrification sur le RFN (le tronçon Modane-frontière italienne appartient au RFN mais est exploité par RFI, avec des installations aux caractéristiques italiennes). Christian
-
Electrification en 25000 V
Salut, la reconversion des lignes 1,5 kV en 25 kV est une opération lourde et de longue haleine, à laquelle les NS ont renoncé (ou du moins différé à un horizon indéterminé) malgré un travail préparatoire conséquent, sur plusieurs lignes de leur réseau (avant la séparation EF/GI). A part dans quelques cas spécifiques, je crains que ce ne soit une chimère (en France), surtout quand on voit la perte d'efficacité importante dans l'organisation des travaux sur le RFN, vis à vis de l'exploitation ferroviaire (il faut 2 ou 3 fois plus de temps pour réaliser une opération élémentaire). La perspective d'une évolution vers le 2x1,5 kV me semble plus prometteuse, sur quelques lignes du réseau, avec les progrès importants de l'électronique de puissance. Christian
-
trains electriques
Salut à tous, Tram, tu n'as lu qu'en diagonale mon explication.... Bien sûr que les rails sont reliés à la terre, mais pas en tout point... car il faut privilégier le retour du courant de traction aux sous-sta par les rails de roulement (et limiter le retour par le sol). D'autre part, comme mentionné dans mon message, un dispositif de limitation de la tension rail-sol installé à demeure permet d'éviter tout risque de choc électrique au contact des dits rails. Christian
-
Italie : le privé Arenaways va mal...
Salut, la discussion (intéressante) sur les compos longues avec deux locs renvoie aux conditions d'exploitation différentes entre réseaux (au sens intérgré du terme) mais aussi à l'équipement de l'infrastructure et à la culture historique au sein des acteurs ferroviaires, puis l'évolution de leur organisation. En Suisse comme en Allemagne, le trafic est -cas de l'IdF mis à part- plus dense qu'en France et les arrêts plus fréquents, toutes choses égales par ailleurs. En Suisse, le profil en long de nombre de lignes importantes est également plus difficile, ce qui justifie le recours à des puissances massiques plus élevées. Il n'en demeure pas moins que passé l'expérience -hélas restée sans suite- des automotrices "de ramassage" sur Paris-Le Mans, l'approche française sur le RFN (je mets la RATP à part) a rarement privilégié les capacités d'accélération des matériels, y compris sur les axes denses, plus encore au niveau du tracé des marches (qui accentue encore ce phénomène en limitant les accélérations). L'équipement électrique du réseau avec le choix -discutable avec le recul- du 1,5 kV explique pour partie cette réalité mais on aurait pu faire nettement mieux tout de même. Depuis le milieu des années 90 et la séparation du système ferroviaire français, l'opérateur historique (EF+GID) se tire une balle dans le pied une balle dans le pied en appliquant des mesures parapluies ultra-restrictives qui conduisent à brider fortement la puissance des engins à motorisation répartie ou des locs en UM... ce qui arrange bien RFF en lui évitant d'investir sur son périmètre. Même les modestes 27000 (4200 kW en régime continu) sont bridées en UM sur le RFN sur les axes majeurs, y compris sous 25 kV (!). Le cas le plus hallucinant est celui des TER2N ng qui n'utilisent la totalité de la puissance disponible que jusqu'à 5/6 caisses, et encore pas sur toutes les lignes (au-delà, même sur le cran maximal de puissance, l'intensité appelée aux pantos est fortement limitée, d'autant plus que l'alimentation des auxiliaires réduit même la puissance disponible pour la traction en valeur absolue...). Sur le plan des performances, une Re460 (certes plus moderne sur le plan technique) peut s'apparenter à une 26000 (nos voisins suisses ont pour habitude de raisonner en puissance en régime unihoraire, pas en régime continu... celui des deux locs est assez proche en fait, de l'ordre de 5600 kW). Il est clair qu'avec des compos à 10 V et plus (je pense notamment aux TEOZ à 14 V), en particulier (mais pas uniquement) sur les lignes à VL200, on améliorerait nettement les montées en vitesse et la tenue de la VL, même avec un bridage partiel (à 4 MW par engin). Ce n'est aujourd'hui pas envisageable sur les infras actuelles, du moins sous 1,5 kV. Les rares cas de circulation en DT s'effectue à quasi- demi puissance. Les TGV de conception récente sont bridés à une puissance bien inférieure à celle des PSE sur nombre de lignes 1,5 kV, ces derniers étant eux soumis à des contraintes d'espacement (15 min derrière une UM, puis 20' etc.). Sous 25 kV, hormis sur quelques lignes de conception récente, la puissance en UM est le plus souvent bridée à 6,7 MW (pour le convoi).. Pour les successeurs des TER2Nng, le matériel retenu dans sa configuration longue affiche des performances garanties plus que modestes... ce qui une fois encore satisfera RFF (en lui évitant des renforcements d'IFTE) mais renverra aux calendes grecques toute perspective d'amélioration du débit et des performances sur des axes chargés tels que Marseille-Nice par exemple. L'ordonnancement des circulations peut s'effectuer de deux facons : soit en accélérant les trains à arrêts fréquents ou de Fret, soit en ralentissant les trains rapides (ceux avec peu d'arrêt en général, pour les voyageurs). La seconde approche est désormais trop souvent appliquée en France avec la montée en puissance de l'ordonnancement du graphique poussé par RFF, alors que l'expérience acquise chez certains de nos voisins devraient pousser dans ce sens (tirer vers le haut le système ferroviaire, plutôt que d'adopter la solution de faciliter consistant à s'aligner sur le moins disant). Christian
-
Retour du train sur la ligne Mulhouse- Müllheim
Salut, changer d'opérateur même pour une seule desserte TER nécessite de modifier la LOTI, donc un vote du Parlement (même pour une expérimentation). Si le CR d'Alsace n'a jamais caché ses intentions sur ce sujet, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de points majeurs doivent être clarifiés avant de confier l'exploitation à un opérateur non-SNCF (sauf offre assurée en coopération avec l'EF historique, qui relève d'une autre logique). Le fameux rapport "Grignon" (nom du parlementaire rapporteur du dit rapport) a formulé des propositions qui ne font pas l'unanimité parmi les candidats EFs potentiels et a suscité moult réserves de la part des régions à majorité de gauche (forcément... le projet étant porté par la majorité gouvernementale du bord opposé). Parmi les sujets délicats, il y a celui du transfert des contrats de travail pour les agents volontaires (les nouveaux entrants n'en veulent pas, ce qui ne surprendra personne), et des conditions dans lesquelles celui-ci s'opérera. Le gouvernement a, il me semble, renvoyé l'éventuel projet de loi (ou proposition de loi si émanant du Parlement) à l'horizon post-élection présidentielle.... Pour la région PACA, c'est quasi-exclusivement de la posture politique, surtout quand l'élu PC Gérard Piel avait la haute main sur le portefeuille des transports (ce qui n'est plus le cas aujourd'hui). En Languedoc-Roussillon, la probabilité d'un basculement partiel à moyen terme semble plus plausible qu'en PACA, surtout si les nouveaux entrants peuvent "bénéficier" d'un cadre social plus favorable, vu des employeurs s'entend (pas des salariés bien évidemment). Concernant la modernisation de Mulhouse-Mulheim, le titre du canard me paraît mal choisi car le trafic ferroviaire n'a pas été supprimé sur cette ligne, y compris le voyageurs (non régulier certes et soumis à des conditions restrictives de circulation ces dernières années). Les travaux prévus sont modestes et les contraintes d'insertion sur l'axe majeur de la rive droite du Rhin limiteront (au moins à court terme) les possibilités de liaisons directes, seules vraiment attractives pour relier Mulhouse à Fribourg (l'essentiel du trafic potentiel transfrontalier, modeste au demeurant). Christian
-
trains electriques
Vu les questions que tu poses, le mieux serait de parcourir un cours d'électricité (on en trouve en ligne sur internet, et dans toute les librairies à vocation scolaire ou universitaire), préalable à une bonne compréhension de la traction électrique ferroviaire. Le retour du courant de traction par le rail existe avec les deux types de courants, même si l'état électrique mesuré au niveau de la matière conductrice (i.e. vu des électrons, constituant de base du courant électrique) présente des caractéristiques différentes. Sur les lignes équipées de circuits de voie, les rails sont isolés l'un par rapport à l'autre et vis à vis du sol (sinon le circuit électrique ne rebouclerait pas avec le récepteur du CdV). En présence d'une alimentation (de traction) électrique, le retour par les rails à la sous-sta est toujours privilégié, même si on ne peut éviter qu'une partie du courant de retour (appelé "courant vagabond") revienne par le sol (l'isolation n'est pas parfaite et varie avec les conditions atmosphériques). Cela ne pose pas de problème dans le sens où les niveaux de tension rail-sol sont en général faibles et les extrémités du circuit sont elles reliées à la terre, au niveau des sous-stations en particulier. Dans ces dernières, des dispositifs de limitation de la tension rail-sol (appelés "intervalles de décharge") sont prévus à demeure. Si on laissait le courant de traction revenir "naturellement" par le sol, on générerait en quantité des effets électrolytiques accélérant la corrosion des ouvrages métalliques situés à proximité de la voie. Le retour du courant de traction s'effectue le plus souvent par les deux fils de rail (il n'y a que dans le cas de CdV monorails -proscrits sur les VU électrifiées pour des raisons de sécurité- que le retour n'utilise qu'une fil de rail). La quasi-totalité de la chute de tension (qui a pour corrolaire la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique dans les moteurs de traction -pour faire simple) est réalisée entre le(s) fil(s) de contact de la caténaire et l'extrémité du circuit électrique de la locomotive, reliée aux rails. C'est pour cette raison qu'hormis dans des situations très particulières, il n'y a pas de danger -de nature électrique- à toucher un rail de roulement (*) d'une voie ferrée. Christian (*) pour le rail latéral d'alimentation électrique quand celui-ci existe, il en va évidemment différemment. Pour cette raison, les alimentations par rail latéral sont très rares en secteur "ouvert" (i.e. en pleine campagne, sans interdiction d'accès aux installations ferroviaires).
-
trains electriques
Salut, On peut très bien être électrisé voire électrocuté en s'approchant d'un conducteur unique sous tension... il suffit que le corps ne soit pas bien isolé du sol (plus ou moins bon conducteur suivant sa nature et les conditions météo). Donc la question posée a du sens et la réponse moins simple qu'elle n'y paraît à première vue. Si toucher un rail de roulement ne présente pas de risque électrique pour les êtres vivants, c'est d'une part parce que celui-ci est relié aux sources d'alimentation (sur les lignes électrifiées) pour le retour du courant de traction et constitue un meilleur conducteur que le sol (qui contribue aussi au retour du courant), d'autre part du fait de la différence de potentiel faible avec le sol, lorsqu'un courant de traction circule en présence d'un train. Pour ce qui concerne l'alimentation des sous-stations du RFN, si le 400 kV (anciennement 380 kV) constitue l'armature de base du réseau de transport et d'alimentation (depuis les grosses centrales) des centres de répartition du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE est le "RFF" de l'électricité, c'est aujourd'hui une filiale d'EDF) en France, on trouve quelques sous-sta 225 kV sur le réseau classique, en général lorsque le secteur alimenté couvre soit une distance importante (sous-sta de Billy sur la ligne du Bourbonnais avec plus de 100 km sous 2x25 kV, i.e. sous 50 kV en sortie de transfo), soit une section de ligne au niveau de trafic très élevé (sous-sta de Pantin/Noisy par exemple sur l'est parisien). Sur LGV, le recours au 225 kV est la norme (le 63 ou 90 kV l'exception), vu les puissances appelées importantes, ce qui permet de limiter le déséquilibre induit entre les trois phases du RTE et aussi parce qu'il faut disposer d'une puissance de court-circuit élevée (la charge prélevée pour la circulation des train, qui peut être très importante sur de courtes durées, ne doit pas perturber le fonctionnement du réseau même dans le premier état dégradé fixé par le RTE). Il existe au moins une sous-sta alimentée en 400 kV sur le RFN, il s'agit de celle de la Picocherie, au sud de Vendôme sur la branche SO de la LGV A. De mémoire, sauf cas particuliers et de certaines sous-sta du réseau 1,5 kV, la majorité des sous-sta du RFN sont alimentées par le RTE (en 63 ou 90 kV le plus souvent, parfois moins pour le 1,5 kV, on trouve du 20 kV par exemple), pas par ERDF, filiale d'EDF chargée de la distribution de l'énergie électrique. Les textes européens prévoient pour les EFs la possibilité de choisir leur producteur d'énergie électrique, le marché ayant été libéralisé. Il n'y a donc pas d'obligation à se fournir chez EDF. A Cytrilon qui pose la question "Comment peut on faire passer un courant alternatif sur le seul fil de la caténaire? Ou se fait le retour en continu?", on peut préciser que celle-ci n'a pas de rapport avec le type de courant utilisé. Pour faire circuler du courant au travers d'une machine depuis une source, il faut en règle générale au moins deux fils... mais le retour du courant du courant peut s'effectuer par d'autres moyens qu'un fil électrique (cas des rails pour le chemin de fer). Pour On Sight, le réseau d'alimentation triphasé du RTE et d'ERDF n'a que trois fils par circuit (il n'y a pas de neutre sur ce type de réseau). Christian