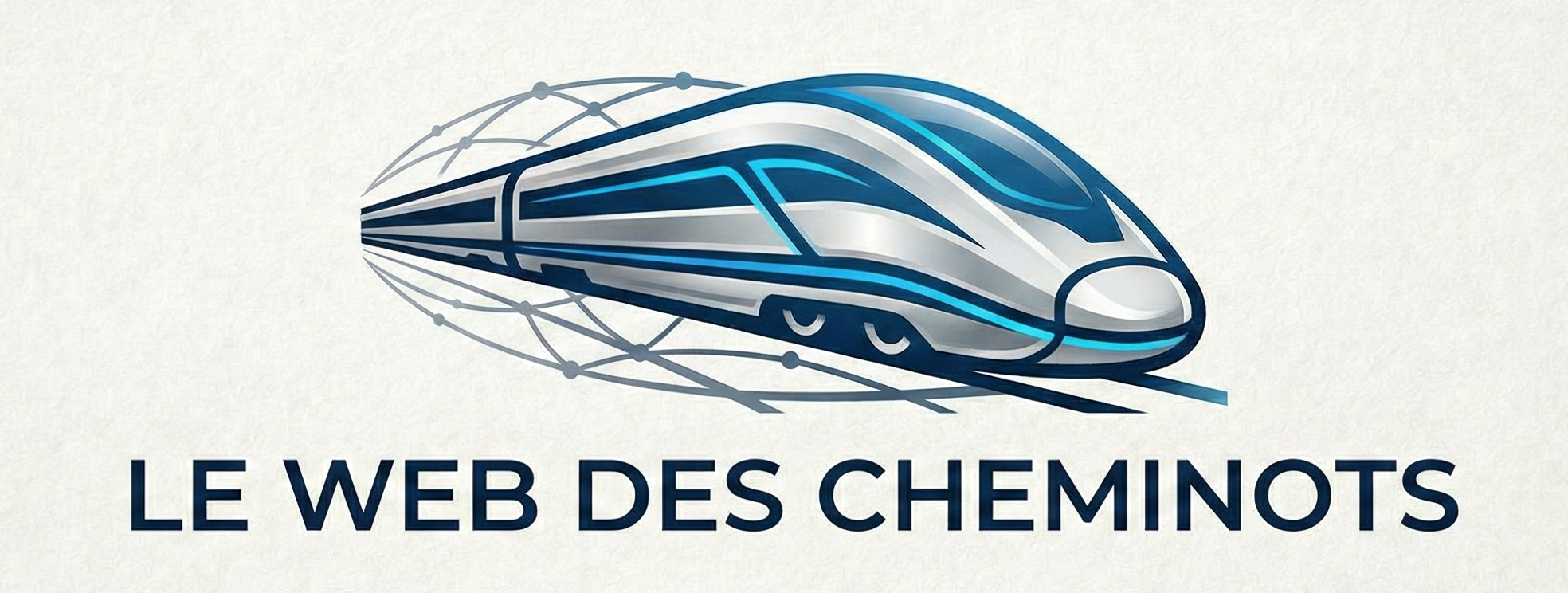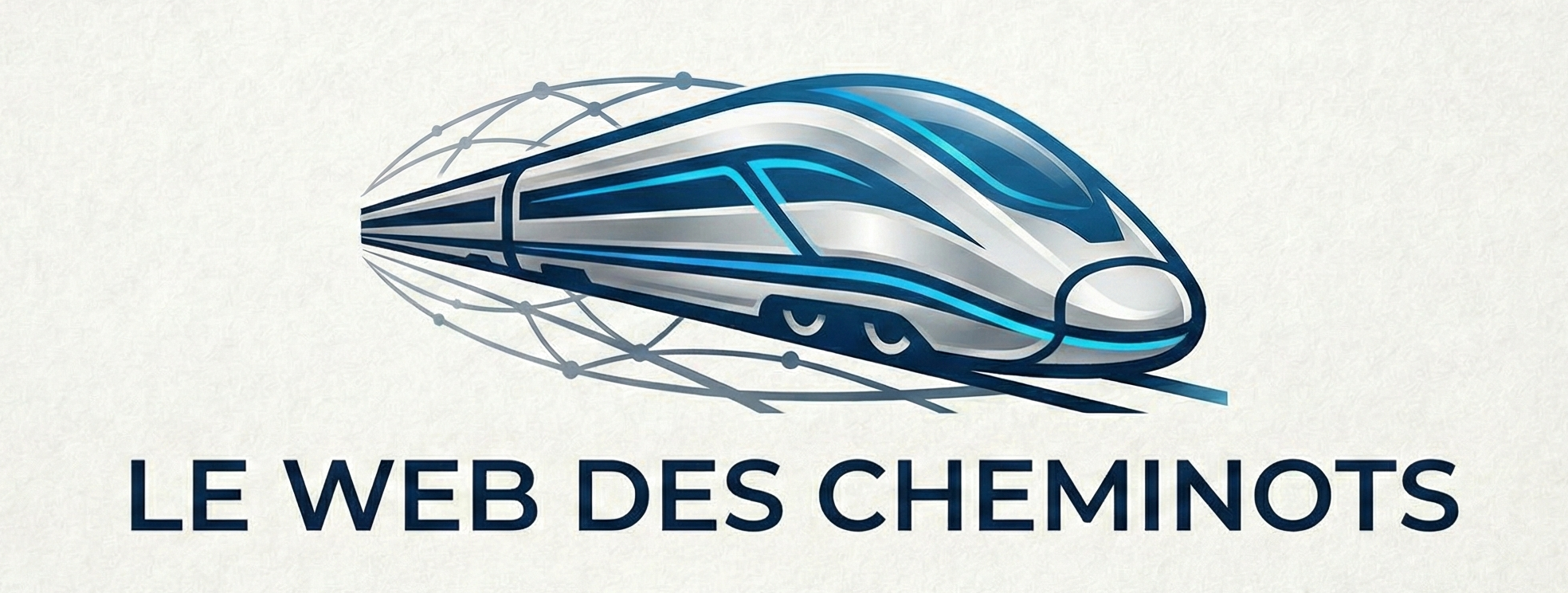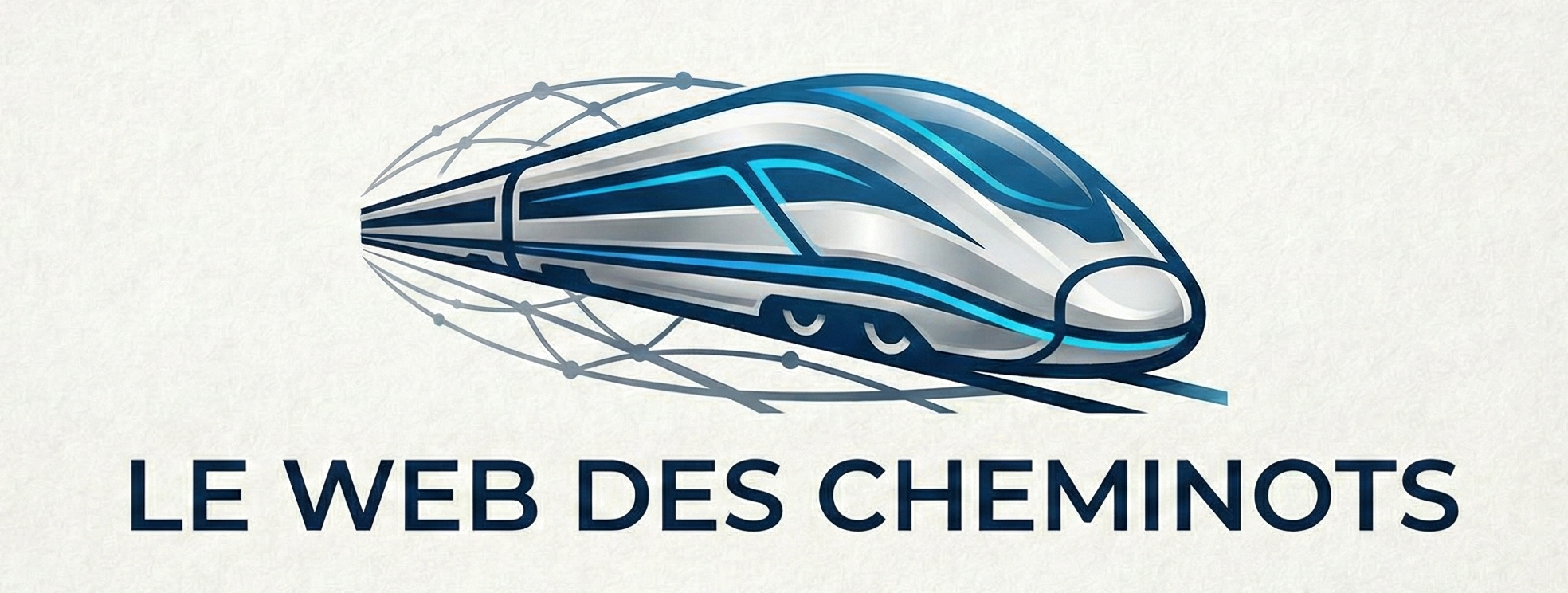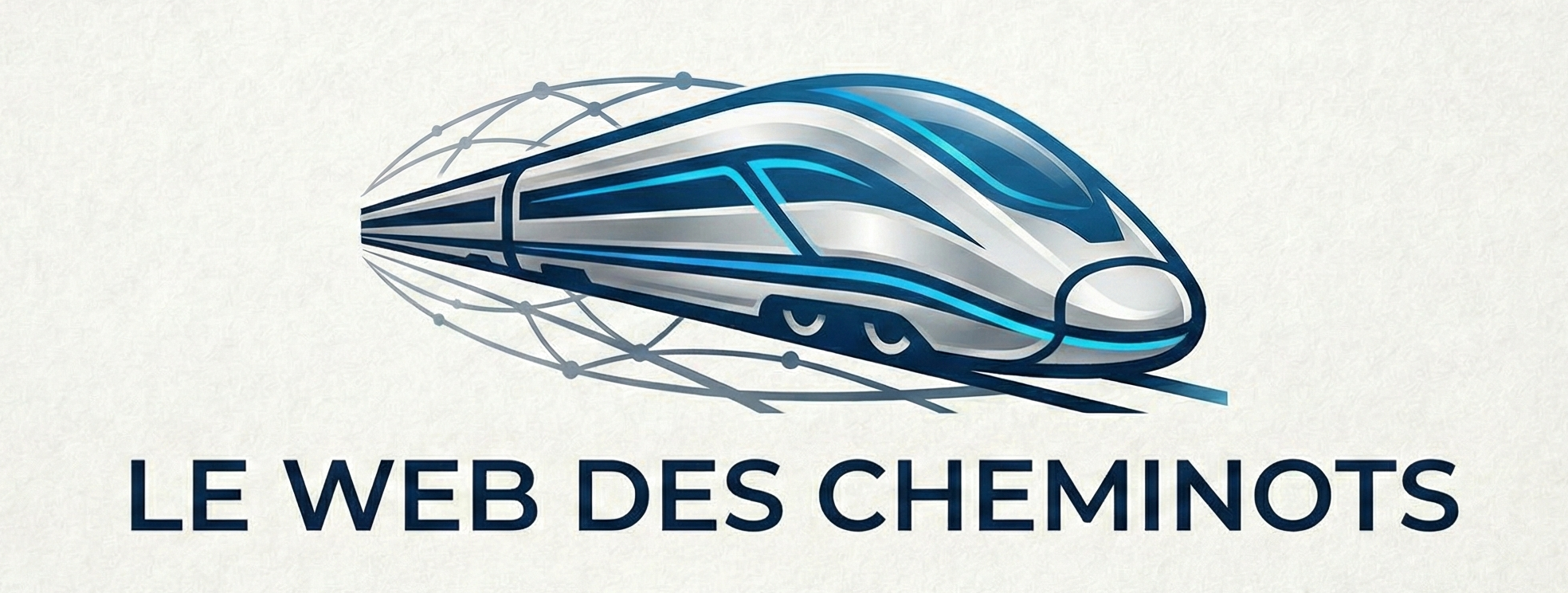Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Effectivement, sauf si le carré passe au sémaphore ou S cli, dans ce cas, le 000 disparait mais la courbe reste calée sur zéro, avec levée à 40 et 35 pour le FU et l'alerte, respectivement. Le passage du carré au sémaphore est l'étape normale dans le dégagement du signal (on a C puis S ou Scli puis A et enfin VL).
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Dans quelques cas, les courbes d'arrêt du KVB pointent en aval du signal mais c'est assez rare. Le fait que le KVB ne garantisse pas systématiquement le non-engagement du point protégé est dû à son mode de fonctionnement intrinsèque et à son adéquation pas toujours parfaite avec l'infrastructure pour ce qui concerne son paramétrage à l'instant t. Le KVB a quand même réduit très significativement l'engagement des points protégés, heureusement vu son coût et ses conséquences sur le fonctionnement du système ferroviaire (dans le cas contraire, ce serait du gâchis). Je n'ai pas la réponse à ta question (il faudrait solliciter un expert es-KVB, côté M). Le fait que le système considère le train comme ne freinant plus (vis à vis du temps de mis en action des freins, pas de la vitesse instantanée qui évidemment continue à chuter) quand le taux de décélération atteint seulement 20% du taux max garanti servant à calculer les courbes, je suppose que c'est inhérent aux limites intrinsèques du système, et peut-être aussi la conséquence d'un choix "parapluie" (sans certitude toutefois). Vouloir calculer plus finement aurait peut-être compliqué fortement le fonctionnement du système et/ou demandait des processeurs plus puissants... La fréquence du cycle de calcul du KVB est assez basse et nombre de simplifications adoptées telle la longueur du train codée en hm traduisent plus une volonté de "faire simple" que d'obtenir un mode de fonctionnement le plus transparent possible vu du conducteur (i.e. bien optimisé). Il en va de même pour le codage du profil en long par exemple. On a très rarement recours à un découpage fin, ce qui fait que sur un tronçon en cuvette, là où la connaissance de ligne permettait au mécano de tenir compte du raidissement du profil pour ajuster au mieux -en sécurité- son freinage à l'approche du point but, il ne peut plus le faire sous KVB... Le taux de décélération paramétré dans le KVB correspond au taux de freinage garanti dans la situation dégradée maximale n'entraînant pas de réduction de vitesse. Elle ne correspond pas aux performances maximales de freinage en conditions nominales, dans le cas général. D'autre part, sur nombre d'engins, la distance de freinage garantie est supérieure à celle obtenue en freinage maximal de service, qui n'est pas considéré comme étant "de sécurité". Le fait que le concept de distance de glissement ait été introduit, avec taquet de référence à 200 m pour la présentation du 000 (associé à l'abaissement de la vitesse de levée des courbes de freinage) est lié au constat qu'un convoi mauvais freineur sur une courbe de freinage non durcie, i.e. levée à 40 km/h (*) , a une forte probabilité de dépasser le point protégé jusqu'à 200 m en aval du signal, s'il est pris en charge à 39,9 km/h au franchissement du carré fermé (en supposant le cas le plus défavorable et tordu où le convoi aurait réduit sa vitesse en amont du signal mais demeurerait juste en dessous de la vitesse déclenchant le FU [pour mémoire : sur un sémaphore ou un carré à glissement >=200 m, les courbes de freinage sont levées à 40 km/h, 35 km/h pour la courbe d'alerte]). Autre remarque : un contrôle de vitesse intelligent et performant devrait permettre au conducteur de reprendre la main lors du déclenchement du freinage lorsque la vitesse a suffisamment diminué pour garantir le non-engagement du point protégé (et non le signal, comme tu le fais remarquer à juste titre) ou le respect de la Vbut au point but. C'est le cas de la TVM. Avec certains équipements (il me semble que ça peut être le cas en ERMTS 2), on peut même avoir un fonctionnement en deux étapes, avec dans un premier temps activation (automatique) d'un freinage de service (ce qui suppose que l'équipement est à même de piloter le FS). (*) la levée des courbes à 40/35 (avec presciption de VL à 30 pour le mécano) était essentielle pour préserver a minima l'ergonomie de la conduite, surtout avec une odométrie qui n'est pas extrêmement pointue, donc sujette à quelques écarts en l'absence de recalages fréquents (qu'on n'a pas sous KVB). Avec une levée des courbes à vitesse plus basse, les risques de prise en charge à l'approche du signal auraient été très élevés, surtout avec un fonctionnement opaque pour le conducteur, rendant la conduite très difficile et l'exploitation plus du tout fluide au abords des signaux annoncés fermés.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Bonsoir à tous, La VISA a été inventée bien après le KVB, une de ses justifications était de rendre transparent le KVB sur SF dans l'enveloppe des configurations possibles, en retenant la plus mauvaise (d'où la règle de la V<30 à ~200 m du signal annoncé fermé), en faisant une pratique générale, indépendante des performances réelles associées au triplet signalisation/matériel/conditions d'exploitation. C'est la logique du nivellement par le bas (qu'on applique même aux tram-trains !)... Sur le SACEM, je ne comprends pas bien en quoi c'est l'homme qui surveille la machine. La conduite (manuelle) sous SACEM s'apparente à du freinage sur ordre. C'est optimisé pour des types d'engins limités et une infra bien spécifique : on ne va pas présenter une Vbut 60 sous VL100 1000 m en amont du point but. C'est efficace pour de l'exploitation en zone dense mais laisse très peu de latitude au conducteur et je doute que ce soit très intéressant sur le plan "métier" de conduire sous SACEM. SACEM ne s'apparente pas à un PA comme il en existe sur le métro. Lorsqu'on évoque la non-transparence du KVB, ce n'est pas uniquement -et loin de là- vis à vis de pratiques "limites", bien évidemment. Que certains comportements "borderline" ne deviennent plus possibles avec la mise en place d'un contrôle de vitesse, ce n'est pas ce constat qui pose problème. L'incidence principale du KVB sur la régularité est liée à son mode de fonctionnement à savoir un contrôle continu de la vitesse à rafraîchissement ponctuel et sans boucle de réouverture à l'approche des signaux ou de possibilité de lever partiellement le COVIT (sous conditions) comme le ZUB par exemple. Nul rapport avec les pratiques "limites" alors en vigueur chez certains mécanos. Dire qu'adopter un système dégradant fortement l'exploitabilité du système ferroviaire (avec d'autres évolutions engagées en parallèle) était "le prix à payer pour améliorer la sécurité", je ne suis pas d'accord. La finalité est une chose mais le moyen d'y parvenir est tout aussi important. Le système ferroviaire a des coûts élevés que la collectivité finance pour une bonne part (via la fiscalité). Si la sécurité est la première des exigences, on ne peut faire tout et n'importe quoi sous ce prétexte, aussi valable soit-il. Les balises de réouverture ont été supprimées très tôt, en raison d'une utilisation inappropriée constatée sur quelques situations isolées (qu'il fallait enrayer, mais pas de cette manière totalitaire et contre-productive). Pour ce qui est de l'adaptation de la conduite au système au fil des années, je suis plutôt perplexe que on compare les anciens ayant été formé sans KVB puis s'étant adaptés au KVB (la plupart sans traumatisme mais rarement avec enthousiasme) et ceux qui ont "grandi" avec sans connaître le fonctionnement ante. Le système permet quand même de fluidifier le trafic, notamment sur tous les carrés à glissement court générant le très pénalisant 000. Pour les séquences sans 000, pour mémoire, la courbe de FU est levée à 40, pas à 30 (s'ajoute un contrôle de franchissement, sur les carrés certains sémaphores). Il est clair que ce n'est pas pour autant la solution miracle et il a un cput élevé (surtout au sol) ... En zone dense, l'avenir est à mon avis à la mise en place d'automatismes plus poussés d'aide à la conduite voire une forme intelligente de P-A (projet NExT). D'accord avec ton constat. Je crains hélas qu'avec l'explosition des coûts pour tout ce qui touche à l'infrastructure ferroviaire (l'éclatement et le fonctionnement actuel du système français n'expliquent qu'en partie cette dérive), la tentation de "bricoler" ou de se contenter de "bourrer le graphique" soit bien plus forte... D'autant que le décideur en matière d'investissements d'infra n'est jusqu'à présent pas impliqué économiquement dans la qualité du produit fini, tant sous l'angle de la robustesse de l'exploitation que des performances. Il n'est donc aucunement poussé à un comportement vertueux. Et personne n'a fait remonter à M ce paramétrage aberrant ? Qu'on ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, pouvoir renseigner le bord KVB sur la compo est incompréhensible sur les engins modernes alors qu'au contraire le KVB a pu être amélioré sur les autom récents type AGC ou TER2Nng, celui prenant enfin en compte la config réelle de l'UM (au moins pour partie) et non l'UM max possible ce qui est pénalisant sur les matériels autorisant plus que l'UM2 en service courant. Le sujet de la conception des horaires et du réalisme de certains montages mériterait un fil à part entière. Le KVB a d'une certaine manière été pris en compte via une augmentation des normes d'espacement pour le tracé des sillons. Mais d'une part cette modification n'a été que partielle, d'autre part la tentation du concepteur actuel du graphique ou de son maître d'oeuvre (qui a une obligation de résultat en matière de réponse aux demandes de sillons, en volume s'entend...) est plutôt d'adapter les normes (à la baisse) dans les zones denses car c'est une solution évidemment moins compliquée et coûteuse à mettre en oeuvre que de modifier l'infrastructure. On peut également rappeler que dans la mesure du possible (c'est loin d'être toujours le cas en zone dense et notamment en IdF), l'horairiste cherche à tracer sur signaux ouverts, configuration dans laquelle l'incidence du KVB est moindre (elle existe dans même, par exemple aux transitions de vitesse). Certains configurations ont été intégrées dans le calcul de marche de manière à ce qu'elles soient transparente vu de l'horairiste (les réceptions sur voie en impasse par exemple, où la vitesse de calcul a été abaissée à plusieurs reprises, on est aujourd'hui à VL10 sur les 110 m, en marche de base, i.e. avant application de la marge de régularité..., les réceptions sur signaux fermés dans les zones de gare [de manière plus ou moins réaliste, dans les deux sens] etc.). La majorité des horairistes ne connait effectivement que de très loin le fonctionnement du KVB, mais ce qui est surtout gênant, c'est que les outils sont techniquement dépassés (il n'y a pas eu de développement majeur dans ce domaine entre la fin des années 80 et la fin de la décennie 2000... les choses bougent enfin côté RFF et de l'EF SNCF [pour ses besoins propres] mais pas à la DCF [où se trouve toute la "production horaire"]) et leur conception est à mettre en regard avec les performances (limitées) de l'informatique des années 80 (c'était très bien pour l'époque cpd). Les outils de tracé utilisés sur le RFN sont très opérateur-dépendant, i.e. qu'ils comportent peu de boucles de contrôle (surtout THOR qui ne vérifie par exemple pas les conflits entre sillons par exemple, le réalisme des montages repose sur le respect de normes par tronçon de ligne ou sur quelques indicateurs graphiques pour le BAPR), la qualité du tracé dépendant énormément de la formation de l'horairiste et de sa connaissance de l'exploitation ferroviaire dans la zone d'intervention. On peut avoir le meilleur ou le pire en terme de qualité de tracé. Dans ce domaine, on constate depuis plusieurs années une diminution de la qualité d'ensemble des montages (probablement lié à l'évolution du management et des formations, devenues rapides avec des cursus qui ne prévoient plus systématiquement un passage "aux manettes" sur le terrain, à l'exploitation [AC, régul...]). On constate ainsi plus fréquemment des montages pour le moins "hors normes" (parcours importants sans marge de régularité, "cisailles" pas bonnes aux bifs ou en zone de gare, codes signaux fermés incohérents avec la situation rencontrée sur le terrrain, sillons superposés [les outils n'interdisent rien dans ces domaines]...). Pour autant, il ne faut pas généraliser. Il y a toujours des agents qui font bien leur travail, y compris des nouveaux dans le métier (jeunes ou moins jeunes) qui ont la volonté de travailler de manière pro. Mais le contexte général de fonctionnement de notre système ferroviaire ne pousse pas vraiment dans ce sens (il faut être motivé pour aller travailler en Bureau horaire, en ce moment, vu l'ambiance et l'organisation mise en place [la DCF dépend fonctionnement de RFF, et l'avancement de carrière est désormais spécifique au sein de la branche Infra]...). Du côté du maître d'ouvrage qui fixe les orientations générales d'allocation de la capacité et à qui la DCF doit rendre des comptes au quotidien, les horairistes issus de la SNCF sont devenus très minoritaires (moins d'une dizaine sur l'ensemble de la direction des Sillons). Bien des prescripteurs ont une vision très "en chambre" de l'exploitation ferroviaire (au sens large du terme), même si comme dans toutes les organisations, on trouve des personnes de qualité qui ont su capitaliser leur connaissances théoriques (à défaut d'être pratiques) du fonctionnement du chemin de fer... acquises au travers d'échanges fructueux avec les "anciens" venus travailler à RFF lorsque lui a été confié par l'Etat le rôle d'ORC (organisme en charge de la répartition de la capacité sur le réseau, le concepteur du graphique théorique, dit en termes plus ferroviaires).
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Merci pour la précision. Il est regrettable qu'un point dur pénalisant pour le débit comme Mantes n'en ait pas été équipé. Hélas, vu le coût de mis en place du KVBP, il faudra probablement attendre encore un bon moment pour en disposer de Mantes à PSL en continu. oui bien sûr... de même que le 000 n'est normalement jamais affiché lors d'un rebroussement, à la reprise de marche de l'engin donc j'ai supposé qu'il y avait évolution dans l'explication transmise via Dom Le Trappeur car pour que le conducteur soit gêné par le 000, il faut qu'il ait franchi un avertissement fermé codant le 000 ou le plus souvent un point de proximité (situé 150 m en amont du carré). Et comme on ne part pas sur un carré fermé, il n'y a pas de raison de rencontrer un 000 au redémarrage après un rebroussement (ou une réinitialisation du KVB), même au passage des balises PROX, à moins que les VB2N ait un équipement "hors normes"...
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Le point de vue que tu développes ici, tout intéressant qu'il soit, renvoie à une problématique différente de celle que j'évoquais précédemment. On peut débattre des dérives possibles ou constatées dans le management des conducteurs et du système ferroviaire, notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, mais c'est un autre sujet. Le terme FUA (KVB) est du jargon SNCF à l'origine, mais il peut s'appliquer à tous les systèmes de contrôle-commande, donc autant au ZUB ou PZB qu'au KVB par exemple. Likorn a bien compris le sens de mon propos, en rappelant que performance et sécurité ne sont pas antinomiques et qu'il est plus intelligent d'aider les conducteurs à tirer parti du couple infra/mobile dans de bonnes conditions qu'à pousser au comportement d'évitement comme on le fait aujourd'hui de l'autre côté du Jura. Faire en sorte qu'une boucle de rattrapage ne dégrade pas l'exploitabilité et la performance d'un système devrait être le fil conducteur dans le développement d'un dispositif de cette nature. Cela n'a pas été le cas du KVB et on accroît ses points faibles en accentuant son effet "boite noire à coup unique" comme au travers du pointillisme de certains contrôles a posteriori (qui vont bien au-delà de ce qu'impose le KVB). Cela n'a aucun rapport avec l'ouverture à la concurrence ou la création de RFF. L'inflexion dans l'approche "système" remonte à une vingtaine d'années et le KVB n'en est qu'une illustration. Elle est la conséquence d'une perte de compétence au niveau de certains acteurs clé du système (au sein des directions de l'entreprise) et de la prise de pouvoir des tenants de la généralisation du principe de précaution (qui a conduit à vouloir ouvrir le parapluie en permanence, ce qui est totalement déresponsabilisant). Pour éviter toute interprétation erronée de mes propos, je répète que ce n'est pas l'objectif d'amélioration de la sécurité ferroviaire que je critique mais la manière dont on l'a mis en oeuvre et le refus de reconnaître les erreurs passées (ce type de sujet est totalement tabou au niveau décisionnel). Ici encore, tu es sur le sujet des conditions de travail et de certaines dérives dans le management du personnel. Un KVB intelligemment conçu et réellement transparent induirait pratiquement autant de FUA dans le même contexte (fatigue...).
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Le principe de fonctionnement du bord KVB, c'est de vérifier à chaque cycle de calcul (512 ms) que la vitesse instantanée du convoi n'est pas supérieure à celle de la courbe d'engagement du FU (qui est antérieure à celle du FU établi sur un graphique vitesse-temps) et le cas échéant à celle d'alerte, déduite de la première. Sur le plan théorique, nul besoin de recalculer les courbes à chaque cycle vu qu'il suffirait de déduire de ces courbes la vitesse à respecter. Dans la pratique, le système déduit de l'odométrie embarquée (et du dernier point d'info KVB rencontré) la distance restant à parcourir à l'instant t et détermine en traçant la courbe de FU à l'envers la vitesse correspondante, afin d'effectuer la comparaison Vinstantanée<V(déclenchement FU). C'est pour cette raison que les courbes sont recalculées à chaque cycle. Le temps d'établissement du frein est modulé en fonction du niveau de freinage constaté pour éviter de pénaliser trop fortement l'ergonomie de la conduite au voisinage des points but, surtout sur les trains mauvais freineurs. Pour ceux (agents SNCF) qui souhaiteraient approfondir ce point, je les invite à parcourir la TT0927 (Notice d’informations KVB - Compléments à l'attention des dirigeants Traction) qui explique de manière assez détaillée le fonctionnement de la modulation du Tb et les limites de ce mode de fonctionnement (train considéré comme ne freinant pas lorsque le taux de décélération devient <20% du taux de décélération garanti rentré dans le bord KVB [par le conducteur ou pré-câblé par M]). Pour likorn : la limitation des effets du patinage est traitée autrement, par filtrage/lissage des données vitesses et un algorithme de calcul adapté. Christian
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Bonsoir, Je ne faisais ici nullement référence aux "nouveaux entrants" (pour reprendre le terme consacré) sur le RFN mais à nombre d'EF publiques européennes, ou même à la RATP. Relis mon propos, il n'est nullement question d'inciter les mécanos à conduire dangereusement. Mais quand on met en place un contrôle de vitesse non-transparent et fonctionnant en aveugle, il est souhaitable de ne pas pousser aux comportements d'évitement, en tenant compte -intelligemment- des limites de ce système quant à son fonctionnement. Tous les FUA KVB hors dysfonctionnement sol ou bord ne traduisent pas une conduite dangereuse, même certains classés DVL (dans le suivi des événements de conduite). Pour le dégagement de zone, par "bonne pratique", je faisais référence au comportement prescrit à la base à tout conducteur : on estime la distance parcourue au vu de la longueur (connue du conducteur) de son convoi, et après celle-ci estimée parcourue, on jette un oeil à la visu du KVB (cas des v5 et antérieures lorsqu'elles existaient), afin de confirmer qu'on pourra remonter en vitesse, si rien ne s'y oppose par ailleurs. Je n'ai pas sous-entendu qu'on violentait -de quelque manière que ce soit- les mécanos. En revanche, tout l'encadrement Traction n'a pas ton approche et certains chefs ou sous-chefs sont très pointillistes voire ont une approche qui fait la part belle à l'approche parapluie ou de la "courbe enveloppe" (des configurations restrictives). Le fait que les informations ou signalements remontent au CTT dès qu'un écart même minime (je maintiens le chiffre de +1 km/h [sous conditions évidemment], obtenu de la source même du prescripteur) est constaté, sous AIDA, ne fait qu'accentuer ce phénomène, chez les tenants du comportement parapluie (-> la prescription de la DB à ses conducteurs de circuler à VL-10 sur LGV en est une illustration parmi bien d'autres). Si sur un événement mettant en jeu la sécurité, la réaction de l'ensemble de l'encadrement sera probablement identique, pour les faibles écarts, elle dépendra beaucoup du N+1, de sa connaissance approfondie du métier et de la technique et de sa lecture pointilliste/maximaliste ou non des référentiels. Les témoignages (recueillis lors d'accompagnement effectués dans les règles mais aussi au travers des échanges anonymes comme sur ce forum) sont hélas très éclairants sur ce point.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Sur les v6, la longueur codée est augmentée de 100 m car la distance prise en compte pour la levée des courbes en libération de zone est réduite de 100 m. Pour les TGV autres qu'Atlantique, la longueur codée dans les v5 était de 200 m (400 m en UM). Le codage de la longueur en décamètres serait en effet un progrès et une mesure plus intelligente que la "bidouille" actuelle qui pénalise la séquence de freinage sur les engins non équipés du FEP ou considérés comme tels vis à vis du KVB (certains autom).
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Ce n'est pas plutôt le dysfonctionnement un temps constaté au niveau des avertissements repassant à un état moins restrictif mais dont le codeur des balises réagissait avec retard, entrainant des prises en charge (bien que le conducteur ait vu l'état du signal changer avant son franchissement) ? Car les courbes KVB sont réactualisées en permanence quand le mobile roule, vu que la distance but évolue et la vitesse instantanée peut faire de même. C'est donc une situation normale que le recalage permanent des courbes (le temps de cycle est de 0,512s, valeur assez élevée soit dit au passage). Ce qui change quand on passe d'une phase de freinage à une marche sur l'erre ou une accélération avec une Vbut restrictive enregistrée par le bord KVB, c'est le Tb = temps d'établissement du frein (vu du KVB), qui atteint alors la valeur maximale Tbo dès que le taux de décélération tombe à 20% de la valeur max nominale prise en compte pour le convoi. Christian
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Un système de contrôle de vitesse sur le réseau classique ne pourra jamais être vraiment transparent au niveau de la conduite, même si des améliorations du KVB demeurent possibles. Ou alors on ferait une usine à gaz au coût hors d'atteinte pour le système ferroviaire. Pourquoi l'approche retenue dans les autres pays (qui consiste à aider le conducteur à conduire en sécurité et non à mettre en place un couperet qui peut tomber sans lui permettre de réagir) ne peut être appliquée chez nous ? Je rappelle que ce n'est pas parce que le KVB présente des indications libératoires ou d'aide à la conduite qu'il a vocation à remplacer la signalisation latérale. Les cas qui ont été mis en avant par les instigateurs de la v6 pour supprimer les affichages déjà succincts s'appuyaient sur une pratique non conforme aux principes de conduite sous KVB, concernant une petite minorité de conducteurs... On a préféré pénaliser l'ensemble et l'exploitabilité du système, qu'on préfèra nier par avance. La disparition du "L" ou du "00" au visualisateur n'a jamais été présentée comme information suffisante pour autoriser le conducteur à reprendre sa marche "normale". La bonne approche que vous connaissez tous, c'est d'abord de respecter la signalisation latérale, donc notamment le dégagement de zone et de vérifier ensuite que l'affichage KVB est cohérent avec la situation du train à l'instant t. Si l'on donnait par exemple le temps restant (en secondes) avant le franchissement de la courbe d'alerte sur 000, on éviterait de voir certains convois aborder les signaux ou les heurtoirs à 7-8 km/h 100 voire 150 m en amont et donc ralentir le trafic de manière significative. Mais non, on préfère demander aux conducteurs de conduire en aveugle sur un système non transparent et dont le fonctionnement s'apparente pour eux à une boite noire, aux conséquences potentielles redoutables (en cas de FUA) vu la logique de management très coercitive dans ce domaine (contrairement à d'autres EF ou un déclenchement de FUA n'a pas les mêmes incidences pour le conducteur... hormis les cas de situation dangereuse vraiment avérée). Une fois encore, on a le système qu'on mérite, vu la manière d'aborder les choses dans ce domaine !
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Depuis une vingtaine d'années sur le RFN, les distances d'annonce comme de ralentissement augmentent (pour les TIV de chantier, les niveaux actuels sont proprement hallucinants)... alors que dans le même temps les performances de freinage de la majorité des convois s'accroissent. C'est pour cette raison qu'en parallèle, on a progressivement remplacé la "Vbut au point but" par le freinage "au plus tôt". C'est vachement cohérent vu que c'est l'exploitation qui s'en trouve désoptimisée (le débit a chuté comme les performances, toutes choses égales par ailleurs). Heureusement, il est resté des pays ou des réseaux dans lesquels on a conservé une certaine cohérence d'approche au niveau du couple infra/mobile...
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Salut, félicitation pour la réussite de ton examen. S'agissant de ta question, je vais faire une réponse technique... nullement "métier". Mes collègues tractionnaires sont bien mieux placés que moi pour répondre sur cette angle. Sous l'angle de la règlementation "signaux" du RFN, un A cli impose au convoi d'être en mesure de s'arrêter en amont du signal N+2, annoncé à distance réduite par le N+1, si ce dernier présente l'avertissement à son approche (il peut être réouvert lors du franchissement...). La règlementation ne fixe aucune règle de vitesse limite au franchissement de l'avertissement, ce qui est logique et de bon sens (les mécanos sont des techniciens hautement qualifiés et intelligents, pré-supposé de base) vu que les situations peuvent être extrêmement diverses, tant côté infra que convoi. On trouve des A cli du fait de distance A-S ou C inférieures de 50 ou 100 m à la config du train le plus mauvais freineur pris en compte pour la détermination de la signalisation, par exemple. Et d'autres où la distance A-S/C est vraiment courte (pour la VL autorisée). Exemple de l'entrée de Bourg en Bresse en venant de Mâcon et la LGV SE, où on a un A cli alors que la VL est de 140 pour les V140 et au-delà et la distance A-C doit être de 1350 m sjmsb, avec une légère rampe.... Côté KVB, la distance but codée dans les balises est celle au signal N+2, distance rafraichie lors du passage sur le signal N+1 (donc dans ce cas, arrêt possible de la séquence de décélération si le signal présente VL ou de nouveau Acli). La "règle" non écrite des 50 ou 70 km/h au franchissement de l'avertissement est une approche "attrappe tout" (comme on les aime bien aujourd'hui) censée couvrir la quasi-totalité des situations susceptibles d'être rencontrées par un convoi fret ou voyageurs, évitant de frôler la courbe d'alerte du KVB... Lorsque la distance est importante et/ou le convoi bon freineur (et les conditions de circulations non dégradées bien sûr), il n'est vraiment pas nécessaire (et dans nombre de cas contre-productif) d'aborder le signal à 50... dans la mesure où tu connais bien la ligne, évidemment. D'un autre côté, réduire suffisamment la vitesse en amont de l'avertissement peut, dans certains cas, permettre de franchir le signal N+1 revenu à VL (ou Acli), ce qui est plus que souhaitable sous KVB (vu l'absence de boucle continue de réouverture... et les gestes métiers qui ont accompagné ce mode d'exploitation peu performant). Donc là aussi, l'expérience et la pratique du terrain compte beaucoup ! Christian
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Bonne question ! L'exploitant a souligné en son temps la dégradation de l'offre sur ce point. Mais RFF et le STIF (sa direction technique du moins) sont globalement sur la même longueur d'onde (un des acteurs clé parmi les techniciens du projet cadencement est d'ailleurs parti travailler à RFF au sein de la direction des Sillons...). Le cadencement strict prime sur beaucoup d'autres considérations et comme le projet doit être réalisé à infra constantes, l'offre doit s'adapter aux possibilités du graphique et de l'exploitation (je résume mais c'est le constat auquel on arrive). A la clé des détentes horaires signifactives sur certaines OD telles Paris-Rouen (1:11/13 pour un parcours sans arrêt... sans commentaire !). On peut d'ailleurs tout à fait avoir les deux situations sur une même marche (montage fragile sur un tronçon et forte détente en amont ou en aval)... Dans le cas de Mantes-PMP, c'est en l'absence d'autre solution dans un graphique contraint que la suppression de l'arrêt a été décidée pour limiter la fragilité du montage. Il faut quand même rappeler que les deux gares sont très proches.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Salut, La zone de Mantes côté Paris n'est pas sous KVBP ? J'avais en mémoire que les VB2N rénovées et les 27300 étaient équipées. Pour ce qui concerne la sortie à 30 de la voie 3S (ou 1S) de Mantes la Jolie, la pancarte R en direction de la v2 Poissy est au km 56,645, Mantes Station (axe du BV) au 56,108 (56,032 pour la pancarte TT sur v2). La suppression de l'arrêt doit permettre de passer en gare à plus de 30 (en accélération) sur la v2 (un convoi 27300 +7 VB2N mesure ~190 m donc 200 m vu du KVB mais sous version 6.x, normalement levée du contrôle à L-100 m donc transparent sur ce point). Je me demande s'il ne serait pas possible d'introduire un Z40 voire Z60 (pancartes au sol) en amont de la pancarte R (vers le 56,750), en fonction de ce que permet la traversée oblique de la v1 Le Havre. On ne gagnerait pas grand chose mais aux faibles vitesses, ce serait toujours bon à prendre.
-
Service Annuel 2011 [Sujet Officiel]
Non, ce n'est pas satisfaisant bien évidemment. Et la situation n'est pas près de s'améliorer à court terme. Ouvrir la vente à J-60 ne changerait pas significativement la donne, vu qu'aujourd'hui, certains trains voient leur positionnement horaire confirmé à seulement un mois voire 15 j de leur circulation effective, souvent dans un horaire différent de celui initialement annoncé...
-
[ Z 870 Stadler ] Sujet officiel
Bonjour Daniel, je faisais référence à la BDeh4/4 501 livrée en 1979 (en compo à trois caisses) : Photo publiée sur le site http://www.railfaneurope.net Christian
-
[ Z 870 Stadler ] Sujet officiel
Bonjour Xavier, merci pour ces nouvelles, de première main qui plus est (!) Pourquoi mettre au rebut la 602 alors que la rame est nettement plus récente (1979 de mémoire) que les BDeh4/4 4 à 8 (très bien conservées cela dit) ? Compo à 3 caisses jugée mal adaptée aux besoins actuels de transport ? Christian
-
Pourquoi la SNCF perd de l'argent?
Salut, je ne suis pas convaincu qu'il faille consacrer du temps à débattre des propos de R. Prud'homme, proche de Ch. Gérondeau et plus généralement des lobbies routier et pétrolier. Cela n'en vaut pas la peine, le personnage étant irrécupérable dans ce domaine (je le dis d'autant plus que ce fut l'un des responsables du DEA "Transport" créé par l'Ecole des Ponts et Paris XII [il l'était au titre de Paris XII]... je l'ai connu en tant qu'élève donc). Ses idées sont très arrêtées mais il connaît en fait mal le secteur des transports collectifs, en particulier le ferroviaire. Diplômé d'HEC et agrégé d'économie, il a oeuvré à la Banque mondiale du temps des années Reagan/Thatcher, dont on paie aujourd'hui nombre de décisions politico-économiques pour le moins contestables, à l'échelle mondiale. Ce qui est choquant, c'est qu'une rédaction d'un journal prétendu sérieux accepte de publier de tels propos. Cela en dit long sur la connaissance des dossiers de nombre de rédac'chef. Ses référence à la Grande Bretagne sont affigeantes car une grande partie du surcoût du système actuel est lié précisément à l'éclatement (voulu politiquement) du système ferroviaire et à la multitude d'acteurs, pour bon nombre de statut privé, qui se servent sur la bête, à savoir le client et le contribuable britanniques, ainsi qu'à la perte de compétence liée au démantèlement brutal des ex-BR (nombre d'agents ayant été mis à la retraite, sans qu'ils assurent le relais vis à vis de nouvelles générations, recrutées dans un contexte très atomisé avec sous-traitance en cascade, c'était du temps de J. Major). Le scandale des ROSCO ou de Railtrack se passent de commentaires... Non vraiment, nous perdons notre temps de à débattre de cet article et de ce titre personnage, de mon point de vue.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Sur le premier point, le "de sécurité" est à comprendre dans le contexte très exigeant appliqué dans le domaine ferroviaire, en France, sous-tendant un risque d'événement contraire à la sécurité très bas par heure de fonctionnement (je n'entre pas dans les détails). Une panne sol n'impose pas (jusqu'à présent du moins) de restriction au niveau de l'exploitation, sur le court terme s'entend. En ETCS 1, tout dysfonctionnement du bord ou du sol est très pénalisant car on considère à l'inverse qu'il s'agit d'un contrôle-commande "de sécurité" (ce qui laisse présager un beau b... si la fiabilité des équipements n'est pas au rendez-vous). Ce qui est critiquable pour le KVB, ce n'est pas qu'il ne soit pas "de sécurité" mais qu'on se refuse à prendre en compte son existence et son mode de fonctionnement lors des modifications de la signalisation au sol sur les secteurs équipées (dans le contexte d'aujourd'hui où tous les engins de ligne doivent être équipés, hormis les cas très particuliers faisant l'objet de mesures spécifiques), lorsqu'on adopte dans le même temps une approche hyper-restrictive conduisant par exemple à multiplier la présentation des rouge cli ou l'ajout d'enclenchement de proximité. En pratiquant de la sorte, on crée des doubles voire triples peine pour les circulations ferroviaires, que les concepteurs de l'infra comme son MOA se refusent à prendre en compte (on est dans le comportement de l'autruche...) Quant au second point, concernant les PROX, attention à ne pas confondre avec les balises X. Les PROX sont implantées à proximité des carrés à glissement "court" (au sens du KVB), en général 150 m en amont et constituent une amélioration notable de l'exploitation sous KVB. Elles n'existaient pas à l'origine et leur implantation est aujourd'hui systématique sur les nouvelles installations ou lors des reprises d'équipement existants. Le gain intervient sous deux angles : d'une part, on limite l'occurrence de la présentation du 000 donc la pénalisation qui en découle sur la fluidité du trafic et les performances (le 000 ne montant plus dès l'avertissement sur les zones équipées de la sorte), d'autre part on améliore l'ergonomie vu du mobile grace au recalage de l'odométrie embarquée, au franchissement des balises (toujours par deux) donc là où il est important de bien caler les courbes d'arrêt. Au passage, on évite ainsi les comportements "sur-anticipateurs" (les convois qui seront à 10 à 150 m du signal par exemple). Par contre, les PROX n'ont (hélas) pas de fonctionnalité de réouverture (techniquement ce serait tout à fait possible), ce qui signifie que lorsque tu franchis une PROX et que le carré aval n'est plus fermé (présentant toutes les indications autres de VL au sémaphore), les courbes de décélération du KVB ne seront pas durcies mais pas non plus levées (ce que permettaient les balises X) en présence d'une indication libératoire telle VL, A ou A cli par exemple)... Donc maitien du pied de courbe à zéro calé sur le signal, levé à 35 (alerte) ou 40 (FU). C'est ce qui justifie la partie de la VISA relative à la reprise de vitesse en amont du signal (la règle du "<30 km/h 200 m en amont du signal" est une généralisation "parapluie" que n'impose pas le KVB de manière générale... sur les trains bons freineurs en particulier). Là on atteint le summum de l'incompétence, si ce type de récommandation existe dans les faits (j'ose espérer qu'il s'agit de cas isolés, vu l'exemple retenu qui confine au ridicule en conditions normales de circulation, même avec un convoi mauvais freineur -hors situations particulières)... Lors d'accompagnements, à plus d'une reprise, j'ai été surpris de constater la faible connaissance du fonctionnement précis du KVB de certains CTT (pas tous évidemment, les "très pros" il y en a aussi et bon nombre sont dans la "moyenne"). Pas étonnant que dans ces conditions, on pousse ses collaborateurs à ouvrir le parapluie... (et tant pis pour l'exploitabilité du système dans son ensemble). On a le cdf qu'on mérite (au vu des décisions prises)... bis repetita.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Sur les automoteurs, cette non-transparence est due notamment au paramétrage de la décélération garantie, qui toujours inférieure aux performances atteignables en situation nominale, situation aggravée sur les matériels non équipés FEP ou paramétré comme tel sur le KVB (via la vidange CG étendue à l'ensemble des cabines de conduite par exemple, disposition retenue sur les Z2N du RER D) et dans certains cas pas le paramétrage infra (distance but, profil moyen...). Pour les Z2N non renforcées freinage, le gamma du KVB est ainsi de 0,78 (pas terrible pour des engins modernes assurant de la banlieue) et l'absence de FEP est accentué par l'arrondi à l'hectomètre supérieur de la longueur du convoi, qui intervient dans le calcul du temps de mise en action des freins. Dans ces conditions, la non-transparence n'est pas étonnante. Ce qui est surtout critiquable, c'est de ne pas avoir cherché à limiter l'impact sur la conduite et les perfomances en permettant aux conducteurs de connaître leur position par rapport aux courbes d'alerte et de prise en charge (afin de ne pas conduire avec la crainte permanente d'être pris en charge dans les séquences de freinage). Mais le KVB n'étant pas considéré comme "de sécurité", la Traction s'est toujours opposée à ce type d'aide à la conduite (alors que c'est une mauvaise utilisation de cette aide qui serait contestable -le respect de la signalisation au sol primant dans tous les cas- pas l'aide en elle-même). Pour les mêmes raisons, est arrivée la v6 avec disparition de la plupart des affichages aux visualisateurs (déjà succincts) ou encore la suppression des balises X de réouverture, au début du KVB... Dans toutes ces situations, on n'a jamais voulu tirer la pelote jusqu'au bout et voir les conséquences prévisibles sur l'exploitabilité du système, de telles dispositions pénalisantes pour la circulation des trains.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
C'est peu ou prou ce que j'ai écrit. Je ne blâme nullement les conducteurs dans mes remarques, ni ne dis "il y a qu'à, faut qu'on"... mais ne fais que souligner que l'on récolte ce que l'on sème. Revenir à un fonctionnement plus efficace et sûr (car la dégradation actuelle de l'efficacité affecte aussi la sécurité sur certains points, aussi paradoxal que cela puisse paraître à première vue) sera long... si on en a la volonté (j'ai quelque doute à ce sujet), l'éclatement du système avec ses multiples acteurs (SNCF EF, SNCF GID, RFF, EPSF, ARAF, ERA....) n'arrangeant évidemment pas les choses. A Necroshine (son message relatif à HSL) : ce que je dis est simplement que les ADC sont senés être des techniciens hautement qualifiés, donc qu'il faut leur laisser une capacité d'appréciation et ne pas en faire des presse-bouton. Qu'un mécano prenne plus de marge sur une ligne qu'il connaît mal ou en conditions de circulation dégradées (adhérence, freins ou BM isolés...), aucun chef sensé ne lui reprochera, bien au contraire. Le cdf est un système aux coûts d'investissement et de fonctionnement élevés (notamment parce qu'il a un haut niveau de sécurité, exploité correctement), il est donc normal qu'on cherche à ce qu'il tire pleinement parti des possibilités offertes par le couple infra/mobile. Aux équipements et au management des hommes de faire en sorte que cela soit possible, sans réduire le niveau de sécurité (donc il faut concevoir intelligemment les équipements au sol et embarqués, en veillant notamment à ne pas dégrader l'existant). On a su le faire dans le passé, et d'autres réseaux ont conservé ce savoir-faire. C'était l'esprit de mon propos.
-
Service Annuel 2012 [Sujet Officiel]
Comment faut-il comprendre ton propos ? Je rappelle qu'en vertu des dispositions européennes, il n' y a de "droit du grand père" dans le ferroviaire et qu'au moins en théorie, on repart de zéro à chaque service. Dans la pratique, tant que les outils de tracé demeurent, il en va différemment mais pour 2012, la part de sillons qui vont bouger est très importante (au moins 70%) et les commandes (~35000 sillons) du lot principal (celui effectué dans le cadre du montage du service et non dans la capacité résiduelle du graphique) sont aujourd'hui pour la plupart déjà saisies dans l'outil de commande SNCF (interfacé informatiquement avec celui de RFF). C'est notamment pour cette raison (le système ferroviaire SNCF+RFF s'apparente plus à un pétrolier qu'à un croiseur ou une vedette) que le discours tenu dans la presse est en grande partie de la com et rien d'autre, en décalage avec la réalité du projet. Je vais prendre un exemple concret : aujourd'hui les Paris-Marseille partent aux minutes 16 chaque heure et 46 heures paires (hors variantes travaux) et desservent Avignon et Aix à '16 des heures impaires, Aix ou Avignon à '46, étant directs à '16 des heures paires (cas général, des adaptations isolées existant à certaines heures). En 2013, les TGV partiront aux minutes 07 (heures impaires, arrêt Avi+Aix), '19 (heures paires, sans arrêt), et '37 (heures paires, arrêt Avi ou Aix). C'est bien résumé... avec pour le pdt de l'entreprise un petit rappel : on ne peut considérer qu'il découvre le projet aujourd'hui... L'horizon 2012 est calé depuis au moins 3 ans... La prise de conscience au niveau des instances dirigeantes de l'entreprise remonte à moins d'un an, dans le faits (les alertes au niveau des acteurs du projet sont plus anciennes mais sont restées lettre morte jusqu'à l'automne 2010).
-
Service Annuel 2012 [Sujet Officiel]
Bonsoir, Le Monde ne fait que reprendre la posture développée par chacune des deux directions d'entreprise, sans connaître vraiment le dossier, encore moins sa genèse et son avancement depuis un an. Pour vivre ce projet "de l'intérieur" depuis l'origine, je maintiens qu'aucune inflexion notable n'a été donnée ces derniers mois, on a juste une prise de conscience des politiques (suite aux alertes répétées du pdt Pépy et de certains membres du COMEX bien introduits auprès des médias ou des élus) du risque important sur la qualité du service 2012, suite à une préparation qui a largement dérivé en termes de planning et souffre d'un pilotage qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des risques (au premier chef du côté du promoteur de l'opération), sans parler des impacts liés à l'explosion des coupures pour travaux ou maintenance, aux effets ravageurs sur les dessertes [qui rendent le discours sur le cadencement généralisé "solution à tous les problèmes" surréaliste vu sous cet angle]. Face à ce risque, le ministère dit qu'il faut une communication de haut niveau vis à vis de la population comme des élus régionaux (dont certains rechignent à subir des modifications qu'ils n'ont pas demandé, tel le STIF) mais ne remet absolument pas en cause l'opération, car il est tout simplement trop tard. Qu'ensuite on tente de faire croire au Français qu'on a obtenu une inflexion majeure dans la mise en oeuvre du projet, à quelques semaines de la commande des sillons, c'est de bonne guerre dans un monde où la communication est devenue aussi importante que les décisions proprement dites et leurs conséquences. Des affirmations comme "En 2012, 30 % des 800 liaisons TGV quotidiennes seront organisées en navettes (contre 10 % en 2011)" font sourire car la consistence de l'offre TGV de 2012 ne sera pas significativement différente de celle de 2011... seuls les positionnement des missions devant changer, pas les grands principes d'organisation des dessertes. Pour ce qui concerne l'étendue du cadencement, comme je l'ai déjà écrit, c'est une évidence depuis l'origine pour les techniciens engagés dans le processus (y compris au sein de RFF - idéologues éloignés des réalités mis à part [heureusement peu nombreux mais hélas influents]) que l'offre mise en place en 2012 ne serait pas majoritairement cadencée au sens strict et idéologique où l'entend son promoteur (voir la définition d'un sillon cadencé tel que défini dans le Document de référence du réseau de RFF, sur son site). D'où le pourcentage cité qui semble dérisoire (dans la réalité, on sera problement en dessous, car les relations voyageurs qui pourraient être considérées comme cadencées au sens de RFF seront peu nombreuses, y compris sur le TGV et les TER).
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Salut, être à Vbut 100 m en amont du point but, c'est sur cette base qu'est calculée la marche dite "de base", i.e. avant ajout de la marge de régularité. Si les convois circulaient sur cette base, il n'y aurait pratiquement pas de problème de fluidité et de tenue des horaires, aux erreurs près (plus nombreuses qu'avant car là aussi on régresse) des concepteurs du graphique de circulation.. Hélas, ce que l'on observe, c'est une dispersion importante des comportements, avec des anticipations beaucoup plus importantes. On constate couramment des Vbut 500 m en amont du point but, quand ce n'est pas plus, et des vitesses inférieures à Vbut sur les zones de ralentissement, des reprises très tardives etc. Sur le RER C que j'emprunte tous les jours, certains trains se calent à VL35 d'Issy Val de Seine à Javel du fait des (stupides) LPV 40 ponctuelles... C'est facile de les identifier car même aux heures creuses, ils ne tiennent pas les marches (pourtant il y a du mou). Le fait d'avoir augmenté les distances d'annonce, en particulier sur les LPV (encore cette logique du parapluie) a eu un effet pervers (vu que la Traction demande aux conducteurs d'appliquer les Vbut "au plus tôt" et non plus "au point but" [ou à l'approche] comme avant). A HSL, le 000 monte au visualisateur KVB dès l'avertissement... situé plusieurs centaines de mètres en amont des quais (il n'y a pas [ou avait pas si les choses ont enfin évolué] de balise KVB "PROXH" comme dans d'autres gares) améliorant l'ergonomie de conduite (sur le fond, l'apport de telles balises est à la marge le plus souvent [limité au recalage de l'odométrie]). C'est, avec l'application de la VISA, ce qui explique les marches d'escargot. C'est un véritable gâchis car un matériel très bon freineur comme les MI2N ne nécessite absolument pas d'aborder le quai à 30 (voire moins), vu qu'il a un taux de décélération garanti en freinage de service supérieur à 1 m/s². C'est cette logique pavlovienne qui consiste à vouloir imposer des comportements uniques calés sur les convois mauvais freineurs à l'ensemble des trains qui est critiquable et déresponsabilise les conducteurs. Je ne dis nullement qu'il faut conduire "borderline" (cf. nos échanges sur ce sujet, avec notamment le distinguo entre Vbut au point but et freinage "au plus tard") mais une exploitation perfomante doit tirer parti des capacités offertes par le couple matériel/signalisation, ce que continuent à faire d'autres réseaux ou même le voisin RATP sur le RER (à qq. exceptions près car tout n'est pas idéal chez eux bien sûr). On a aménagé les installations de HSL pour pouvoir y circuler à 60.... mettre plus de temps qu'à PSL (où les trains rentrent [à VL30] assez bien sur des quais courts malgré l'introduction du 000 sans balises PROXH) est proprement lamentable (ce ne sont pas les conducteurs que je vise ici mais ceux qui leur ont imposé ce mode de conduite). Le KVB, même dans sa configuration actuelle (à HSL), n'impose nullement ce comportement parapluie, qui coûte 30" à 1' sur les marches (il arrive fréquemment qu'on mette une minute voire plus pour parcourir les 250 m du quai !). En gare RER (souterraine) de Zurich, les trains (des automoteurs aux capacités de freinage très bonne comme c'est la règle en Suisse ou en Allemagne), exploitée sur la règle de l'alternat, les trains entrent à 50 en extrémité de quai, sur signaux fermés... en toute sécurité, avec un freinage très propre et majoritairement électrique. A HSL, les heurtoirs sont situés plusieurs dizaines de mètres en aval des quais, qui plus est. Sur le premier point, il faudra qu'un jour certains grands chefs comprennent qu'on ne peut à la fois vouloir lisser au maximum les marches pour limiter les coûts de maintenance du matériel et exploiter correctement un service ferroviaire en zone dense (constat également valable sur les LGV). Si la RATP pratiquait de la sorte, le débit du RER A s'effondrerait. Idem chez nos voisins ou au Japon. Dans les zones denses, il est essentiel de circuler -quand les conditions le permettent- aussi proche que possible de la VL de ligne, sauf domestication imposée dans le montage des horaires (ce qu'un conducteur habitué identifiera très vite à la vue de sa marche théorique). Si chacun "prend de la marge", le graphique se couche et le débit se casse la figure. Sur le second point, c'est pour cette raison que je dis "le système" a ce qu'il mérite. A tomber dans le pointillisme en se trompant d'objectif (on ne compromet pas la sécurité en mordant ponctuellement de qq. km/h sur le trait), on génère des comportements d'évitement, qui grippent le bon fonctionnement du système. Cela pousse à développer le freinage automatique voire la conduite assistée, à pratiquer de la sorte. Je n'irais pas jusque là tout de même (+10/50 m) du moins hors engins très bon freineurs car -on l'a écrit et répété- le KVB est loin d'être transparent et le paramétrage des distances but comme du profil moyen, ajouté à la modulation du temps d'application du freinage (la "modulation du Tb" en jargon KVB) peuvent générer quelques mauvaises surprises (surtout sans FEP). Ce qui importe sous KVB, c'est de ne pas trop tarder (quand la distance d'annonce est proche du "nominal") pour engager le freinage (dosé en fonction du contexte). Mais à l'approche du point but, dès qu'on est sous la barre de VL+10, il ne devrait plus y avoir de problème, donc possibilité d'ajuster finement (pour ne pas dépasser Vbut) sur les 100 à 200 derniers mètres, en fonction de la vitesse (à 40, pas la peine d'avoir 200 m, c'est du gâchis). Plus la VL est élevée, plus la marge pour caler Vbut doit être importante (sans être excessive) sous KVB, car les courbes pointent (hélas) Vbut et non Vbut+x km/h (comme en TVM), ce qui contribue à la non-transparence pour la conduite. Par contre, les courbes sont bien levées à Vbut +5 ou 10. Le KVB est non-transparent dans les séquences de freinage, pas sur VL établie où il n'est pas du tout gênant, quand il fonctionne correctement.
-
Les cheminots incités à rouler plus vite
Bonsoir, je crois qu'effectivement, cette période électorale (interne à l'entreprise) a quelque peu incité certaines OS à faire dans le discours "ferroviaire" sécuritaire (pour le moins démago dans le cas présent -ce n'est pas toujours le cas- car il n'est nullement demandé aux mécanos d'enfreindre les règles ou de jouer avec le feu). Néanmoins, le constat auquel on arrive de difficultés accrues à tenir les horaires est le résultat d'une lente dégradation de l'efficacité du système ferroviaire français, qui a débuté bien avant la création de RFF (elle s'est accentuée avec) et qu'on commence par percevoir de manière tangible. On ne peut pas tourner tous les curseurs dans le même sens sans aboutir à une désoptimation du système, d'autant plus grave aujourd'hui que le système est éclaté et que le gestionnaire de l'infrastructure n'est en rien responsabilisé -économiquement s'entend- dans la qualité de l'exploitation, tant pour ce qui concerne la régularité que la performance. Mais il est loin d'être le seul en cause. Pour prendre un exemple parlant (il y en a bien d'autres), quand on met en place un contrôle de vitesse non transparent dont l'ergonomie est proche de zéro pour le conducteur et que dans le même temps, on généralise un management plutôt coercitif quant aux déclenchement des FU par automatisme (forcément en hausse avec le déploiement du KVB), il ne faut pas s'étonner que se développent les comportements d'évitement (le système devient transparent... moyennant une conduite dégradée et moins performante). On approche aujourd'hui le stade ultime avec la surveillance a posteriori des marches systématisée dans une logique d'essence pointilliste, ce qui conduit de facto a ne réserver la tenue du trait (quand c'est nécessaire) qu'à une minorité de mécanos chevronnés sur du matériel très récent... puisque l'ADC lambda se fera taper sur les doigts par tout CTT pointilleux dès que l'épaisseur du trait est entamée. Sur les LTV, la logique du contrôle à +1 km/h est totalement contreproductive puisqu'elle pousse les conducteurs à circuler sous la VL sur les zones à vitesse déjà réduite, accroissant encore les pertes de temps et la chute du débit (4000 m à 35 au lieu de 40 sur un gros chantier, c'est presque 1 min de perdue !). Comme en parallèle, les distances d'annonce des LTV ont fortement augmenté et qu'on pousse au freinage au plus tôt, comment s'étonner de cette désoptimisation du système, des marches considérées comme impossibles à tenir ? Le système n'a que ce qu'il mérite. Inventer une prescription de vitesse à 10 km/h (le 000 du KVB, invention française...) sans fournir au conducteur sa position par rapport au point but de la courbe de contrôle, c'est pousser à l'accroissement des écarts-type en matière de comportement des convois, avec des trains qui circulent à 7/8 km/h à 100 m (parfois plus) du carré (ce que n'impose absolument pas le KVB même avec un train mauvais freineur) quand d'autres seront viseront le 10 à 50 m... A Haussmann St Lazare, on frise la caricature par exemple, alors que les voies sont à VL60 et le coeff de décélération des MI2N est très élevé (le train pourrait aborder le quai à 60 sans être pris en charge... il arrive au mieux à 30, et est souvent à 10/15 au milieu du quai). Or aux très basses vitesses, les pertes de temps deviennent vite importantes. L'interprétation "dévoyée" de la TVM (par rapport à ce qu'elle permet réellement) relève de la même logique parapluie et déresponsabilisante (tout le monde paie pour quelques comportements inadéquats). Les concepteurs du système (aujourd'hui à la retraite) sont atterrés de voir certains comortements sous TVM. Qu'on essaie aujourd'hui de revenir aux fondamentaux du métier me semble logique, mais ce n'est pas très cohérent vu l'évolution de l'infrastructure depuis 20 ans, des équipements de contrôle-commande et du management de la sécurité côté conduite. Non seulement RFF peut quelque chose mais plus encore il est responsable de ce qu'il finance et met en oeuvre. Il est GI, que diable, et doit assumer ses responsabilités !!! Qu'il ne prenne pas la peine de vérifier ce que produit sa maîtrise d'oeuvre ou qu'il n'ait pas la compétence pour le faire, ou simplement la volonté de le faire, c'est quand même un problème. Quasiment chaque modernisation de poste ou mise en place de CCR s'accompagne de dégradations de l'efficacité de l'exploitation. A Part-Dieu, ce sont les bandes jaunes qui disparaissent (au profit des S cli) par exemple, alors que rien n'a bougé au niveau du plan de voies, en vertu de l'application d'une note "parapluie" (de 2002 sjmsb) qui ne repose sur aucune document opposable (l'approche retenue à Part-Dieu dans les années 80 avec remplacement du ralent 60 par un ralent 30 + BJ était intelligente... imposer une VL15 à 500/600 m du point d'arrêt est une hérésie... quand on a la possibilité de faire autrement). Et après on s'étonne que les temps de parcours augmentent, qu'il faille revoir les blocks (comme à Bordeaux sur un plan de voie refait à neuf pour 180 M€ !)... A Bellegarde, RFF a imposé contre la volonté du transporteur SNCF le choix d'une secteur neutre de changement de tension en zone de gare et dans une cuvette. Ce n'est pas parce la solution technique lui a été proposée par l'ingénierie de son GID qu'il n'est pas responsable de ses décisions. S'il devait en assumer les conséquences économiques, peut-être serait-il plus critique et sérieux dans la validation des choix techniques. Le S cli à l'entrée en gare traduit le même constat, comme l'abaissement à 30 généralisé dans la gare basse (c'est lamentable !). i.e. à VL de la ligne donc... (en vitesse stabilisée s'entend, hormis pour les taux extrêmement bas comme sous VL10, la courbe d'alerte est à VL+5, celle de FU à VL+10). Demander aux conducteurs de circuler 5 km/h en dessous de la courbe d'alerte, cela revient à leur demander de faire le trait, lorsque c'est nécessaire (en zone dense, c'est essentiel lorsque rien ne s'y oppose). Rien d'illogique donc ! Mais vu qu'on vous emm... pour le moindre écart marginal autour du trait (du moins pour les engins sous ATESS), on peut comprendre que cette mesure soit jugée difficile à appliquer par certains d'entre vous. La DB a été jusqu'à produire une note à l'attention de ses mécanos circulant en France sur LGV, leur prescrivant de circuler à VL-10 km/h pour éviter tout problème... alors qu'ils ont la culture du trait et le pratiquent au quotidien chez eux ! Cherchez l'erreur. La sécurité, c'est un état d'esprit et des comportements adaptés, ça n'a rien à voir avec le pointillisme. Performance et sécurité ne sont pas antinomiques. Ils demandent une formation et un management exigeant, avec des chefs pros dans leur boulot.