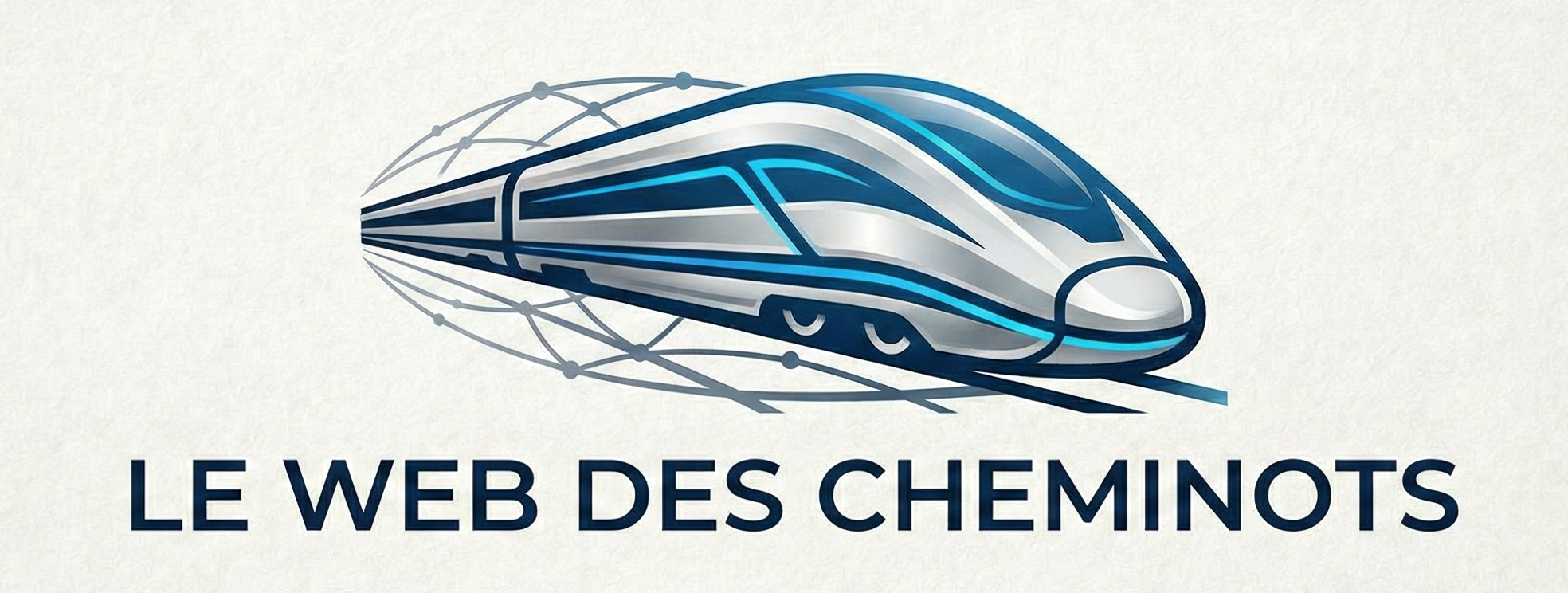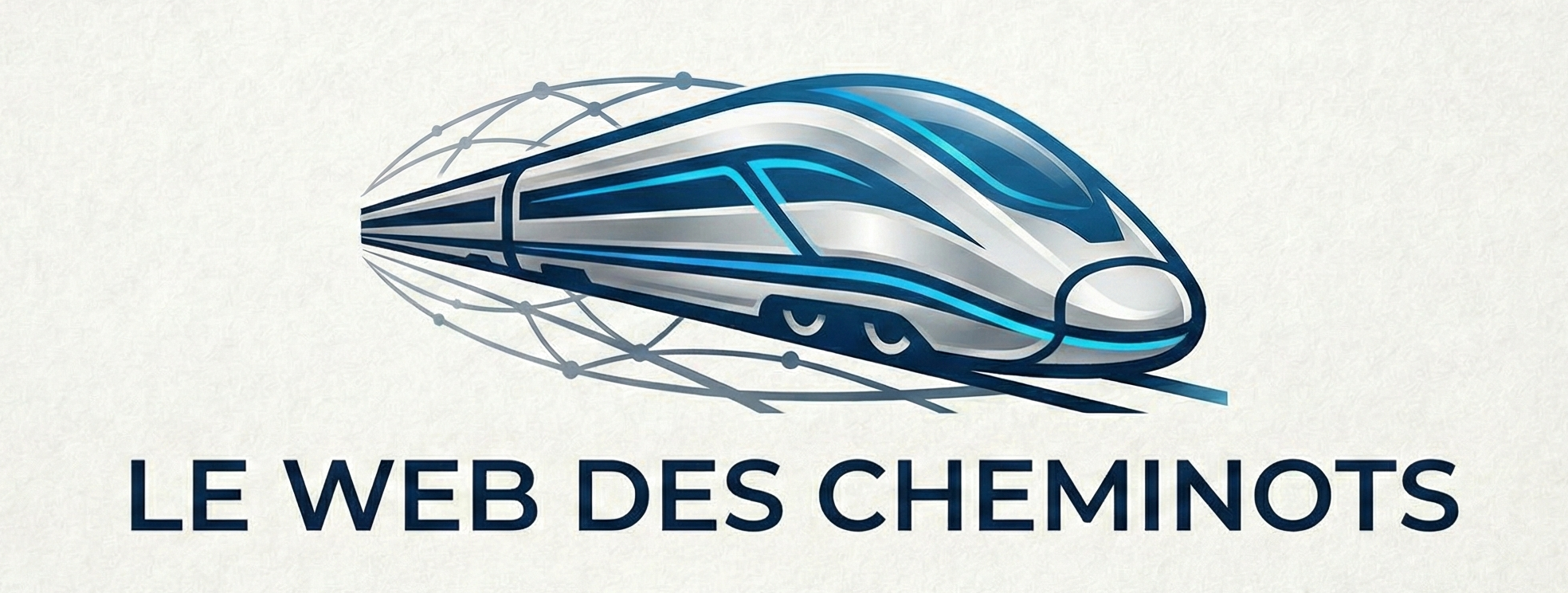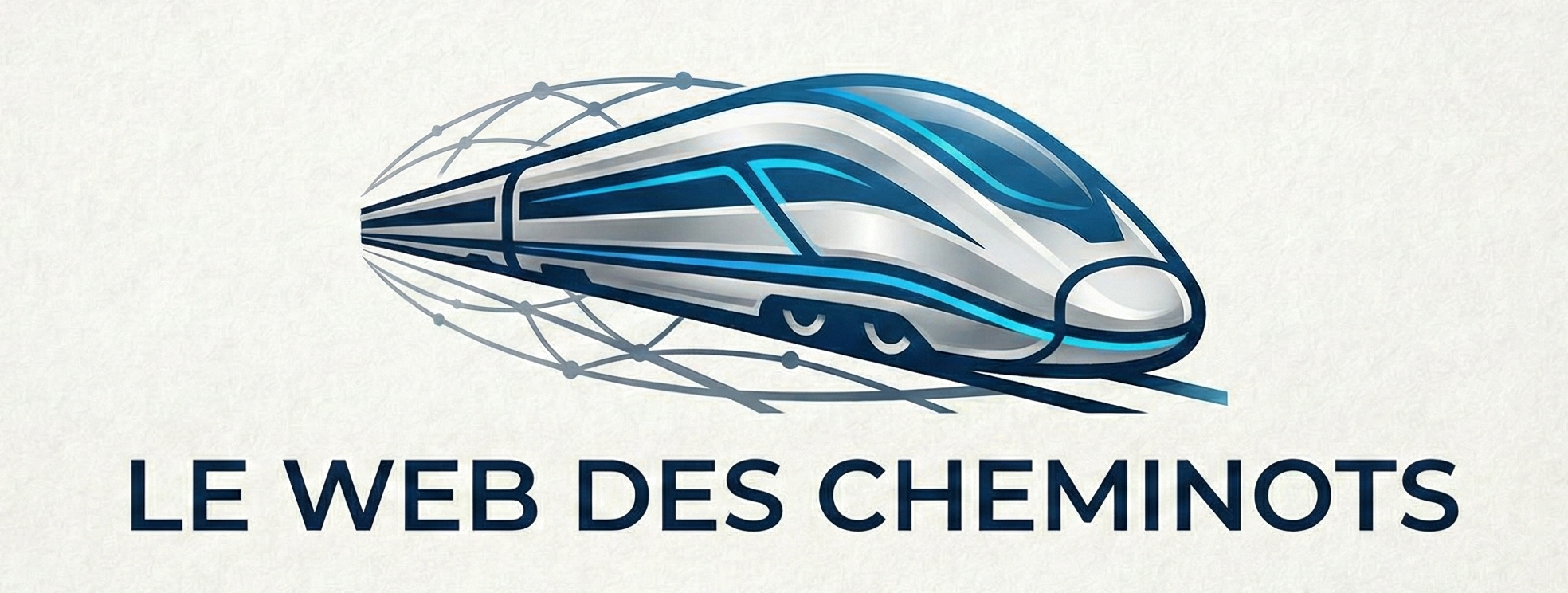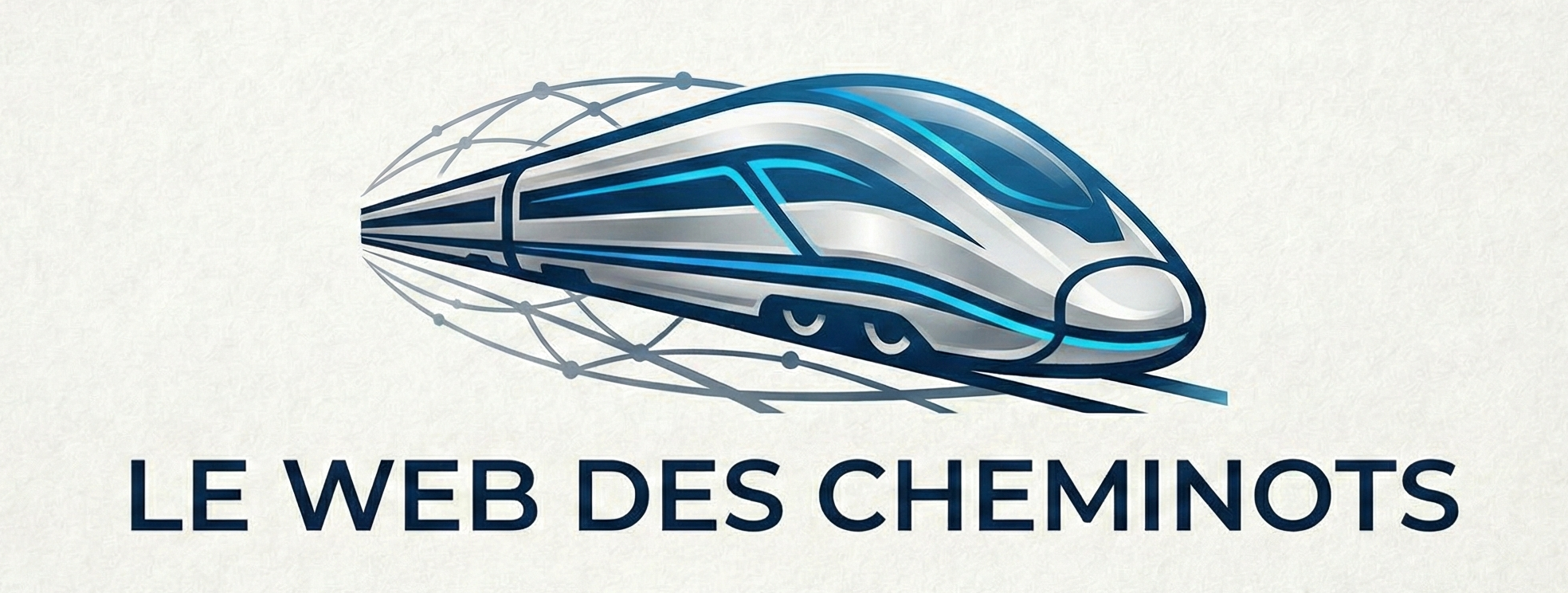Tout ce qui a été posté par Thor Navigator
-
Electrification en 25000 V
Seule la transformation de la partie suisse est à ce jour programmée et financée, pour fin 2013 au mieux (des bruits courent d'un possible décalage à 2014, non confirmé). Côté français, si RFF évoque cette perspective depuis plusieurs années (elle a été mise en avant pour justifier la conception pour le moins discutable de la gare haute de Bellegarde), son financement n'est toujours pas acquis sjmsb. Idem pour le remplacement de l'anachronique BMU avec son canton long Longeray-La Plaine. Christian
-
La dernière aiguille
Salut, ta question est intéressante car elle renvoie à la conception de la signalisation et au lien avec la réglementation. Certaines simplifications ont été retenues pour éviter d'alourdir trop la signalisation (ou du fait de contraintes liée à d'autres mouvements/itinéraire empruntant la même portion de voie), qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur l'exploitation, suivant le contexte rencontré. Quand une VL30 est par exemple appliquée sur 150 ou 200 m en aval du dernier point imposant cette vitesse, il est clair que la perte de temps sera de plusieurs secondes (voire dizaine de sec si >200 m), donc il est souhaitable dans ce cas d'implanter un doublet TIV+Z (avec les balises KVB ad hoc si la ligne est couverte) au dégagement de la dernière aiguille implantée en voie déviée (de l'itinéraire concerné). Dans le cas présenté ici, la distance est probablement réduite, donc l'impact est plus limité. Il faut voir également la fréquence d'utilisation de cet itinéraire (lors du bilan économique de l'opération). Autre exemple : l'adoption d'un taux de ralentissement unique pour la signalisation, à l'origine (30 km/h) qui constitue aussi une simplification regrettable dans bien des cas (la quasi-totalité des branchements simples étant parcourables à 40 en voie déviée... lorsqu'il sont dans une disposition favorable [lorsqu'ils sont associés à d'autres appareils, le 40 n'est pas toujours possible]). Mais la signalisation ne peut être abordée sous le seul angle de l'infrastructure, il faut évidemment l'analyser vu des mobiles, i.e. des conducteurs, en intégrant le facteur humain. Une réglementation trop complexe s'avérera inapplicable donc potentiellement dangereuse (car mal respectée, source de confusion etc.) d'où des simplification inévitables dans certaines configurations (mais qu'il faut chercher à éviter autant que faire se peut, surtout si l'itinéraire est fréquemment emprunté). On voit également au travers de ces exemples l'intérêt que peut présenter une évolution en profondeur de la signalisation latérale sur un réseau ferroviaire. Mais une telle démarche demande beaucoup de temps et coûte cher... elle a donc peu de chances d'être engagée à court terme sur le RFN (à l'inverse de plusieurs réseaux voisins, qui ont modernisé leur signalisation ces deux dernières décennies). Puisque tu poses la question, on peut évoquer à ce propos le système suisse qui permet -sous réserve d'activation manuelle préalable- d'informer (via un signal sonore) le mécano du dégagement de la zone (à parcourir à vitesse réduite) par la queue du train. Christian
-
[le KVB] Sujet officiel
Bonjour, vu la nature très précise et technique des questions que tu poses, je te suggère de potasser les référentiels ad hoc (*) ou/et de t'adresser au spécialiste KVB de ta région (il suffit de consulter les organigrammes sur l'intranet de la partie Infra). Un forum public comme cheminots.net n'est pas vraiment l'endroit pour répondre à ce type de questions, de mon point de vue (discuter des fonctionnalités générales du KVB ou du fonctionnement qu'il impose aux mobiles, c'est autre chose - sur ces sujets on peut échanger). Quelques infos tout de même : le contrôle de franchissement n'est réalisé que sur les carrés et les sémaphores Nf (ceux de BAPR ou de BM typiquement). Sur les autres signaux et états, seule des courbes de freinage sont générées (levées à 40 ou 15 km/h pour le FU dans le cas d'un avertissement ou d'un A cli par exemple). Les points de transition de vitesse non précédés d'un TIVD (et donc repérés uniquement via les RT des FH) sont paramétrés en KVB sans courbes de freinage (cassure nette des courbes donc, au droit du point de transition)... par définition (vu l'absence de TIVD), le KVB étant calé sur la signalisation présentée (il doit être cohérent avec cette dernière). Christian (*) les différentes fiches de l'ex-"Guide pratique KVB" à l'usage des concepteurs des installations de signalisation sont aujourd'hui en grande partie consultables sous forme IN (ré-écrite) sur le système de prescription SNCF. PS : ton pseudo est pour le moins curieux...
-
Explications sur le KVBP
Salut, Le KVBP est utile partout où le KVB a été installé dans la mesure où il permet de supprimer les inconvénients liés à l'absence de réouverture continue (même à l'approche des signaux ce qui était réalisable facilement) associé à un contrôle continu de la vitesse de convois, handicap majeur du KVB, même si ce n'est pas le seul (sa non-transparence et le taux de vitesse très bas adopté sur une majorité de carrés de manière indistincte pour tous les convois sont deux autres aspects pénalisants pour l'exploitation). Bien évidemment, vu son coût, la mise en place du KVBP est difficilement soutenable économiquement dans les secteurs peu denses. Par contre, dans les zones denses, c'est vraiment utile de par la fluidité retrouvée. Par exemple au départ des gares ou des évitements circulation, en supprimant l'ubuesque démarrage à VL10 à l'approche d'un carré ouvert, qui consomme de précieuses secondes. En ligne, la présence du KVB permet de redonner de la robustesse au graphique dans le sens où un jaune franchi n'aura pas de conséquence lourde sur le débit et la marche du train (donc également pour ceux qui le suivent ou croisent sa route) si l'état du signal aval évolue favorablement peu de temps après, ce qui est le cas souvent quand plusieurs trains se suivent à distance de block. On a tellement "intériorisé" la dégradation calamiteuse de l'efficacité de l'exploitation qu'a entraîné le KVB (phénomène accentué par les règles de conduite simplificatrices adoptées par la suite) qu'on finit par ne plus voir qu'il génère des comportements aberrants et contre-productifs sur le fond (le train qui freine et franchira le signal aval à 30 longtemps après que celui-ci ait retrouvé un état moins restrictif, les démarrages à 10 sur voie libre etc.). Ce constat ne modifie en rien ta suggestion de viser autant que possible un franchissement des signaux à voie libre... tant que cela ne conduit pas à tenir une marche d'escagot. Les engins de SNCF-Voyages comme ceux de Proximités (TER, Intercités...) ont reçu un bord KVB pré-équipé KVBP, l'essentiel de l'équipement additionnel n'étant pas posé. Idem pour les engins Fret (si toutefois les bords v5 ont tous évolué en v6). Donc dans ce contexte, il sera difficile de mesurer le gain pratique du KVBP sur ces circulations. Si l'on veut retrouver une exploitation efficace -et restant sûre- avec l'approche actuelle de la conduite appliquée sur le RFN, il est impératif de lever rapidement les contraintes ergonomiques du KVB et à terme de fournir aux conducteurs des informations fiables sur le couple point but/distance but des signaux annoncés. Dans différents courriers adressés à RFF, la SNCF (EF) a indiqué son souhait d'un déploiement rapide du KVBP sur les zones denses du réseau, demande demeurée sans suite jusqu'à présent, à quelques exceptions près, lorsqu'il y avait un financement externe (RFF n'a pas de sous et l'organisation du système ferroviaire ne pousse pas le GI à améliorer le fonctionnement de l'exploitation ferroviaire, vu qu'il a peu à gagner avec l'amélioration de la qualité des sillons en théorique comme en opérationnel). Christian
-
Les questions d'un Suisse aux Français
Salut, La règle des 3000 m (rappelée en cours de fil), c'est effectivement pour couvrir (de manière généreuse donc c'est évidemment pas terrible pour la fluidité du trafic et les performances) le cas d'un arrêt entre un signal d'annonce et un carré ou sémaphore protégeant une entrée de canton ou un itinéraire. En France, la logique du signal "avancé" (qui n'a qu'une fonction d'annonce) est limitée aux BAPR, BM (c'est le cas de La Plaine-Chatelaine, au moins une partie du parcours de mémoire, avec des plaques A ou D sur les cibles correspondantes [qui matérialisent l'indication la plus restrictive pouvant être présentée]) et certaines IPCS (à cibles rondes et plaques A).. En BAL, tout signal peut avoir une fonction d'annonce (ce qui est une solution peu pertinente pour les séquences d'arrêt et de ralentissement lorsque les cantons sont longs, les cas où le signal d'annonce est positionné à 2,5 voire 3 km du point à protéger sont légion... en particulier sur des lignes où la VL est modeste). Le critère des 3 min, cela renvoie à la temporisation appliquée dans les postes du RFN français pour la reprise d'itinéraire (situation différente de la fermeture d'urgence). Donc effectivement, en l'absence de visu du signal, le suivant peut avoir été fermé par le poste, dans certains cas (l'enclenchement d'approche n'interdit pas nécessairement la reprise d'itinéraire, cela dépend des configurations d'installations et des postes), d'où la nécessité de la marche à vue (pénalisante sur des distances importantes car aujourd'hui à un taux de vitesse assez bas sur le RFN). Sur la reprise de marche, avec l'arrivée du KVB, la logique d'ouverture du parapluie à conduit à mettre en dur (i.e. à le rendre systématique sans intervention du conducteur) dans les premières versions (jusqu'aux 5.x) un contrôle de vitesse à 30 (FU à 40, alerte à 35) dès qu'un arrêt (de quelque nature que ce soit) dépassait 3' dans une zone où un signal d'annonce équipé du KVB avait été franchi précédemment (i.e avant l'arrêt). Il a alors été décidé d'uniformiser le principe de la marche à vue en le prescrivant (avec ou sans KVB au sol) jusqu'au franchissement du signal, alors que la règlementation "signaux" de l'infrastructure (la seule opposable à toutes les EFs) ne prescrit la marche à vue que jusqu'à la visu du signal ouvert (hors signal avancé bien sûr, qui n'autorise pas la reprise de marche, donc on peut avoir 5 km de marche à vue dans une configuration défavorable, en BAPR, BM ou sur certaines IPCS). Dans les versions récentes du bord KVB (où la plupart des indications d'aides à la conduite ont disparu, notamment le très utile 00), la mise en dur de la règle des 3' a disparu, ce qui est une bonne chose (toute application indiscriminée d'une disposition de cette nature est contreproductive et déresponsabilisante) mais le référentiel de conduite demeure calé sur l'enveloppe des situations possibles, donc le comportement le plus pénalisant, prescrivant la marche à vue jusqu'au signal (que n'impose le KVB v6 qu'en cas de franchissement d'un signal d'annonce fermé, en l'absence de dispositif de réouverture continue à l'approche du signal [KVBP]). L'évolution du fonctionnement du système ferroviaire français depuis les années 90 tend vers la logique uniformisatrice qui conduit effectivement à considérer que connaître (pas au mètre près bien sûr mais au moins la zone de positionnement dans les secteurs particuliers : bifs, gares importantes, évitements...) l'emplacement des signaux est à proscrire car potentiellement dangereux (délit d'habitude, confusion...). Cette situation ne serait pas gênante si les distances de cantonnement variaient peu d'une ligne à l'autre, voire d'un tronçon à l'autre et étaient optimales sous l'angle du couple signalisation/mobile. En particulier ce serait le cas si l'on ne rencontrait pas de cantons longs, en croissance continue sur le RFN français. Les comportements réflexes prévus par les dispositions récentes telles que la VISA s'inscrivent dans cette logique uniformisatrice. Appliqués sans discernement sur des lignes à VL faible et où cantons longs, cela conduit à circuler parcourir des centaines de mètres voire 1 à 2 km à basse vitesse en amont des signaux annoncés fermés (pour la fluidité du trafic, c'est top !)... Avec les signaux avancés comme on en rencontre en Suisse mais également sur bien d'autres réseaux, qui plus est quand la distance d'annonce/de ralentissement est bien calée sur le couple vitesse max/performance de freinage du convoi, le système est optimisé car le conducteur n'a pas à se poser la question de l'ajustement de sa séquence d'arrêt. Si l'ETCS 1 est un jour installé dans sa version non édulcorée sur le réseau classique français (c'est loin d'être gagné vu le coût de l'opération), on pourra peut-être alors retrouver un fonctionnement plus efficace. En attendant, adopter des distances d'annonce et de ralentissement très supérieures aux besoins sans fournir en parallèle d'information de distance but au conducteur (ou autoriser leur mémorisation pour ceux parcourant régulièrement la ligne), c'est accepter un fonctionnement désoptimisé de l'exploitation ferroviaire, surtout quand on prescrit en parallèle des comportements réflexe alignés évidemment sur la configuration la plus défavorable qui puisse être rencontrée. L'argument que tu évoques ici (en le contestant) fut précisément utilisé pour justifier la mise en place des comportements réflexes, demandant par exemple l'engagement systématique du freinage au plus tard au franchissement de l'avertissement, que le canton mesure 1000 m ou 2500 m et quelle que soit la vitesse limite autorisée sur la ligne. La RSO avec la LSSF demeurée allumée a pour objet de rappeler au mécano qu'il a franchi et acquitté un signal d'annonce (d'arrêt ou de ralentissement) fermé... Si les annonces étaient présentées à distance ad hoc, ce type de question ne se poserait même pas (le train doit freiner si il est proche de sa VL, point barre). Un regard extérieur est toujours intéressant en tout cas, merci de partager des interrogations sur l'exploitation chez le voisin français.
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Salut, seules les 20900 ont reçu des AE de construction (pour des raisons principalement économiques, les 20500 n'en furent pas dotées, ce qui est évidemment regrettable vu la nature des services assurés). Celles de la ligne C ont été équipées dans le cadre de l'opération "renforcement freinage", qui s'est accompagnée de la mise en place du FEP. Sur la ligne D, des modifications plus limitées ont été réalisées il y a quelques années (réduction du temps de serrage via notamment la vidange CG dans toutes les cabines du convoi, ce qui a permis de les assimiler FEP vis à vis du KVB). L'opération actuelle constitue donc une avancée. En toute logique, le bord KVB devrait être modifié, rendant le fonctionnement du système moins pénalisant pour les conducteurs et l'exploitation (taux de décélération garantie accru pour le calcul des courbes de FU et d'alerte). Christian
-
Les trains de pélerins.
Les difficultés et dysfonctionnements de notre système ferroviaire vont hélas bien au-delà de querelles d'ego et de pré carré entre RFF et SNCF, le mal est profond et pour l'heure on ne voit pas le bout du tunnel, c'est plutôt le Titanic...
-
Les trains de pélerins.
Bonjour, je vais revenir à du plus terre à terre, ce qui pourra paraître quelque peu dérisoire face à la souffrance des malades gravement atteints évoquée précédemment. Ces malades ne constituent toutefois pas la majorité des voyageurs des trains de pélerins de/vers Lourdes, ce qui ne change rien au constat, bien évidemment. A la base des réactions d'élus et de représentants du clergé français, il y a une déclaration de la grande maison -reprise dans la presse- tendant à présenter comme un choix raisonné et contraint la suppression à venir de certaines circulations (dont des trains de pèlerins), du fait de la montée en puissance des travaux sur le RFN. Outre que la posture adoptée est de mon point de vue plus que critiquable car elle renforce encore la confusion des genres, la SNCF n'étant plus responsable de la construction des horaires, de l'organisation des travaux et de la répartition des capacités d'infra sur le RFN, la réalité de cette évolution est un peu différente de celle présentée. Il y a bien sûr un élément objectif à l'origine des difficultés rencontrées pour tracer les trains de pélerins (et bien d'autres circulations), liée effectivement à l'accroissement des ralentissements et des coupures travaux sur le réseau (en croissance continue depuis 2009). Contrairement à ce que l'on peut lire et entendre à longueur de journée dans les médias et la communication externe des acteurs ferroviaires, cette réalitée est à mettre en regard de l'évolution du fonctionnement de notre système ferroviaire, qui se traduit par des dégradations croissantes des conditions de circulation et une augmentation des coûts de maintenance et de régénération du réseau toutes choses égales par ailleurs (i.e. à "unité d'oeuvre travaux constantes"), ce qui dit autrement revient à constater qu'il faut couper plus longtemps et plus souvent, ou/et appliquer des LTV plus importantes pour réaliser des travaux qu'on savait précédemment réaliser dans des conditions moins défavorables pour l'exploitation ferroviaire, alors même que le trafic fret et de nuit a fortement diminué... Au-delà des travaux, le facteur explicatif principal (que la presse n'évoque pas, pas plus que les communiquants du ministère ou de RFF et SNCF) est la situation chaotique qui caractérise aujourd'hui la "production horaire" sur le RFN, du fait à la fois de son fonctionnement interne et de l'impossibilité pour le système GI/GID d'anticiper suffisammment la programmation des chantiers. Cela se traduit par des reprises lourdes et tardives des sillons, générant la multiplication des demandes de la part des activités et EFs, confrontées à des "trous de régimes" nombreux et des réponses souvent très dégradées par rapport à leurs besoins. Et ainsi de suite (le chaos s'entretient... la production médiocre appelant l'augmentation de la demande de sillons et ainsi de suite). Sur le fonctionnement interne du processus horaire, on peut rappeler qu'à l'origine il y a eu un conflit entre RFF et SNCF suite à l'attribution du rôle d'ORC (organisme en charge de la répartition de la capacité, défini par la directive CE 2001-14) à RFF, effectif en 2003. La solution de compromis décidée par l'Etat fut le maintien des Bureaux des horaires (BH) au sein du GID (à l'époque) et le transfert (imposé à la SNCF) à RFF d'un nombre réduit d'horairistes expérimentés (*), pour assurer la montée en puissance de la nouvelle organisation (la direction des Sillons de RFF n'assurant qu'un rôle de coordinateur d'ensemble et de prescripteur, l'essentiel de la "production" restant effectuée au sein des Bureaux horaires, sous le contrôle et selon les orientations fixées par RFF). Au fil des années, face à la demande de renforcement de l'autonomie de traitement du processus horaire et aux dysfonctionnements constatés d'une organisation devenue complexe et insuffisamment réactive, RFF a renforcé son organisation (de manière très conséquente lors de la création du Centre de services sensé traiter l'adaptation [en forte croissance avec la nouvelle organisation des travaux et ses conséquences horaires]) et le BH vu ses effectifs se réduire (sorte de logique du "confinement"), avec pour corrolaire la difficulté à former de nouveaux horairistes (les agents expérimentés devant consacrer la majeure partie de leur temps à produire des horaires plutôt qu'à former les nouveaux arrivants, au demeurant peu nombreux durant plusieurs années). De son côté le Centre de services RFF étant composé de recrues totalement étrangères au domaine ferroviaire et formées extrêmement rapidement, l'apport attendu en matière d'adaptation fut très faible(**), le BH (qui assure l'assemblage final et ne rend compte qu'à RFF) considérant que l'essentiel des montages produits par le Centre de service est inexploitable (constat renforcé par l'adoption d'un nouvel outil de conception horaire, insuffisamment débuggué et au point sur le plan technique). Au final, alors que la demande de sillons a explosé pour les raisons évoquées ci-dessous (***), le système ferroviaire, bien que plus important en effectifs au niveau de la production horaire (plus encore si l'on tient compte des horairistes aujourd'hui présents dans les activités transporteur ou à l'interface avec RFF côté EF, qui travaillent en amont [le BH n'effectuant plus d'études mais uniquement la construction du service et son adaptation] et en aval pour tenter de limiter la casse suite aux conséquences des travaux) n'arrive plus du tout à répondre en quantité et en qualité. Face à cette situation ubuesque, l'Etat a tranché et privilégié pour la préparation du service 2012, le report sur routes de certaines circulations, dont une partie des trains de pèlerins (cette décision figure en clair dans un contre-rendu de réunion Etat/RFF/SNCF). D'où la communication qui s'en est suivie (critiquable dans sa formulation), qui a généré des critiques en nombre contre la SNCF... Notre système ferroviaire est bien mal en point et vu de l'observateur extérieur, il ne fait que refléter la descente aux enfers de l'EPIC SNCF, même si la réalité de cette situation est bien différente... (*) ceux-ci sont aujourd'hui en nombre très réduit à RFF (moins d'une dizaine), ces agents étant soit revenus à la SNCF, soit partis à la retraite (la plupart étaient plutôt dans la tranche 40/50 ans quand ils sont arrivés à RFF). (**) les horairistes retraités du BH (et ceux détachés à RFF) ont sollicités pour travailler (à des conditions financières intéressantes) dans ce Centre de service, suite à ce constat... (***) le nombre réel de circulations sur le RFN n'a que peu évolué, compte tenu de la chute importante du trafic fret, et de l'effet de l'augmentation des péages sur les services voyageurs
-
SNCF: week-end de Pentecôte sans train
Salut, ce qui m'attriste dans ce message rapporté par km315, c'est une fois encore le mélange des genres. Ce n'est plus la SNCF qui décide en matière de travaux et d'interception de ligne, mais RFF. Chacun ses responsabilités (sur le réseau exploité, l'Infra SNCF agit en maître d'oeuvre ou avec un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée par RFF, ce qui est différent). Le discours sur le réseau "sans entretien" est aussi pour le moins abusif, surtout sur les axes principaux. Qu'il y ait des progrès à faire en matière d'information, sans doute. Mais il n'est pas sain d'entretenir la confusion des responsabilités dans la communication faite aux voyageurs et à la population (c'est souvent le cas dans les messages relayés par la presse, et même certains discours maison ou communiqués de presse). La solution de facilité consistant à couper le trafic pour des chantiers mêmes modestes ou sur de longues périodes (Sillon alpin...), sur des axes majeurs, illustre surtout le fonctionnement dégradé de notre système ferroviaire national. Et contrairement à ce qu'on peut lire ici où là dans les médias, ce mode d'organisation n'est pas temporaire mais devrait être pérénisé dans les années à venir. Comment faisait-on dans les années 80, alors que le trafic fret était nettement plus important, et les grosses opérations type RVB ou remplacement d'appareils de voie aussi conséquents qu'aujourd'hui (contrairement à ce qu'on tend à nous faire croire (*)) ? (*) le volume de travaux de régénération sur le réseau principal a fortement décru dans le courant des années 90, l'étiage étant atteint autour des années 2000. On en paie aujourd'hui les conséquences...
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Salut, ??? J'avoue avoir un peu de mal à comprendre en quoi sélectionner le côté quai desservi lors du déverrouillage des portes constitue une charge de travail incompatible avec le bon accomplissement de la mission d'un conducteur TER. Qui plus est, est-ce vraiment trop demander à des techniciens hautement qualifiés (il n'y a pas d'ironie dans mon propos) ? Cela devrait faire partie des "gestes métier", non ? Pourquoi ne pas faire la même remarque pour le franchissement des signaux fermés ou des TIV répétés, voire des changements de vitesse qui peuvent être nombreux sur certaines lignes ? Et que dire de la conduite sur les matériels plus anciens, où il fallait passer les crans, "transitionner" etc. C'est un plaidoyer pour la conduite automatisée (ça ne veut pas dire "sans conducteur") que tu nous fais ici NATman... :huh:
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
Salut, sur le premier point, voir messages précédents. La cadence de réception contractuelle était de 15 rames/an à partir de la livraison de la première rame de série (devant intervenir 47 mois après la notification du marché), il me semble qu'elle demeure calée sur cette base. La commande des 25 rames "tricourant France" (réf. 3UF) de la tranche ferme n'a pas été remise en cause à ma connaissance (livraison du 55e élément initialement prévue en décembre 2014, échéance décalée de quelques mois apparemment). Le parc 2N est effectivement généreux avec l'évolution actuelle du trafic... mais c'est également normal qu'il y ait du mou à la veille de la mise en service d'une nouvelle desserte (RR). A part sur quelques missions au trafic limité, le recours aux Duplex est bien adapté au besoin, y compris sur nombre de missions province-province. Vu le niveau atteint par les péages d'infra, l'utilisation de matériel capacitaire est plus que souhaitable, sur les relations GL.
-
[Z 23500 (TER2N PG) - Z 24500 / Z 26500 (TER2N NG)] Sujet Officiel
Salut, Les Z 24500 (tricaisses et autrefois bicaisses) et 26500 (quadri et pentacaisses) étant des éléments automoteurs à plusieurs caisses motrices, il faut diviser par deux le résultat de la soustraction numéro de l'engin - numéro de la série pour trouver le numéro d'ordre, qui est repris dans la numérotation frontale, en dizaines [le chiffre des centaines correspondant à la configuration de l'engin : 3 = tricaisse, 4 = quadricaisse etc.]). Application : Z 24656 -> 24656-24500=156/2 =78 -> tricaisse ->378 en affichage frontal. Christian
-
Ligne Paris Austerlitz - Les Aubrais - Blois - Tours .
Salut, La réalité n'est pas celle que tu décris. Dans les années 80, on régénérait jusqu'à 1000 km de voie par an... avec un trafic fret autrement plus conséquent, et sans procéder à des coupures massives comme cela est devenue la norme aujourd'hui. C'est la conséquence d'un fonctionnement désintégré qui a perdu globalement en efficacité et en compétences, avec des acteurs qui optimisent chacun dans leur coin, sans rechercher à tirer l'ensemble du système ferroviaire vers le haut. La maintenance du réseau classique principal a chuté très fortement après 1995, notamment lorsque RFF fut créé sans les moyens (et les compétences ad hoc) pour péréniser les installations. Sur le réseau régional, le manque d'entretien est plus ancien, mais la situation critique connue aujourd'hui sur le réseau principal est pour une grande part la conséquence de la réduction drastique des investissements sur la période 95-2007. Je suis nettement moins optimiste, car les (mauvaises) habitudes sont prises... l'efficacité perdue dans l'organisation des travaux et le principe des coupures longues sur un réseau qui n'est que très peu maillé et peu équipé en installations de contresens feront que cette situation dégradée va perdurer. Les "minutes V" provisionnées dans les marches au titre des travaux ont également explosé, ces 3 dernières années... Christian
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Sur le Sud-Est, on a de temps à autre des UM "mixtes" Rénov 2 - Rénov 1 (aucune disposition technique n'interdit de tels montages, le seul "problème" se poserait sur les lignes classiques autorisées à 220, absentes sur le Sud-Est). Les Rénov 2 sont affectées au Landy depuis 2004, les Rénov 1 (de tous types) demeurant au TSEE (ex PSE). Pour comprendre ces affectations, il faut revenir brièvement sur l'histoire de ce matériel. Le sous-parc Rénov 2 est constitué à la fin des années 90, en prévision de la mise en service du TGV Méditerranée. Il est alors envisagé d'affecter ces 42 éléments aux relations à longue distance Paris-Midi (Paris-Nice et Paris-Languedoc principalement). Compte tenu des temps de parcours importants, la part de trafic 1ère classe est plus réduite que sur les OD à 2-3 h (encore que pour la Côte d'Azur, cette réalité ne soit pas vraiment avérée). Le pas entre les sièges de seconde est augmenté une nouvelle fois (on était passé de 60 à 56 places par voiture dans le cadre de la rénovation 1), la configuration des voitures tombant à 52 places. La montée en charge du trafic, les commandes complémentaires de Duplex qui ont suivi, les performances moindres des PSE sur LGV comme sur Marseille-Nice (en UM) et l'usure accélérée des PSE sur les longs parcours à GV conduiront à modifier rapidement l'affectation des Rénov 2, envoyées progressivement sur le Nord (axes Paris-Lille-Littoral et Paris-Arras-Valenciennes/Dunkerque) et sur les relations Nord-Atlantique. La typologie du trafic (part de 1ère, parcours plus réduits à GV...) ont été jugées plus adaptées aux caractéristiques de ce matériel. Dans ce but, afin de conserver des performances équivalentes aux rames Réseau (initialement engagées sur ces missions intersecteurs, pour lesquelles elles ont été conçues à l'origine...) sur la majorité des lignes lignes classiques empruntées (pas toutes hélas), des modifications sont effectuées sur ce sous-parc, leur permettant de circuler à 220 km/h sur ligne classique (légère augmentation de la pression dans les CF, changement des pantos continus, reparamétrage du bord KVB...). Lors de l'opération de modernisation Rénovation 2, les élements non équipés de construction (les rames dites "protocole" l'étaient) ont bénéficié de la prise transfo 900 V, permettant de circuler à puissance élevée sous le 25 kV de certaines lignes classiques (le recours à la prise 500 V étant très pénalisant au niveau des performances... très médiocres au-delà de 70/80 km/h). Sur le S-E, cette modification fut d'un intérêt limité vu que Marseille-Nice n'a été autorisé à ce niveau de puissance qu'en US, faute de renforcement des installations de traction électrique... Sur le Nord et l'Ouest, l'équipement en prise 900 V s'avéra par contre utile (cas de Paris-Gonesse en US et UM et de la plupart des prolongements des LGV Nord et Atlantique, pour les US uniquement [Le Mans-Rennes-Quimper/Brest]). Jusqu'à très récemment, le parc Rénov 1 n'était que très minoritairement équipé de cette prise transfo 900 V. Le parc Rénov 2 étant toutefois excédentaire à certaines périodes sur le Nord et les IS Nord-Atlantique, quelques rames retrouvent leur secteur d'origine du S-E de manière régulière, en fin de semaine notamment. Voilà pourquoi on croise des Rénov 2 sur le S-E. Avec la seconde rénovation décidée pour 60 rames (qui touchera des éléments de tous les sous-parcs, tricourant excepté), les cartes vont être rebattues une nouvelle fois (et les éléments non rénovés seront progressivement retirés du parc GV).
-
[ Z 870 Stadler ] Sujet officiel
Parler de "fiasco du cadencement" en Rh-A me semble pour le moins exagéré et invoquer pour cause essentielle des difficultés du SA 2011 dans cette région le TGV, c'est faire sien le discours des élus et les techniciens de la région vis à vis de l'Etat alors que la réalité est quand même moins simpliste et de nature multi-factorielle (la genèse chaotique du service actuel y a largement sa part et touche l'ensemble du réseau, à des degrés divers). Quant au rapport avec l'ouverture à la concurence, j'ai bien du mal à le cerner ici (la refonte horaire aurait probablement été peu différente avec plusieurs opérateurs TER... et l'exploitation certainement au moins aussi chaotique). Chaque acteur du système ferroviaire français devrait assumer ses responsabilités... à commencer par l'itiniateur et concepteur du graphique. Si la ligne du Haut-Bugey avait répondu aux objectifs initiaux sur lesquels son maître d'ouvrage s'était engagé, et avait été conçue de manière plus performante tout en traitant en parallèle Longeray-La Plaine, les contraintes auraient probablement été réduites et les impacts sur le trafic TER plus limités. Il n'en demeure pas moins que Rh-Alpes commence à se rendre compte que la promesse d'une trame cadencée régionale stabilisée plusieurs années durant relève du mythe quand on est positionné au coeur du réseau et des flux à longue distance, et qu'en parallèle des aménagements d'infra ou des travaux conduisent à des reprises fréquentes du catalogue de sillons, si l'on veut pouvoir en tirer parti pour améliorer l'offre et justifier les investissements réalisés. La dégradation de la régularité sur certains axes sensibles n'est enfin pas sans rapport avec l'approche retenue consistant à densifier le graphique sur des secteurs déjà bien chargés ou/et fragiles sur le plan de l'exploitation. Cela est d'autant plus tentant quand on n'est pas impliqué dans la qualité (en performance comme en robustesse) du produit fini (qui dépend de moult facteurs, dont celle des sillons, brique de base de l'exploitation ferroviaire).
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Salut, Le carré rouge a été apposé sur les PSE V300 Rénov 2, pour les distinguer (au-delà des indications en cabine) des V300 Rénov 1, qui demeurent limitées à 200 km/h sur ligne classique (sous 1,5 kV du fait des pantos d'origine jugés trop aggressifs pour la caténaire, sous les deux tensions du fait du paramétrage du KVB demeuré à VL200 [la modif du frein a été réalisée sur les deux sous-séries à ma connaissance, en commençant par les Rénov 2]). Christian
-
[Z 5600 / Z 8800 / Z 20500 / Z 20900 (Z2N)] Sujet Officiel
Salut, Ce n'est pas la vitesse max autorisée en marche de manoeuvre qui pose en soi problème (dans certains pays voisins, elle atteint 40 dans certaines configurations), mais l'inadaptation au contexte. On n'aborde évidemment pas un heurtoir à 27 km/h... C'est pas glorieux en tout cas... Christian
-
[Voiture Corail] Sujet Officiel
Merci à Bertrand pour les photos et les schémas de ces belles voitures. J'ai le souvenir d'avoir vu une compo avec ce matériel en gare de Paris Est, dans mes jeunes années (habitant alors en Province, les occasions d'apercevoir ce matériel étaient rares). Aurais-tu (ou un autre contributeur) des vues extérieures de ces voitures ? Pour revenir aux Z800, elles ont été livrées avec des wc classiques ("ouverts"). Peut-être ces derniers ont-ils été modifiés par la suite, mais assez récemment dans ce cas. Pendant qu'on est dans le HS, des travaux lourds ont-ils été réalisés cette année sur la ligne, à l'occasion de la coupure de printemps ?
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
3 à 4 A/R Strasbourg-Midi devraient être assurés en matériel PSE, la plupart des Paris-Besançon Viotte, ainsi que le Mulhouse-Lille et certains Paris-Mulhouse lors du creux de trafic de plein été. C'est la radiale qui est la mieux servie en matériel récent et performant... (étonnant, non ? [sic]) Pour les POS, il en restera sur l'Est au début du service mais la limitation à Strasbourg des actuelles missions Paris-Zurich (avec quelques prolongements à Colmar) et l'utilisation de Duplex "classiques" permettra de dégager la partie de parc (croissante) engagée sur le SE. A ma connaissance, il n'y a pas encore de 2N2 de série réceptionnée. Comme à chaque mise en service de LGV, il y aura mise en tension du parc, a minima durant les premiers mois de l'exploitation (il en alla de même en 2001 et en 2007).
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Merci, je ne m'explique de telles différences sur un matériel sensé être équipé d'équipements de frein identiques... à moins que ce soit la conséquence du renforcement complémentaire du freinage (paramétrage modifié du freinage pneu) qui a été réalisé d'abord sur les Rénov 2 pour autoriser le V220 sur ligne classique (avec le changement des pantos continu), puis par la suite étendu par souci d'uniformisation aux PSE Rénov 1 (peut-être uniquement les V300 donc), sans que le KVB soit par contre modifié sur ces derniers.
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Peux-tu décoder stp ? Les deux engins étant équipés du frein HP, qu'est-ce expliquerait le comportement hétérogène à basse vitesse ? (j'ai pas saisi sur le coup) Merci à TintinGV pour ses explications complémentaires. Pris bonne note pour le PSE ! :)
-
[LGV Sud Europe Atlantique] Sujet Officiel
Le voyageur va payer au moins deux fois, c'est une certitude (comme utilisateur du train et comme contribuable). Sur SEA, Vinci a assuré ses arrières et Bercy sait très bien que le concessionnaire est couvert par des garanties directes ou indirectes de l'Etat sur la plus grosse partie des capitaux apportés (par emprunt ou fonds propres). La LGV SEA ayant atteint un coût déraisonnable (le concessionnaire n'y est pas pour grand chose au départ), il a obtenu de RFF et de l'Etat de pouvoir facturer des péages très élevés (attitude peu responsable des deux ministères)... qui conduiront les EFs (au premier rang duquel l'actuelle SNCF) à assurer une offre au mieux en légère progression par rapport à celle d'aujourd'hui (il n'est pas exclu qu'elle soit plus faible, les prix élevés aidant). Comme les recettes de péage ne seront probablement pas au rendez-vous, le concessionnaire fera jouer les garanties arrachées à l'Etat et à RFF... ce qui préservera l'essentiel de ses résultats économiques... via la fiscalité des ménages et des entreprises. Vu sous l'angle du bilan socio-économique (ou pour la collectivité, autre intitulé), on sera dans cette hypothèse très loin de la mouture intiale (l'utilité intrinsèque de la LGV est avérée, si le projet est correctement conduit, maîtrisé en termes de coûts et conservé dans le giron de la puissance publique). Mais bon, en 2020-2025, les élus d'aujourd'hui ne seront plus aux affaires... Un exemple à petit échelle de ce que pourrait être SEA (sur le plan économique) est la concession Perpignan-Barcelone (aux coûts pourtant restés raisonnables et les niveaux de péages élevés mais pas délirants).
-
[LGV PACA] Sujet Officiel
Curieusement, aucun de ces économistes ou autres experts ne s'interroge sur les raison de la dérive déraisonnable des coûts des projets touchant l'infra ferroviaire nationale depuis une quinzaine d'années. Quand on a connu la gestion des projets dans les années 90 (ce fut mon cas) voire 80 (par mes collègues avec qui j'ai travaillé), on est proprement sidéré par les montants actuels annoncés par RFF et la manière de conduire les études (sous-traitance en cascade) comme les projets. Il y a des causes exogènes bien sûr, mais elles sont loin d'expliquer la totalité de la dérive, et même la majorité du gap... Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une question de fond sur l'avenir des projets à GV et au-delà celui du cdf dans notre pays, mais tout de même, si les coûts n'avaient pas dérivé de la sorte (et les compétences maintenues au sein du maître d'ouvrage), on en arriverait pas à de telles conclusions. Avec les niveaux de contributions publiques annoncées, nombre de projets (dont le fameux POCL et la LGV PACA) sont effectivement infinançables, même avec un Etat en meilleure santé qu'aujourd'hui. Mais comme cette réalité n'est pas très vendable politiquement (dans la logique court-termiste qui caractéristise la majorité de nos élus), il est plus simple de continuer à vendre au bon peuple et aux élus locaux des plans sur la comète ! Christian Pour info, discussion sur ce même sujet des coûts sur un autre forum ferroviaire (ça parle du POCL mais la thématique est la même) : http://www.lineoz.ne...tart=25#p316121
-
[TGV Duplex] Sujet Officiel
Le nombre de 2N2 sera très réduit au démarrage du Rhin-Rhône, au mieux 4 ou 5 éléments (de mémoire). Les POS devraient faire le joint sur Paris-Zurich, en attendant que le parc soit plus conséquent. Des Duplex classiques (Dasye ou non) seront engagées sur Paris-Mulhouse et quelques missions Alsace-Midi (et Lorraine-Midi).
-
[TGV Sud Est] Sujet Officiel
Bonjour, Merci pour ces précisions. L'assistance EP qui tombe en panne, ce doit quand même être rare sur un TGV. Est-ce signalé en temps réel au conducteur ? A basse vitesse (ici on évoque des entrées à 30), la perte de temps de mise en action des freins due à la transmission de l'onde de pression dans la CG (EP HS) devrait avoir des conséquences limitées (je n'ai pas dit nulles !), vu la distance parcourue modeste (5 s à 30 représente 42 m, 28 m à 20 km/h). Donc c'est fâcheux si on est proche du heurtoir mais de toute manière avec le KVB tel qu'il est configuré, ce serait d'office la prise en charge (sans garantie d'arrêt avant le point protégé puisque EP est forcé à 1 dans le bord KVB de mémoire). L'équipement en frein HP a t-il un peu amélioré les choses au niveau du freinage proprement dit (même si ça ne change rien au niveau du déclenchement, en l'absence de FEP) ? Christian